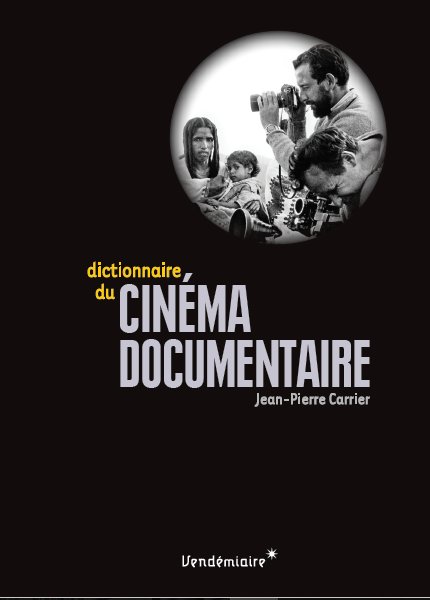A propos de La Cour
Quel a été le point de départ du film ?
L’idée d’un film sur un immeuble, je l’ai depuis le jour où j’ai emménagé dans cette résidence du XXème arrondissement de Paris, en 2004. Ça me rappelait mon enfance dans un HLM à Colombes où il y avait beaucoup de solidarité. La volonté de donner vie à cette ensemble collectif avec sa cour déserte, au travers d’un documentaire rassemblant tous mes voisins, a toujours été forte. Mais ce projet est resté un phantasme, une idée comme on en a parfois.
La vie en a voulu autrement. En mars 2020, le gouvernement annonce le premier confinement, radical.
La cour s’anime par la force des choses. En tant que cinéaste je vois dans cette opportunité un formidable terrain de mise en scène. Je commence à filmer mes voisins, les échanges, les rencontres, les envies de partage.
Pour la première fois à cette échelle, nous avons vécu un isolement durable. La société s’est fragmentée. Mais mes voisins, eux, sont entrés en résistance. Malgré les signaux négatifs envoyés par le gouvernement et la situation sanitaire, les habitants ont prouvé que la culture, l’échange et la solidarité sont des biens essentiels.
Dans cette cour, au milieu des immeubles, on assiste à un foisonnement d’énergie et d’initiatives personnelles. Les collaborations s’entremêlent, se nourrissant les unes des autres, et le dynamisme créatif envahit tout l’immeuble.
Un an après le confinement, durant les couvre-feux, les voisins ont encore beaucoup à dire. Certains prennent du recul, reviennent sur cette année, d’autres résistent en organisant de nouvelles manifestations culturelles.
Ce film est un document historique. Il retrace de manière inédite cette pandémie, pour ne pas l’oublier, ne renier ni ce que nous avons été, ni nos souffrances mais surtout rappeler les espoirs que nous avons nourris. La cour prend le temps de regarder en arrière, assume les erreurs, les manquements et les statu-quo avec bienveillance, recul et philosophie.
Pourquoi faire un film documentaire sur le confinement ?
Parce que c’est un évènement unique dans l’histoire de l’humanité dont les documentaristes devaient s’emparer sur la durée d’un film. J’ai été heurté par l’analogie du président Macron sur une France « en guerre ». La situation globale évoquait en effet ce qu’ont pu connaître nos parents et grands-parents, mais personnellement je ne me battais contre personne, si ce n’est pour un monde moins frénétique et injuste.
L’injonction globale au ralentissement, pour celles et ceux qui pouvaient se le permettre, m’a tout de suite intéressé, car la thématique du travail est au cœur de mes films. J’ai donc eu envie de voir comment des personnes ordinaires allaient, au sein d’un espace commun, se confronter à un évènement extraordinaire. J’aime faire des documentaires sur des lieux qu’on s’approprie pour les transformer en expériences collectives, en utopie. Le confinement a constitué cette occasion.

Quel a été le déclencheur ?
Pendant le premier mois, j’ai vu mes voisins s’organiser, être attentifs aux autres, j’ai observé un couple d’artistes ressentir la nécessité de créer du lien social par des chorales, des voisins travailleurs mais aussi des retraités qui avaient envie de partager une réflexion politique et philosophique. Puis il y a eu une mobilisation militante spontanée avec beaucoup de chants solidaires pour les soignants et des événements les soirs.
C’était suffisant pour en parler à ma productrice Julie Perris de Zadig Productions (Nous avions fait juste avant un film sur mon territoire du XXème autour des rafles Les Gamins de Ménilmontant – en co-réalisation avec Pascal Auffray).
J’ai alors commencé à faire des essais avec mon voisin retraité, Ahmad, un exilé iranien, qui m’a confié, tout en faisant sa marche, et en regardant droit ma caméra, qu’il avait déjà vécu des confinements lorsqu’il était prisonnier politique lors de la révolution de 1979. À l’époque, sa solution pour éviter d’être brisé était de tourner en rond dans sa prison. Au confinement, il faisait des cercles dans la cour, dans un sens puis dans l’autre pour varier, c’était comme refuser de se sentir vaincu.
En regardant les rushes, avec ma compagne, puis ma productrice j’ai trouvé cela émouvant et singulier.
Comment définiriez-vous le film ?
C’est un film historique et une expérience collective autour du confinement. J’ai essayé de m’inscrire dans une démarche poétique, car quand tout s’arrête, on prend le temps de mieux regarder. Comme les peintres qui observent les fleurs se métamorphoser, les escargots ramper, les marmots jouer. Mais c’est aussi un film politique dans le sens où il véhicule de la réflexion autour de ce moment de confinement. Mes voisins avaient un point de vue critique et intelligible, sur la prise en charge sanitaire et scolaire, sur le fait d’assumer de braver l’ordre en descendant dans la cour. Ils évoquaient l’émergence d’un autre monde possible, plus attentionné, solidaire et collectif.
Cela a complètement influé sur ma manière de traiter cet évènement. Nous étions menacés par un virus, contraints par un système orwellien (le pass sanitaire pour sortir, la culture et la manifestation considérés comme des délits, les couvres feux permanents). Je ne pouvais m’empêcher de voir ce film comme une dystopie.
Finalement, comme le pressent Ahmad, un protagoniste, ancien prisonnier politique, on a fini par renoncer à beaucoup de liberté et la défiance de nos institutions s’est généralisée. Peut-être pour le pire.

Cela implique quoi de filmer ses voisines et voisins ?
C’est une drôle de chose car ce sont des gens avec qui on souhaite habituellement garder la bonne distance (politique, sociale). La plupart du temps il peut y avoir de la promiscuité du fait de partager un immeuble, mais pas tant d’intimité.
À partir du moment où l’on commence à filmer des personnes dans le documentaire, on cherche forcément à les traiter comme des personnages. Très rapidement, on rentre dans leur complexité et on s’attache à leurs défauts et différences.
Mon dispositif participant à l’expérience collective, certains voisins, comme les artistes, avaient envie que je documente leur travail. D’autres comme les télétravailleurs ou les retraités avaient juste besoin de parler. Quant aux enfants, ils m’inspiraient en transformant la cour en terrain d’aventure (je ne savais pas qu’il y avait autant d’escargots).
Après l’expérience du premier confinement, mes voisins devenus personnages, me manquaient énormément. Puisque plus personne ne descendait dans la cour car c’était interdit par le conseil syndical et que la plupart télétravaillaient, il était impératif d’aller chez eux.
Mes protagonistes tentaient de reprendre une vie, même anormale. Ils broyaient du noir face à la frustration des confinements et couvre-feux successifs et l’attente inquiète des vaccins. Mon père est décédé suite au Covid.
Ce qui m’a fait tenir, c’est la découverte des premiers concerts clandestins sous la cour, dans les parkings au moment même où mon père est brutalement décédé du COVID.
Là je me suis dit qu’il y avait l’aboutissement d’un film sur l’expérience de ce confinement et qu’il me fallait rendre hommage à ces voisins.

Comment s’est déroulé le tournage?
J’ai fait l’image et le son. J’avais pas mal pris du son sur des films et très peu la caméra (j’ai toujours travaillé avec de très bon chef opérateur comme Pascal Auffray, Emmanuel Gras ou Adrien Rivollier).
Mais là j’ai passé un vrai cap à construire l’image nourri de mes expériences.
Ma fille, Lilas, ma fille, alors en seconde option cinéma, a été formée pour m’assister dans quelques prises de sons difficiles. Mon fils, Melvil, alors en 5ème, est un protagoniste qui incarne le thème de l’éducation confinée.
Un ami chef opérateur Thomas Faverjon a fait une journée de prise d’image pour que j’apparaisse au même titre qu’un voisin.
Comment s’est passé la production?
La production n’a pas été simple, car déjà le financement en France se fait très difficilement sur un film déjà en partie tourné et puis il y avait clairement un aspect psychologique que cette parenthèse était traumatisante pour le spectateur.
J’ai pourtant écrit très vite avec Cyril Lévy, mon co-auteur un dossier d’un documentaire qui ne s’arrêtait pas au premier confinement mais pouvait raconter une histoire plus complexe avec de beaux personnages.
Avec Julie Perris, nous avons toujours pensé que c’était un film documentaire historique et avons persévéré pour qu’il existe coute que coute.
Nous avons obtenu un peu de financement et le soutien Brouillon d’un Rêve/ Scam.
J’ai fait une session de tournage très intime pendant le troisième confinement chez mes voisins. Nous étions à bout de nerfs.
Le tournage finit, j’ai obtenu une résidence de montage chez l’association Périphérie.
Florence Jacquet, ma monteuse avec qui je travaille depuis 15 ans (en fiction et en documentaire), a fait un inventaire avec moi des 130 heures de rushes. Elle était confiante sur la matière mais ne pouvait travailler que si j’arrivais à sélectionner 30 heures. Ce que j’ai fait pendant un mois. Ensuite nous avons monté relativement vite.
Pourquoi sortir la cour en salle ?
Montrer La cour aujourd’hui, 5 ans après le début de la pandémie, peut permettre aux spectateurs et à nous-mêmes de dresser le bilan de cet événement à la fois historique et traumatique. Ces mois d’isolement et de restrictions pour lutter contre le virus ont provoqué des dommages collatéraux que nous avons endurés et parfois enfouis pour avancer. Nous avons tendance à nous souvenir que des bons moments ou à ne pas regarder derrière soi pour mieux aller de l’avant. Mais ce mécanisme de défense a été éprouvé. Une préservation de soi par le déni est la promesse de créer des démons qui ne feront que se perpétuer. Pour mieux faire face à la suite, il semble donc sain de revenir, de manière quasi thérapeutique, sur tout ce qui a été refoulé en si peu de temps.