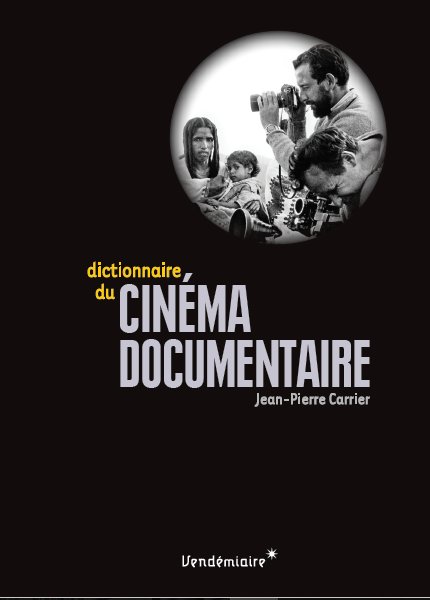A propos de Mon cœur ne bat pour personne
1. Quel sens donnez-vous au titre du film ?
J’ai mis du temps à trouver le titre qui sonnerait juste. Le titre définitif est arrivé assez tard, au moment de la dernière version du dossier de financement. Il est venu naturellement, lorsque le film a enfin trouvé sa forme quasi-finale à l’écriture. En réalité, j’ai extrait cette phrase d’une voix off que j’avais écrite pour le film et que Riccardo aurait dite, et que j’ai fini par enlever pour la mettre dans le titre. Pour moi, trouver le bon titre est fondamental. Parfois, c’est ce qui me donne envie d’aller voir un film. J’y ai donc porté une grande attention.
Comme pour mon documentaire Je ne me souviens de rien, j’aime que le titre affirme quelque chose que le film va sans cesse interroger, remettre en cause. Tout au long de l’écriture, une scène me hantait : un récit que Riccardo, le héros du film, m’avait fait très tôt. Il me racontait la scène finale d’un biopic sur Jeffrey Dahmer : Dahmer s’approche du corps de sa victime endormie, ouvre sa poitrine avec la lame d’un couteau et glisse sa main à l’intérieur, jusqu’à tenir son cœur entre ses doigts — jusqu’à ce que les battements cessent.
Riccardo m’avait décrit cette scène avec une telle passion, une intensité incroyable. Son récit était d’une beauté et d’un trouble fou. J’ai tout de suite su que je voulais l’introduire dans le film. C’était presque ce récit-là qui m’a donné envie de faire ce film. Mais lorsque j’ai finalement vu le biopic, j’ai été déçue : la scène dure à peine trente secondes, et l’acmé émotionnelle qu’il m’avait décrite ne m’a pas parue si perceptible à l’écran. Et j’ai trouvé ça beau, au fond, que Riccardo se soit autant investi dans cette scène, qu’il se soit raconté sa propre histoire, qu’il ait attendu ce moment suspendu : l’instant où le cœur cesse de battre.

Ce récit est d’ailleurs dans le film, au début. Nous dialoguons en voix off, et je lui demande de me raconter à nouveau cette histoire du cœur. Il me la raconte encore une fois, et je ne m’en lasse pas. Parce qu’il y a là, en un sens, tout le film : la fascination de Riccardo pour Dahmer, la puissance de son fantasme face à la réalité crue du geste, et ma propre passion pour ces deux hommes, imbriqués l’un dans l’autre à travers cette relation étrange. Riccardo voit en Dahmer un frère jumeau, un héros, un refuge, un amour imaginaire. Car le film est comme une mise en abîme du regard : je regarde Riccardo regarder Dahmer.
Il est devenu évident pour moi que tout tournait autour du coeur, et qu’il fallait que le titre contienne cette idée, ce mot. L’idée d’un cœur qui bat dans le silence. D’un cœur congelé qui brûle sous la glace. Tout le trajet du film consiste justement à faire affleurer ce cœur battant de Riccardo — un cœur dont il ne sait pas quoi faire, car le risque de laisser entrer quelqu’un à l’intérieur, de partager cette intimité, lui semble trop grand, trop dangereux.
Voilà ce qui m’a menée à ce titre. J’aime qu’il soit poétique sans être trop imposant, qu’il contienne plusieurs strates de ce que le film explore. Quand je l’ai trouvé, j’ai su que c’était enfin le bon.

2. Le voyage à Milwaukee a du sens dans le film par rapport à l’histoire de votre personnage Riccardo. Mais l’utilisez-vous pour dire autre chose de l’Amérique actuelle ?
Honnêtement, je ne crois pas, du moins pas consciemment. D’abord parce que j’écris ce film depuis plus de dix ans, et que je ne pouvais pas anticiper le cauchemar actuel que traverse l’Amérique et de manière plus générale notre monde. À l’époque, il n’était même pas question de tourner aux États-Unis. Le film devait être à l’origine un documentaire centré sur la parole de Riccardo : son rapport à Dahmer, à son propre passé, à la manière dont il posait des mots pour éclairer ce lien trouble entre eux. L’idée d’ancrer le film, devenu une (auto)fiction, à Milwaukee est arrivée très tard, peut-être à l’avant-dernière version du scénario.
Au départ, je m’intéressais davantage à son rapport à son Italie natale, à son exil, à ce qui s’était joué dans ce pays-là, dans ce passé-là. Et puis, un jour, Riccardo m’a dit pour plaisanter : « J’adorerais que tu m’emmènes à Milwaukee. » Cette phrase est à l’image de la création du film. Pendant dix ans, je prenais note de presque tout ce que Riccardo me disait. Certaines répliques du film sont ses mots exacts. Je rentrais chez moi et je recopiais mes notes pour les réinjecter dans le scénario avec Lorenzo Bianchi, mon co-auteur, au fil des années, au gré des désirs et projections qui surgissaient dans la vie de Riccardo. Ce travail d’amendement s’est prolongé jusqu’au tournage : l’une des dernières scènes du film, où il rencontre un homme dans un motel — l’acmé de son parcours —, a été totalement improvisée à Milwaukee, à la toute fin.

Initialement, j’avais écrit une scène où Riccardo rencontrait un escort boy à Milwaukee, s’ouvrait à quelqu’un tout en étant protégé par la relation transactionnelle et la tendresse très encadrée de cette rencontre avec l’escort. Mais pendant le tournage, Riccardo et Gavin, qui était notre régisseur américain, ont vécu une brève histoire d’amour. J’ai été bouleversée de voir mon ami s’éprendre enfin d’un homme avec joie, avec passion. C’était sublime que cela arrive justement pendant le tournage d’un film qui parle de l’absence d’amour dans sa vie, de son impossibilité à y accéder. Une brèche s’ouvrait, la vie entrait dans le film. J’ai aussitôt voulu en faire quelque chose. J’en ai parlé à Lorenzo, à Thomas Jenkoe qui m’accompagnait, à l’équipe : tout le monde a dit banco. Nous avons cherché un motel pour tourner quasi le lendemain car le tournage tirait à sa fin, Lorenzo et Thomas ont écrit la scène dans la nuit… C’était un moment épique qui nous a tous emportés. Gavin et Riccardo ont accepté, et la scène s’est tournée très simplement, tout m’a semblé parfait, juste. C’est un de mes meilleurs souvenirs de tournage.
Tout cela pour dire que le film est avant tout lié au réel et à l’intime. L’Amérique est bien sûr pesée comme une terre violente, où le mal rôde, gangrène, hante le passé, le présent et le futur de ce pays, et qui ici prend les traits de Dahmer. C’est aussi une Amérique étrangère, trop fantasmée pour pouvoir être saisie d’un seul regard. Une Amérique qui nous échappe, qui offre autre chose à celui ou celle qui l’éprouve réellement.
Pour autant, même si mes films traversent parfois des dimensions politiques ou sociales, cela se fait toujours par ricochet. C’est une strate périphérique qu’on retrouve au sein du film, mais cachée au coeur de la matière. Car je pars d’abord de l’intime, des failles et des cicatrices intérieures des personnes que je filme. Je n’ai pas la prétention d’élaborer une pensée politique construite digne d’être partagée. J’admire des artistes comme Pasolini ou Godard pour cela, mais moi, je traverse le politique en épousant les tourments des êtres que je filme. C’était le cas dans Je ne me souviens de rien, autour de la révolution tunisienne, ou dans The Last Hillbilly, qui explore la lente agonie des Appalaches. Mais cela a toujours lieu à travers l’expérience personnelle, la mienne ou celle de mes personnages.
Avec Mon cœur ne bat pour personne, Milwaukee est d’abord le territoire rêvé par Riccardo, mon coauteur et moi. Le lieu où nous nous rendons enfin pour marcher dans les pas de Dahmer, chercher une trace, ou justement constater son absence. Que Dahmer soit américain est important, car l’histoire des serial killers est intimement liée à l’Amérique : une violence endémique qui sourd sous un vernis hypocrite et lisse, et qui éclate dans l’horreur de ces figures de monstres médiatisés — une facette de l’Amérique que j’ai éprouvée à travers mes deux films tournés là-bas et dans celui à venir.
J’ai, c’est vrai, un rapport très fort avec l’Amérique. J’ai eu la chance d’y passer du temps. C’est un pays fascinant parce que, même si c’est une démocratie occidentale (l’est-elle encore ?), c’est un pays d’une violence extrême — sociale, économique, politique, raciale — mais c’est aussi un territoire où l’on peut disparaître, où certains, dans ses marges, vivent comme échappés du monde, écrivant un autre récit. Je creuse cette réflexion plus frontalement dans les films que je coréalise avec Thomas Jenkoe, comme The Last Hillbilly, ou dans notre prochain projet en Californie. Même dans ces films, que l’on pourrait dire politiques, cela reste en creux. Ils sont plus existentiels et poétiques que frontalement politiques, mais ils bruissent des échos d’un monde en mutation, où l’on étouffe sous les strates de violence qui s’infiltrent en nous.
Dans Mon cœur ne bat pour personne, Milwaukee est avant tout, au-delà de la ville américaine, l’endroit où Riccardo confronte ses fantasmes à la réalité. Ce lieu devient le tremplin d’un voyage intérieur : en marchant sur les traces de Dahmer, sans jamais vraiment les retrouver, Riccardo rouvre en lui-même un espace intime. Ce voyage lui permet peut-être, enfin, de dire adieu à Dahmer, à cette figure dans laquelle il s’était tant projeté, pour s’ouvrir à d’autres possibles. Pour s’ouvrir, peut-être, à la possibilité d’un cœur qui battrait pour quelqu’un d’autre que ce serial killer qui ne lui offre que la mort.

3. Comment situez-vous ce film par rapport à vos travaux précédents, en particulier le film coréalisé avec Thomas Jenkoe The last Hillbilly ?
C’est très différent de faire un film seule — même si Thomas est le directeur artistique de Mon cœur ne bat pour personne et qu’il a été pour moi un interlocuteur précieux, une sorte de « maïeuticien ». J’aime beaucoup alterner entre le travail en duo et celui en solo. Thomas aussi, d’ailleurs. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans le fait de penser à deux, de conjuguer deux cerveaux, deux sensibilités, deux regards, après avoir porté seule un film à la réalisation, où la pression, l’exigence, la cohérence pèsent entièrement sur nos épaules, où il faut mener le navire à bon port.
À l’inverse, travailler seule permet de s’immerger pleinement dans ses obsessions, ses leitmotivs esthétiques, narratifs, thématiques. D’être au cœur du projet, d’entrer dans un rapport très direct, très organique avec le film. D’être absolument en jeu. Et d’accepter la prise de risque que cela représente.
Au-delà du rapport de collaboration avec Thomas, Mon cœur ne bat pour personne est un film à part dans ma filmographie. Je l’ai écrit et porté pendant dix ans. Riccardo et Dahmer ont fait partie de ma vie durant tout ce temps. Ce film m’a emportée dans un tourbillon d’émotions et de tourments, qui se retrouvent finalement au cœur du film. Comme s’il m’avait rattrapé au tournage et au montage, quand l’écriture m’avait mise en retrait finalement. Et c’est un film particulier car il s’est inventé et réinventé mille fois, et l’aventure qu’il a été, et qu’il contient en lui, est pour moi singulière dans mon parcours de cinéaste, dans ma vie tout court.
Je dirais qu’il porte la trace de ce que nous creusons avec Thomas lorsque nous coréalisons ensemble : ce désir de s’approcher d’un être que nous avons choisi parce qu’il nous bouleverse, comme ce fut le cas avec Brian dans The Last Hillbilly. Parce qu’on retrouve des morceaux de nous en eux, parce qu’on veut sculpter un film autour d’une personne, pour s’approcher au plus près, physiquement et intérieurement. Offrir aux spectateur·rices une expérience formelle, narrative, poétique, immersive, qui leur permette de traverser, le temps du film, l’intimité de ces personnes. De rendre compte de leurs fêlures, de leurs élans vers la vie, de leurs enlisement parfois dans le désespoir, ou dans cette sensation de ne pas pleinement exister, d’être comme exilées à l’intérieur, exilées dans un monde où elles peinent à trouver leur place.

Il y a donc, je crois, une réelle cohérence entre mes films en solo et ceux que je fais en duo, et entre The Last Hillbilly et Mon cœur ne bat pour personne. Esthétiquement, il y a ce même mouvement entre des scènes concrètes et des plongées dans le flux de conscience des personnages. Ce sont aussi des films très inspirés par la littérature, où le montage est une étape cruciale. C’est là que la narration se retisse, que les cartes sont rebattues, qu’apparaît souvent l’inattendu, dans un travail très étroit avec les monteurs et monteuses qui sont presque co-auteurs et co-autrices de nos films.
Ce sont aussi des films pensés de manière très musicale, où le rythme, les ruptures, les brèches dans lesquelles on plonge pour en ressortir ailleurs sont sans cesse affinés. La musique occupe une grande place dans notre travail aussi. Ce n’est pas quelque chose qui nous effraie ou que nous cherchons à contenir : au contraire, c’est une corde que nous aimons faire vibrer. Car au fond, les films que je fais, seule ou avec Thomas, cherchent avant tout à toucher du doigt une émotion profonde. Je crois que ce ne sont pas des films hermétiques ou intellectuels. Nous avons une approche plutôt sensorielle, émotionnelle. Nous voulons toucher au cœur, permettre au spectateur de traverser les pensées, les sensations, les émotions que nous avons éprouvées au contact des personnes que nous filmons, immergés dans leur territoire physique et mental.
Je crois donc que Mon cœur ne bat pour personne s’inscrit pleinement dans cette lignée, même s’il occupe une place singulière dans mon parcours. D’une certaine manière, il résonne aussi avec Je ne me souviens de rien, qui était déjà une traversée intime, physique, mémorielle d’un moment où quelque chose craque, se fissure.
Tous ces films sont pour moi des prototypes. Trouver le langage de chacun a toujours été au cœur du processus, non par posture, mais par nécessité. À chaque fois, il a fallu inventer un langage autre que dans le film précédent, renouveler notre manière de faire. Ce qui relie tous ces films, c’est aussi de s’accorder cette liberté d’expérimentation, une forme de prise de risque.
« Mon coeur ne bat pour personne » est aussi un moment important dans ma pratique parce que c’est la première fois que je coécris un film de fiction. Mon producteur Lorenzo Bianchi est devenu le coauteur du film et j’ai adoré écrire à quatre mains, cette fois-ci une fiction, et j’ai réalisé que j’aimais énormément d’être en binôme. Contrairement à mon travail avec Thomas où c’est du 50/50, Lorenzo est arrivé en tant que coscénariste : il a écrit avec moi, mais à partir d’une base écrite pendant plusieurs années seule. Il s’est mis au service de ce que je voulais exprimer, raconter, et on sait aussi à partir du moment où il est entré dans l’équation que le film a trouvé sa forme. Lorenzo a transformé le film avec moi, mais toujours en portant ma vision, un peu comme en montage avec Joran Leroux-Gipouloux, ou avec le chef opérateur du film, Robin Fresson où le monteur son Titouan Dumesnil. Et j’ai trouvé ça extrêmement précieux, d’avoir un rebond, des discussions, des contradictions ou des épiphanies en commun.
Mon cœur ne bat pour personne m’a en un sens réconciliée avec la fiction, où je n’étais pas bien sûre d’être à ma place. Je crois que trouver ma place dans le genre documentaire m’a libérée, et a rouvert un ailleurs, un possible en fiction auquel je ne m’attendais pas. Car j’avais commencé par la fiction, avec quelques courts métrages réalisés plus jeune, avant de m’aventurer, presque par hasard, dans le documentaire dont j’ai découvert l’incroyable liberté du geste cinématographique. Et où j’ai trouvé un espace de création qui m’a passionnée. En ce sens, ce film marque aussi une ouverture, car il représente une passerelle vers la fiction : en travaillant sur Mon cœur, l’envie de fiction est revenue, et je m’y suis enfin retrouvée. Cela ouvre un futur possible, entre les deux genres, l’un, l’autre, l’un dans l’autre.