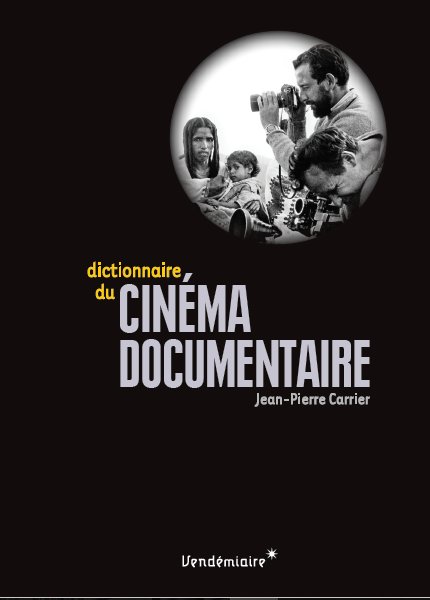Le cinéma scientifique, pouvez-vous nous en présenter les démarches et les méthodes ?
Dans mes travaux j’évoque le terme de cinéma à intention scientifique, plus précisément. Car il faut bien l’avouer, d’emblée, le cinéma scientifique obéit aux mêmes règles que les autres cinémas. Il demeure soumis aux lois imposées par la perspective et la narration visuelle procède également d’une logique du récit avec ses contraintes spatio-temporelles. Il est également en étroite liaison avec son écriture esthétique or depuis des siècles d’académisme et notamment l’impact de la pensée platonicienne tout ce qui est beau ou relève d’une volonté de faire beau est suspect aux yeux de la pensée et de l’académisme scientifique. Cette notion de beau est un concept clef. C’est parce que toute œuvre cinématographique traduit une subjectivité du beau que l’académisme a longtemps mésestimé le langage des images, jugé subjectif par excellence. Cette subjectivité est au cœur de la polémique pour faire science ou pas. J’ai beaucoup écrit sur la subjectivité de la science notamment en coordonnant des numéros de revues: (https://journals.openedition.org/e-migrinter/748; https://www.persee.fr/issue/cllum_1763-4261_2011_num_8_1; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01374752/document et surtout la direction du numéro qui questionnait la place de l’émotion dans l’érudition http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/1/Pages/default.aspx
«Lorsque j’avais proposé de diriger une publication sur les relations ambivalentes entre les exigences d’érudition de la recherche et l’implication émotionnelle du cinéma documentaire, de nombreux collègues semblaient interloqués par cette association. Or le questionnement lié à la compatibilité de la science avec les données subjectives qui entourent sa production est loin d’être nouveau. L’interrogation est constante depuis les débuts de l’anthropologie visuelle, et les premiers films de Jean Rouch sont déjà des témoignages de cette tension entre connaissance et affects.
Les films scientifiques n’arrivent pas à se démarquer ou à se détacher de formes visuelles esthétisantes et cet ancrage dans le beau est le signe manifeste de la présence d’une certaine subjectivité. Tant le beau, même comme produit construit d’une société donnée, échappe. Ce que d’aucuns appellent la magie du beau n’est rien d’autre qu’une expression de l’énergie subjective qui se dérobe à son producteur lui-même. Les peintres le disent assez souvent lorsqu’ils évoquent le processus créatif, en soulignant à quel point entraînés par la couleur, leur propre œuvre les déborde. Cette absence de contrôle est opposée aux exigences cartésiennes du travail scientifique qui requiert une approche rationnelle du savoir et surtout l’application de certaines lois comme celle de la démonstration par la preuve.
Nous pouvons retrouver la justesse d’un raisonnement et le justifier alors qu’il est beaucoup plus difficile d’établir la beauté d’une chose. Nous savons que les objets sont beaux sans pour autant être capables de rentrer dans une explication savante. Là réside toute la difficulté des discours sur l’art, qui ne sont que des mises en organisations rationnelles d’un objet qui par essence ne l’est pas.
Le cinéma dit « scientifique », tel qu’il a été conçu à ses origines, est un cinéma éminemment irrationnel, puissamment émotif et qui, grâce à cette puissance, transmet un savoir inédit par une expression formelle qui déconcerte encore les Sciences Humaines, malgré les avancées des neurosciences et des travaux sur les zones du cerveau (Maclean, 1984) [1]. Des expériences qui ont maintenant plus de 20 ans demeurent souvent boudées par les Sciences Humaines, alors même que les résultats de ces travaux sont le produit d’une expérimentation administrant la preuve.
Les neuroscientifiques ont démontré depuis les travaux de MacLean, largement diffusés au sein du grand public, que l’on n’apprend jamais autant que lorsque les affects sont sollicités dans le processus cognitif. L’expérimentation s’est produite dans le milieu éducatif afin de démontrer que les professeurs qui étaient appréciés étaient également ceux qui arrivaient à obtenir auprès de leurs élèves les meilleurs résultats scolaires. Bien sûr, nous n’avions pas attendu les neurosciences pour le saisir empiriquement (Socrate ne le savait-il pas déjà ?). Les travaux des chercheurs ont simplement apporté des preuves mathématiques sur les probabilités de cette hypothèse.
Dans les films à caractère didactique, notamment sur la possession et la compréhension de la transe, on saisit très vite à l’image la proximité de Jean Rouch avec les êtres filmés. D’aucuns ont également parlé de fusion quasi charnelle entre les possédés et Jean Rouch, lui-même possédé par son sujet. Cette symbiose entre sujet filmant et sujet filmé ouvre un espace de compréhension qui fait du film un véritable outil de connaissance » (Le Houérou, 2008) : http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/1/Pages/Le-Houerou-n1-2008.aspx)
La revue que je dirige depuis 2008, Science and Video, intitulait son premier numéro «Entre émotion et érudition: le cinéma d’enquête ». Depuis la revue revient souvent sur cette question des émotions comme «souillure» de la pensée scientifique ou comme véhicule privilégié de la connaissance. Mon point de vue -défendu depuis mes premiers films- est de démontrer que l’empathie du scientifique, sa compréhension humaine d’un phénomène objectivé est fondamental pour la découverte . La vie scientifique va au delà de la vie des institutions et de la doxa. Les résultats scientifiques dépassent largement l’organisation de la science par les politiques gouvernementales. En bref , ce que je tente de démontrer c’est que la subjectivité de l’acteur scientifique est son meilleur allié mais également son meilleur ennemi. Aussi pour reprendre mon idée du début c’est l’intention de connaissance qui fait d’un film son caractère scientifique ou pas. Il y a là une ambition qui n’est pas celle du journaliste car le cinéma du scientifique se moque du buzz, de l’audimat mais entend faire découvrir, par les images, les observations du chercheur sur son terrain. Il est question d’un cinéma d’observation qui s’étale sur la durée. J’ai mis quatre ans, par exemple, à réaliser mon dernier film. Cette notion de durée est fondamentale. C’est une méthode de travail qui façonne les résultats.
Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine du film ethnographique. Est-ce un domaine privilégié pour le cinéma ?
En raison même de l’utilisation de la caméra par les ethnologues au début de la discipline et aux débuts du cinéma, à l’aube du vingtième siècle, nous pouvons affirmer que cette discipline a été fondatrice dans l’utilisation des images et des progrès du cinéma documentaire. La caméra comme outil privilégié de la connaissance du monde est très vite adoptée par les ethnologues. Les premiers films de Margaret Mead, à Bali, sont essentiels. On la voit sur son terrain avec son casque colonial en train de filmer. « Childhood Rivalry In Bali » (1936-1938) est un chef d’œuvre https://www.youtube.com/watch?v=gITZEVAc8DY. On évoque rarement les femmes comme précursives et novatrices or, dès les débuts du cinéma, les femmes sont présentes avec toute leur créativité. C’est vrai pour le cinéma de fiction avec Alice Guy, mais c’est vrai également avec Margaret Mead dont on parle assez peu . Les hommes parviennent mieux à tirer la couverture et la lumière sur eux. Écartant les femmes «auteurs» en instrumentalisant leur travail pour mieux les faire oublier. Des femmes comme Sophie Ferchiou, élève de Jean Rouch, une pionnière en Tunisie ont été essentielles dans les progrès du cinéma ethnographique. On les oublie trop facilement au profit des chercheurs masculins.
Bien que ces documents visuels soient très impactés par le moment colonial et le regard colonial de l’époque, les années 40 et 50 ont initié des révolutions du regard qui ont justement renversé les perspectives coloniales. Je pense bien sûr à Jean Rouch dont le grand mérite aura d’opérer ce renversement du regard en évoquant une mise en partage de l’être filmé avec l’être filmant et de casser la supériorité d’une vison d’ethnographe «surplombante». C’est ce que l’on a appelé l’anthropologie partagée. Une méthode que je pratique encore
La référence à Jean Rouch est pour vous importante ? Vous avez été son élève…
Oui. C’est un cinéaste d’origine africaine, Ndiaye Adéchoubou qui, à la fin des années 80 et au début des années 90 m’a convaincue de suivre les séminaires de Jean Rouch et j’y suis allée en tant que candidate libre. Ndiaye parlait de Jean Rouch avec passion, il le tutoyait et suivait ses cours avec assiduité. Rouch a élargi ses approches en partageant sa passion du cinéma à d’autres continents. Son séminaire était une plateforme internationale et ses cours étaient d’une générosité inégalée. Une générosité de partage des connaissances sans exclusivisme. Je pense que c’est sa rare générosité qui a fait de Rouch une sorte de phare dans les études en anthropologie visuelle. On assiste actuellement à un rétrécissement de cet «universalisme» et la mise en place d’un jeu plus sélectif et ésotérique du cinéma anthropologique. Si bien que personne aujourd’hui n’a pu remplacer Rouch et qu’en conséquence force est de constater une forme de déclin dans la force de proposition de ce type de cinéma. L’influence du cinéma de Rouch sur la nouvelle vague est tout à fait évidente. Aujourd’hui le cinéma anthropologique semble se replier sur lui-même et ne rayonne plus sur l’ensemble du cinéma. Mais cet état de chose est épisodique et j’espère qu’une nouvelle jeunesse, aussi libre et généreuse que l’avait été Rouch, pourra renouveler ce type de cinéma. Je le souhaite car nous avons besoin d’un cinéma éthique, désintéressé et insoumis à une télévision rabougrie qui se rétrécit sur des reportages simples (dans des temps éclairs qui ne sont pas ceux de la recherche) et devient de plus en plus allergique aux paradoxes. Or, comme disait Kierkegaard les «paradoxes sont la fine fleur de la pensée». Lors de la projection de mon dernier documentaire au cinéma saint André des Arts en novembre 2019, au moins trois spectateurs m’ont dit, après le film, pendant les discussions que je faisais des films à la Jean Rouch. Or, je ne parle presque jamais de lui. Contrairement à d’autres anthropologues, je n’ai jamais rien écrit sur mes années Rouch et je n’ai jamais valorisé un quelconque héritage. Comme le cinéaste Ndiaye Adéchoubou, c’est une partie qui demeure timide, la profonde influence de Rouch n’est pas l’objet d’un jeu de miroir et de faire valoir. Aussi j’ai été très surprise que les spectateurs me rappellent celui qui fut un Artiste/Chercheur dont la liberté a inspiré ma propre liberté. La première fois que j’ai vu Jean Rouch j’étais fascinée par tant de liberté et un mélange original entre connaissance, esthétique et émotion. Les analogies faites par le public au cinéma, en novembre 2019, me démontrent, de l’extérieur, que cette influence n’est pas de surface mais qu’elle est profonde et empreinte de modestie. Le festival Jean Rouch, par exemple, n’a jamais sélectionné un des mes films. Jamais. Aussi, suis-je ravie que le public, lui, reconnaisse cette trace dans mon cinéma, cela me permet de lui rendre hommage à ma façon.
Comment définissez-vous le cinéma d’enquête ? Le cinéma scientifique est-il toujours – ou principalement – un cinéma d’enquête?
Je parle d’enquête en sciences humaines. La sociologie et l’anthropologie sont des sciences où l’enquête joue un rôle clef de validation des connaissances. Il est question d’enquêtes orales qui procèdent par questionnaires directifs (ou non) sur un échantillon représentatif de la population étudiée. Pour ma part mes films sont au cœur d’enquêtes dans les milieux des réfugiés. «Nomades et Pharaons», «Quatre et demi», «Hôtel du Nil», «Angu, une femme sur le fil(m)» sont des mises en abîme et des mises en scènes d’enquêtés replacées dans une marche narrative. A l’origine du film il y a une question à laquelle je réponds en images. Le cinéma scientifique ne se limite pas aux enquêtes. Il peut être tout simplement un cinéma d’observation. De nombreux cinéastes filment, par exemple, des rituels. Les images ici participeront de notre progression des connaissances par un archivage de la cérémonie qui respecte les temps du rituel pour en donner une meilleure compréhension. La caméra en archivant les étapes nous permet de mieux appréhender la société. L’objectif étant de comprendre cet Autre et sa société. Les images sont particulièrement heuristiques en Anthropologie car la mise en scène sociale des gens eux-mêmes en dit toujours plus qu’ils ne le souhaiteraient « eux-mêmes » et permet au chercheur de formuler des hypothèses de travail qu’il n’aurait jamais pu exprimer sans les images. Les grands moments sociaux sont généralement très riches. Tels les mariages, les enterrements, les naissances, les circoncisions, car chacun se tient à une place que la société lui réserve (au centre, en marge etc.…). Dans mon dernier film, par exemple, je débute par un mariage. Cela permet de situer le sujet socialement. Mon film traite des musiciens soufis au Rajasthan (Princes et Vagabonds) et les images de rituels me permettent de mieux rendre compte de leur particularité comme «sujet socio-musical» un concept original que je n’ai pu explorer grâce à cette mise en images des mariages. Le cinéma scientifique peut également mettre en image, de façon didactique, une découverte scientifique (sur une découverte archéologique) sur des expériences en laboratoire et des mises en résultat en utilisant la visibilité de certains phénomènes (les neurosciences par exemple ont une utilisation très performante des images). Les astrophysiciens s’appuient également sur les images pour saisir un phénomène ou l’expliquer. C’est un cinéma varié qui a des vertus pédagogiques évidentes. A Science-Po Aix je donnais un cours de relations internationales sur les crises humanitaires en montrant des documents visuels. Chaque cours projetait un visuel traitant du sujet suivi de discussions et d’analyses imagétiques avec les étudiants. Cela apportait un regard nouveau: les connaissances étaient ainsi transmises par des images en relation avec des textes. A un certain moment, il faut l’admettre, les images ne se suffisent pas en elles-mêmes et doivent être complétées par du textuel. De mon point de vue, en reprenant l’idée de Deleuze Guattari (1980, Mille Plateaux), dans les processus de connaissances les images gagnent à s’associer aux textes dans une approche rhizomique du lien. C’est-à-dire une approche re-liante capable d’agréger des écritures plurielles sans hiérarchiser les images et les soumettre au texte. Car l’histoire des sciences est bel et bien une histoire de soumission des images aux textes.
Quelle place faites-vous à l’esthétique dans vos films?
Je fais une très grande place à l’esthétisme. Pour évoquer la transmission des connaissances pures, j’utilise la langue académique qui est très formatée et qui tue l’esthétisme. Il faut le reconnaître, le jargon tue la beauté des textes. Or, mes terrains sont également des espaces de poésie. L’esthétique me permet de mieux rendre compte des univers spatio-temporels et humains de mes recherches. J’ai travaillé dans des pays très beaux avec des personnes pleines de poésies. Je dis souvent qu’escamoter cette dimension se ramènerait à appauvrir la science de son terreau humain et géographique. Mais l’esthétique ne se limite pas aux beaux paysages. Le beau est en quelque sorte un miracle au carrefour de différents éléments: la concordance entre les couleurs, la lumière, le sens, les émotions, le cadrage et le rythme. Un enchantement rhizomatique d’éléments hétérogènes. Cet assemblage est à la fois calculé et magique. Sans une magie transcendante, il n’y a pas de vraie beauté. Les êtres filmés possèdent leur propre beauté et dans cette « agency » d’éléments hétérodoxes on retrouve la poésie de la vie. Dans le dernier film ma volonté était de partager l’enchantement des chatoyances du Rajasthan, de ses musiques, en congruence avec les éléments de connaissances portés par le film.
Un de vos livres consacré au cinéma s’intitule «Filmer les réfugiés». Comment le cinéma peut-il –ou doit-il – aborder le problème des réfugiés ? Parmi les nombreux films traitant de l’immigration, quels sont ceux qui vous paraissent les plus pertinents?
Sur cette question je risque d’être intarissable. Je voudrais renvoyer au livre lui-même car tout bon cinéma est également une invitation à la lecture. J’ai commencé à filmer les «migrants» et les «colons» (ensablés) il y a 20 ans car j’estimais que le langage scientifique ne me permettait pas de traiter la question des migrations en profondeur. Mes films ont tenté également de déconstruire la vision misérabiliste sur les migrants et j’ai organisé un colloque sur cette thématique. «Réfugiés en Images/Images de Réfugiés». Le colloque a été filmé par l’université de Poitiers et se trouve sur le web. http://uptv.univ-poitiers.fr/program/refugies-en-images-images-de-refugies-la-mise-en-scene-de-la-crise-actuelle-des-refugies-en-europe.html et publié dans la revue « Science and Video«
L’image développe une pensée rhizomatique (lire la définition en fin d’article) c’est-à-dire une approche entremêlée (telles des racines rhizomes souterraines) et permet de dépasser une vision unilatérale et verticale de la migration. Les films permettent d’aller au-delà de la complainte sur les réfugiés pour une analyse plus fine des ambiguïtés des migrations. Le bonheur de migrer, le courage de migrer, les plaisirs d’exils et ses élixirs ne sont jamais des thèmes de recherche car il existe une approche définitivement tronquée des migrations limitant l’expérience migratoire à une expérience douloureuse et malheureuse. J’ai évoqué, dans un ouvrage, les migrations de vacances en Tunisie ( Périples au Maghreb, Voyages Pluriels, L’Harmattan, 2012) https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37184 des classes moyennes comme des expériences heureuses de déplacements. Tous mes films présentent les réfugiés comme des héros moraux. Dans Nomades et pharaons (2005) cela est clairement posé comme hypothèse «Moral Heroes» par l’anthropologue Barbara Harrel Bond dans un entretien filmé en 2004. Cette déconstruction par le regard permet d’avoir une vision plus hétérodoxe, plus complexe que les simples «jérémiades compassionnelles» qui, comme je l’ai démontré sont contreproductives, car en présentant les réfugiés comme des gueux impuissants on participe à leur rejet par la société, qui, par effet de miroir/repoussoir, se replie sur elle-même. Je l’ai constaté en Europe mais sur mes terrains en Egypte (dans les films: 4 et demi et Hôtel du Nil), en Afrique et en Asie. Les migrants qui arrivent avec un capital sont partout assez bien accueillis, mais les «mendiants», eux, sont chassés. Cela j’ai pu le constater sur les quatre continents en le filmant. La pauvreté de celui qui migre fait peur aussi est-il important de rappeler l’infinie diversité des situations migratoires et sa complexité. Le Dalai Lama en Inde est un réfugié. Les exils heureux existent: j’ai pu les filmer dans «Nomades et Pharaons» ou encore «Les sabots roses du Bouddha». Cela ne signifie pas que les problématiques des exilés ne sont pas dramatiques. L’horreur est là : avec un marché de la migrance en Libye et ailleurs où les réfugiés sont «vendus» comme des marchandises (je pense aux réfugiés érythréens avec lesquels j’ai travaillé), ils sont torturés, martyrisés… Mais nous chercheurs avons le devoir d’analyser la réalité dans son infinie diversité et pas sous le prisme de l’horreur qui fait vendre les magazines. Cette horreur là je l’ai aussi filmée dans le documentaire sur le génocide au Darfour, je ne la nie absolument pas mais je pense qu’il faut élargir le champ de sa propre vision..
En dehors de votre travail de chercheuse, allez-vous beaucoup au cinéma ? Quels sont les films qui ont particulièrement attiré votre attention ? Et quels sont vos cinéastes préférés?
Je vais tout le temps au cinéma, j’élabore des fiches critiques que je poste parfois dans un groupe Facebook «Critik Cinematografik».
Il m’arrive de passer des nuits entières à voir des films. Lorsque je suis à Paris je fais des cures cinéma. C’est-à-dire que je vais au cinéma presque toute la journée. Émerveillée même par les navets. C’est un pur bonheur.
Lorsque le cinéma Saint André des Arts a projeté mon film «Princes et Vagabonds» tous les jours, j’ai dû assister à mon propre film pendant 14 jours consécutifs. J’aurais été en droit de me lasser. Au contraire, grâce au grand écran j’ai remarqué des petits détails que je n’avais pas remarqués en montant le film sur un ordinateur avec un écran ultra perfectionné. Grâce à la profondeur de champ, des éléments visuels très intéressants m’ont permis de re-problématiser la question des femmes en Inde en intégrant la notion de seuil. En effet, avec le nombre de projections considérables, j’ai pu relever des répétitions visuelles signifiantes comme une présence féminine en arrière-plan (à demi cachée) mais se faisant voir à moitié par la caméra sur le seuil du foyer. Dans une posture ambivalente. Ces éléments m’ont permis d’élaborer une hypothèse de travail sur le rapport entre visibilité et invisibilité féminine au Rajasthan. Tout cela pour conclure sur l’appauvrissement de nos regards lorsque nous visualisons nos films sur des ordinateurs. Les fermetures de cinémas d’Art et d’Essai auront pour conséquence, à terme, un appauvrissement du regard et de la pensée critique. Les images de mauvaise qualité qui se partagent par liens vimeo sont pitoyables et consacrent la misère de regard dans notre société où le spectateur, devant son écran, consomme du film en solitaire. Le spectacle -dont la vertu est de réunir les humains- est anéanti par cette consommation isolante qui participe de l’atomisation de notre société.
Sur les migrations les fictions sont souvent plus intéressantes que les documentaires, qui, comme je le disais, limitent la migration à sa dimension la plus tragique. Sur cet aspect il existe des dizaines de films sur lesquels je compte écrire un article. Aucun n’a emporté ma conviction. J’ai beaucoup aimé le film de fiction «Nomades» pour le regard novateur sur le déplacement de jeunes marocains et le drame vu du point de vue de leur mère. La migration perçue par celle qui reste à quai et assiste à la noyade de ses fils. Ici, c’est la personne statique qui est centrale. C’est intéressant car on déplace le point de vue classique qui s’appuie souvent sur celui qui migre. L’acteur migrant.
Mes cinéastes préférés sont Pasolini, Visconti, Fellini, De Sica. Le néoréalisme italien m’a autant marquée que Jean Rouch. Mais aussi Emir Kusturica , Tony Gatlif, Quentin Tarantino et les nouveaux cinéastes Coréens (« Parasite » est une merveille), cette année j’ai découvert Todd Phillips avec son « Joker » époustouflant. Dans mon panthéon il y a peu d’auteurs de documentaires à part Jean Rouch et l’anthropologue Jacques Lombard dont j’aime beaucoup les films. Sublimer le réel est en quelque sorte ma recherche esthétique et je suis en train de préparer un film de fiction qui s’inspire de mon travail sur le fascisme en Ethiopie (L’Harmattan, 1994) et d’un roman publié en 2014 « Perla Nera » aux éditions Erik Bonnier. Il y a dans ma quête une circulation des écritures qui coexistent: l’écriture scientifique, l’écriture cinématographique et l’écriture romanesque. Ces différentes écritures se télescopent et se complètent. Je tente avec des écritures plurielles d’avoir une approche rhizomatique. Hétérodoxe, polyvalente, chaotique. Cet éloge du chaos organisé est peut être ma marque de fabrique. L’exemple même de ce rhizome est le travail polyvalent autour de « 4 et demi ». J’ai écrit des articles scientifiques, réalisé un film et publié un roman autour de ce sujet. Comme pour la musique il est question de variations autour d’un même thème.
La théorie du Rhizome développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari est l’un des éléments de la « French Theory ». Il s’agit d’une structure évoluant en permanence, dans toutes les directions horizontales, et dénuée de niveaux. Elle vise notamment à s’opposer à la hiérarchie en pyramide (ou «arborescence»).
Cette théorie a une part d’implication en philosophie, en art, ainsi que dans l’étude des évolutions sociales et politiques. Le rhizome porte en lui une part d’impermanence et de foisonnement hétérodoxe.