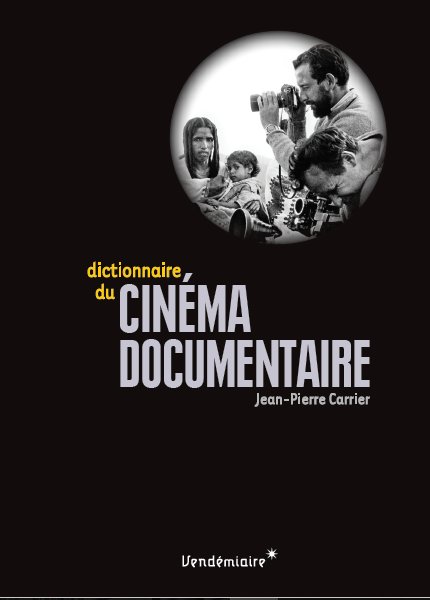Cleveland contre Wall Street. Jean-Stéphane BRON, Suisse, France, 2010, 105 minutes
Cleveland, Ohio, USA. Une ville sinistrée. Ravagée par la crise des subprimes. Des milliers de familles expulsées de leurs maisons. Des quartiers entiers dépeuplés. Les plus pauvres, bien sûr. Les longs travellings le long des rues, montrant les maisons aux fenêtres barricadées et aux murs recouverts de tags suffisent à montrer l’ampleur du désastre. Alors, que faire ?
Cleveland, la ville, a décidé justement de ne pas se laisser faire. Elle intente un procès contre Wall street. Plus exactement contre 21 banques de la capitale mondiale de la finance. Combat disproportionné, perdu d’avance ? Les banques aussi ont décidé de ne pas se laisser faire. Et elles ont les moyens de ne pas se laisser faire. A coups de procédures leurs nombreux avocats entravent la marche de la justice. Le procès est sans cesse repoussé, renvoyé à une date ultérieure. Aura-t-il vraiment lieu un jour ?
Et c’est là que le cinéma intervient. En la personne d’un cinéaste d’origine suisse (l’autre pays des banques !) Jean-Stéphane Bron. Alerté par l’intention de Cleveland, il se rend sur place, rencontre les différents protagonistes, se prépare à filmer le procès. Il attend, patiemment. Attente longue, incertaine. Inutile ? Et c’est alors qu’il a un éclair de génie. Puisque le procès n’a pas lieu, il va en organiser un pour son film. Un procès de cinéma, en référence à une riche tradition américaine. Un procès pour de faux. Mais avec un vrai juge, de vrais avocats, de vrais témoins, un vrai jury. Tous acceptent l’idée. Tous vont y participer avec enthousiasme. Non pour jouer leur propre rôle, mais être leur propre rôle. Tous se comportent comme dans un vrai procès. Depuis le serment de dire la vérité, jusqu’à la façon de s’adresser au juge ou de répondre aux avocats et jusqu’à la délibération finale. Une mise en scène précise et rigoureuse de l’exercice de la justice américaine.
Le film nous apprend beaucoup sur les pratiques des banques américaines (c’est-à-dire de toutes les banques). Sur leur cynisme, leur appât du gain au mépris évident des personnes et de leur dignité. L’argument de la défense consiste essentiellement à renvoyer les perdants (ceux qui n’ont rien compris à la stratégie des subprimes) à leur propre responsabilité. Ils voulaient gagner de l’argent. Ils ont tout perdu. Tant pis pour eux ! La logique libérale est implacable. Nulle trace de regret. La compassion de toute façon n’aurait guère d’utilité. Mais le film montre bien combien nous sommes loin d’une culture humaniste de type européen.
Ce film a un deuxième intérêt. C’est qu’il nous engage à réfléchir sur ce que c’est qu’un documentaire. Au premier abord, on peut penser au Nanouk de Flaherty dans la mesure où celui-ci reconstituait la vie des « esquimaux » pour le filmer. Mais ici il ne s’agit pas d’une reconstitution puisque le procès n’a pas eu lieu. En même temps il est clair aussi qu’il ne s’agit pas d’une création ou d’une invention. Dès les données explicatives des panneaux du début du film nous savons que nous ne sommes pas dans de la fiction. Les intervenants ne sont pas des acteurs qui jouent un rôle avec des dialogues écrits au préalable. Ils sont là pour parler d’eux, de leur vie, de leurs problèmes bien réels. Le film ferait-il donc partie de ce que l’on appelle aujourd’hui « cinéma du réel » ? Mais de quelle réalité s’agit-il ? Le procès n’existe que pour, et par, le film. Etre réel, c’est être filmé. Il y a à toute l’ambiguïté du documentaire – et toute sa force. Un film, et la fiction tout aussi bien, peut être « criant de vérité » comme on dit, ou même « plus vrai que la réalité elle-même ». Quelle est donc la vérité du film ? A l’évidence, il s’inscrit dans la grande tradition du journalisme éthique. Sa valeur de référence, c’est l’authenticité. Les témoins répondent aux questions comme s’ils étaient dans un vrai tribunal. C’est donc que le film a réussi à créer le contexte – le dispositif – qui les mets en situation d’être de vrais témoins. De même pour le jury. Leur délibération ne renvoie qu’à leur conviction personnelle la plus intime. Il n’y a que les avocats qui jouent un rôle ! Mais n’est-ce pas de toute façon leur mode d’être professionnel ? Faire ce qu’il faut pour s’imposer et finir par imposer son point de vue. La justice américaine fonctionne comme ça : la rhétorique est toute puissante et les avocats en usent et même en abusent dans des joutes interminables.
Mais à bien y regarder, ce film n’est pas un reportage sur la justice ou les banques américaines. Le travail du cinéaste n’a ici au fond rien de journalistique. Il film un procès. Mais là où il est vraiment cinéaste, c’est qu’il construit un film. Avec un prologue qui indique clairement la nature du procès qui va être montré, sur fond de vue de la ville enneigée. Et puis les différents épisodes du procès sont organisés en séquences qui s’enchaînent selon une gradation subtile. On part le l’émotion de ce policier ex-membre de la brigade d’expulsion au bord des larmes en racontant son intervention chez une vieille dame qui perd tout en perdant sa maison. Et on finit par l’ancien conseiller à la maison Blanche sous Reagan, partisan du libéralisme absolu dont il décrit dans pathos aucun, sans un quelconque sentiment les mécanismes. Entre les deux, on écoute les victimes des subprimes, mais aussi ceux qui ont d’une façon ou d’une autre joué un rôle dans la crise. Un ex-dealer devenu courtier qui a su s’enrichir grâce aux commissions payées chaque fois qu’il place un prêt « subprime ». Ou bien encore cet informaticien, auteur du logiciel qui sera utilisé par toutes les banques pour transformer les hypothèques en produits financiers. L’ensemble des témoignages présente un équilibre remarquable entre l’émotion et la froideur professionnelle. D’un côté nous sommes inévitablement attirés du côté des victimes, comme le cinéaste se situe lui-même. De l’autre, nous entrons dans une réflexion théorique sur les mécanismes financiers les plus obscures et dont, sans être spécialistes, nous finissons par comprendre l’essentiel. Le projet du cinéaste n’est pas seulement d’éviter tout reproche de manichéisme en montrant de façon égale les deux parties en présence. La construction du film est plus complexe que cela. En témoigne un personnage qui n’intervient pas à proprement parler dans le procès puisqu’elle en est simple spectatrice. Mais elle constitue le véritable fil rouge –avec sa veste rouge – du film : Barbara Anderson. Nous la rencontrons au début du film manifestant avec les membres de son association dans une agence bancaire pour essayer de la forcer à négocier avec les propriétaires avant expulsion. Et nous la retrouvons dans la séquence finale sur un plateau de télé où un des autres intervenants est Barak Obama en personne. Entre temps, nous la suivons dans la ville, dans les quartiers qui, sans l’action de sa « cellule militante » serait la proie systématique des pilleurs et des gangs. De même, les auditions du procès sont entrecoupées d’interview, souvent assez brefs mais intenses, des témoins hors du tribunal, ou de l’avocat de la ville qui commente la progression du procès, définit avec son équipe la stratégie à suivre ou estime ses chances de succès. Le film peut alors jouer la référence, ou la citation. Il devient cinéma direct lorsqu’il filme la vente aux enchères, bien réelle, de la maison d’un des témoins. Ou bien, il fait œuvre de photographe en consacrant devant un mur gris un plan fixe à chacun des protagonistes. Cette séquence pourrait nous inviter à définir le film dans sa totalité comme un portrait : portrait des victimes des subprimes, portrait des banques de Wallstreet, portrait d’une ville américaine qui essaie de se défendre par la voie légale, portait d’une justice, qui en fin de compte ne sera pas rendue.
Ne nous faisons pas d’illusion, le procès de Wall street n’est pas pour demain. De toute façon, en quoi Cleveland et les habitants pauvres de ses quartiers défavorisés peuvent-ils inquiéter un tant soit peu l’empire de la finance ? Si par miracle ils obtenaient quelques compensations financières, quelques miettes par rapport aux gains des banques, qu’est-ce que ça changerait à leur situation ? Car la morale de l’histoire, et du film, n’est-elle pas qu’il y aura toujours des pauvres tant qu’il y aura des riches ?
Le film de J-S Bron est un véritable film militant, non au sens étroit de vouloir faire des adeptes d’une cause, mais au sens noble de l’engagement en connaissant parfaitement tous les éléments constitutifs de la situation.
Si, un jour, ce film est projeté et analysé honnêtement dans une école de commerce ou lors d’une formation continue de banquiers, alors on pourra dire que quelque chose a commencé à bouger dans le monde de l’argent. Non pas que le régime capitaliste vacillerait un tant soit peu sur ses bases. Mais peut-être que des consciences pourraient s’ouvrir sur les conséquences humaines du désir de s’enrichir lorsqu’il ne connaît pas de limite.