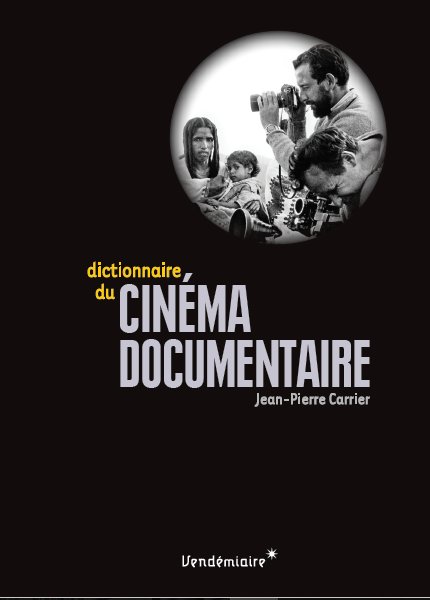Comment êtes-vous devenu producteur ?
Je suis d’abord très amoureux du cinéma. Il y a une scène fondatrice de ma cinéphilie : j’avais 7 ans, mon lit était dans la chambre de mes parents et à la télévision il y avait un film que je n’avais pas le droit de regarder : Les yeux sans visage de Georges Franju. C’était dans une émission qui s’appelait « L’Avenir du futur », consacrée aux greffes de la face. Mon lit d’enfant était dos à l’écran, mais je parvenais tout de même à voir des morceaux d’image dans le miroir d’une armoire en face de moi, et surtout j’entendais tout ! Quand on parle de cinéma, il est avant tout question d’hors-champ, de ce qu’on décide de montrer et surtout de ne pas montrer. Pour moi, cette expérience était intense et mémorable : j’avais très peur et mon imaginaire était en ébullition !
J’ai toujours été attiré par les raconteurs d’histoires. Ce qui me sert tous les jours, c’est la dramaturgie, l’axe maître de mon travail, l’art de raconter des histoires. Quand on écoute un auteur qui vous raconte son projet, on est attentif à comment il agence son récit en ancrant son écriture dans le réel. On retrouve aussi la dramaturgie dans le fait de vendre un film, de le raconter à un diffuseur ou à des partenaires financiers. La dramaturgie est partout dans le processus de fabrication d’un film.
Ce qui est passionnant, c’est qu’un documentaire est produit et tourné par étapes, par petits morceaux. On réinterroge continuellement le matériau en cours de fabrication. On se demande ce qui manque, où est-ce qu’on va, comment le film évolue avec la vie de ceux qu’on filme. Avec mon associé Laurent Alary, on aide beaucoup les auteurs à écrire, à penser leur film. Face à un réel toujours foisonnant, il faut faire des choix : on écrit pour savoir ce qu’on cherche et au final on est toujours surpris par ce qu’on trouve, qui est sensiblement différent de ce qu’on cherchait.
Avant d’être producteur, j’ai d’abord réalisé quatre courts-métrages de fiction. Mais dès mon premier film, j’ai été repéré par un producteur pour mon travail spécifique de production sur ce court-métrage (soutenu par France Télévisions et le CNC). Il s’appelait Christian Zarifian, vivait et travaillait au Havre et c’était un grand réalisateur de documentaires. Il avait créé l’unité cinéma de la Maison de la culture du Havre avec Vincent Pinel en 1968. Il a commencé par me mettre à l’épreuve en me confiant son catalogue de films réalisés depuis 1968 jusqu’à 1994. Dedans, on y trouvait des films de Luc Moullet, de Robert Guédiguian, des films de Jean Gaumy, photographe à l’agence Magnum, tout aussi talentueux que Depardon.
Je suis donc devenu le bras droit de Christian Zarifian et il m’a permis de me former dans de nombreux domaines, j’ai fait plein de choses pour lui. J’étais assistant, attaché de presse sur une sortie nationale, un film qui était à Cannes qu’il avait réalisé, qui s’appelait Les Romantiques. J’ai fait de la direction et de l’administration de production. J’ai organisé des événements comme des projections en plein air dans des quartiers du Havre. J’ai fait venir des grands cinéastes au Havre, j’ai animé des débats (par exemple avec Jean Pierre Mocky). Lorsque j’ai quitté Christian Zarifian en 2000, un cinéaste est venu me chercher pour me dire qu’il aimerait bien que je le produise. Je n’avais pas de structure de production propre. Ce cinéaste c’est Harold Vasselin, réalisateur de Gens des blés et de Comment Albert vit bouger les montagnes, avec Denis Lavant sur « l’invention » de la tectonique des plaques. C’est un ancien ingénieur des mines, un scientifique. Son cinéma peut s’apparenter un peu au cinéma d’Alain Resnais. Il prend des principes scientifiques pour en faire des films de cinéma. Lui avait une association et j’ai produit pour lui, à la fois un pilote de film de série scientifique et un premier film documentaire long qui s’appelait La Peur du vent et qui parlait de la reconstruction du Havre par Perret. C’était un beau documentaire de création.
Et puis en 2007, après avoir rencontré deux réalisatrices qui avaient besoin d’accompagnement, j’ai décidé de créer une association : Pays des Miroirs. Ça peut paraître excessivement prudent et pas très professionnel de créer une association et non une société ; mais, lorsqu’on produisait du documentaire de création pour la télévision, on n’était pas trop empêché pour accéder à des aides. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où la forme de la société est impérative.
Au début j’ai investi de l’argent personnel, et surtout pas dans du matériel. Ça n’avait pas de sens d’avoir la dernière caméra à la mode. Je préférais investir dans des idées, dans des auteurs. Si je donne 2000 euros à un auteur pour qu’il démarre l’écriture d’un projet, je lui donne confiance.
En 2013, on produisait La Mécanique des flux de Nathalie Loubeyre, un film qui a eu des aides très difficiles à avoir, comme l’aide au développement renforcé du CNC. On a senti que ce film-là pouvait prétendre à une sortie cinéma. Mais pour ça, pour compléter le budget, il fallait une société et donc je me suis associé avec mon ami Laurent Alary pour créer Tell Me Films. La société a un capital de 45 000 euros. Donc on peut prétendre par exemple à l’avance sur recettes ou avoir un compte automatique. On peut aussi distribuer des films si on le souhaite, mais ce n’est pas notre objectif. L’association, elle existe encore, elle permet d’aller chercher des mécènes, des fondations. Les deux structures travaillent conjointement, sauf cas exceptionnels.
Un producteur c’est un chef d’entreprise, mais c’est aussi un directeur artistique. L’accompagnement d’un auteur, du début à la fin et même au-delà lorsqu’il s’agit des festivals, c’est le cœur de mon métier. Ce qui m’intéresse le plus, c’est de rendre un film singulier, cohérent, qui trouve sa place pour être vu. Et si possible faire de bons films !