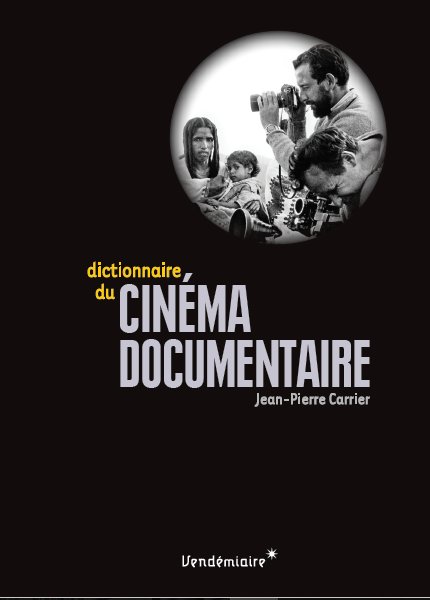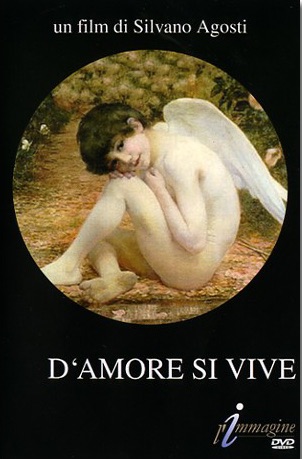Si l’amour est sans doute le thème le plus traité par le cinéma de fiction (l’amour sous tous ses aspects, même si en fin de compte les films peuvent se résumer le plus souvent par la simple formule « l’amour toujours »), qu’en est-il du cinéma documentaire ? Peut-il explorer d’autres voies que la simple enquête à visée plus ou moins sociologique ou psychologique ? De l’observation méticuleuse des manifestations d’amour à l’évocation nostalgique de ses propres aventures amoureuses, bien des films montrent que c’est possible. Et le sentiment amoureux en sort le plus souvent magnifié, le regard chaleureux porté sur lui ne lui faisant nullement perdre son mystère.
1 La dimension autobiographique d’abord. Le plus souvent dans un regard rétrospectif. Le souvenir des moments du bonheur passé. Une évocation nostalgique donc mais qui montre aussi que les sentiments ont une deuxième vie dans les souvenirs.
- Une jeunesse amoureuse de François Caillat.
Un itinéraire amoureux, du merveilleux premier amour jusqu’au drame de l’amour devenu enfin adulte. Le récit cinématographique des amours de jeunesse quelques 30 ans après, en filmant les lieux où ils ont été vécus. Se dessine ainsi une géographie parisienne des amours, du pont de Bir-Hakeim à la place Gambetta, du jardin du Luxembourg au Marais. Caillat filme les rues, les immeubles, les portes, les fenêtres des appartements qu’il a successivement occupés avec ses amoureuses. Et il alterne ce matériau avec des photos, des films en super-8 tournés à l’époque, et surtout les lettres qu’il a reçues, en grand nombre, chaque fois que, dans son aventure amoureuse, le couple vivait des moments de séparation. Les photos sont plutôt floues, refilmées en 8 mm. Les personnages, le cinéaste et ses amoureuses, sont peu reconnaissables. La qualité des films « amateurs » contrastent aussi avec les images réalisées aujourd’hui. Les couleurs sont presque passées. Le temps a fait son œuvre.
Restent les lettres, pieusement conservées. Nombreuses dès la première rencontre, avec un leitmotiv : je t’aime. Mais aussi de belles formules que le cinéaste prend plaisir à répéter. Il filme le texte en gros plan, promenant sa caméra sur le texte, rapidement, n’isolant que quelques mots ou expressions. Des amours enfouies dans le passé mais qui revivent le temps d’un récit filmique.
Puis les amours de tout le monde. Les amours de tous les jours. Marqués par la banalité sans doute. Mais toujours authentiques devant le regard attentif et participant du cinéaste.
- Jaurès de Vincent Dieutre.
Pendant tous ces mois où il venait passer la nuit avec Simon dans l’appartement de Jaurès, la station de métro, Vincent faisait des images prises depuis la fenêtre de l’appartement. Les rues, les voitures, les passants, le métro, un immeuble en face, et surtout le canal en contrebas.
Ces images, Dieutre n’en fera un film qu’après sa séparation d’avec Simon, à la fin d’un amour vécu comme grandiose, le plus fort, le plus beau qu’il ait connu. Un bonheur qui ne pouvait pas ne pas s’achever un jour. Ce jour-là, cette fin, ouvre le temps du film.
De l’homme aimé, il n’y a pas d’image. Du bonheur non plus en définitive. Il s’incarne seulement dans ces quelques vers repris plusieurs fois dans le film :
« S’il est vrai Simon que tu m’aimes
Et j’entends que tu m’aimes bien
Je ne crois pas que les rois même
Aient un bonheur pareil au mien. »
- Fragments d’un parcours amoureux de Chloé Barreau.
Un film d’amour ? Oui, mais qu’est-ce à dire ? Un film où l’on montre l’amour ? L’amour que l’on fait ou l’amour que l’on vit en direct. L’amour que l’on rêve, que l’on invente, comme dans la fiction ? Le film de Chloé Barreau ne se situe pas dans ces direction. Il ne participe pas de ce qui ne peut être qu’un voyeurisme plus ou moins assumé. Dans ce parcours amoureux dont il est question, les histoires et les aventures amoureuses sont tout simplement racontées. C’est l’amour dont on parle. Dont on fait le récit. L’amour transformé en discours. On est bien dans un contexte barthésien. Et pas seulement à cause du titre.
Qui raconte ? Apparemment, ce n’est pas la cinéaste. Son film n’est pas en première personne. Il n’y a pas de je dans son discours et pourtant c’est bien de ses amours à elle, Chloé Barreau, dont il s’agit. Mais, et c’est là l’originalité du film. ses amours sont racontés par ceux qui les ont vécus, les autres, les amoureux et les amoureuses de Chloé qui vont se succéder à l’écran, toujours cadrés de façon très traditionnelle face à la caméra. Leur prénom apparait sur l’écran une fois pour toutes et pas toujours lors de leur première apparition, car leur récit n’est pas donné tout d’un bloc. S’il y a un ordre chronologique dans le parcours amoureux de Chloé, dans son récit, de l’adolescence à la maturité, du lycée où l’on passe le bac à celui où l’on suit une prépa, de la vie parisienne à la fuite en Italie et au retour de Rome, la présentation de cette histoire entremêle souvent les récits. Et donc appelle aussi les différences de points de vue. On a plutôt affaire à un récit éclaté. Le montage s’accélère parfois pour donner des réponses aux questions, aux sollicitations, que l’on devine venant du hors-champ. S’il fallait présenter Chloé en un seul ou 2 mots ? S’il fallait résumer l’amour vécu avec elle en une formule, et ainsi de suite.
Tout le film repose donc sur ce dispositif introduisant une distance par rapport au vécu, une rupture dans la dimension autobiographique. Qui filme ? Ce n’est pas Chloé, puisque celui ou celle qui parle ne s’adresse jamais directement à elle. S’il n’y a pas de je, il n’y a pas non plus de tu dans le film. Pourtant, le récit des amours avec Chloé n’est effectué que pour figurer dans le film des amours de Chloé, un film réalisé par Chloé, où ceux qui racontent ne figurent qu’au second plan, comme des seconds rôles. Le premier n’étant tenu que par Chloé elle-même. Même lorsqu’elle n’apparaît pas à l’image ou si peu.
Le dispositif du film renforce l’idée que l’amour ne peut être raconté qu’au passé, qu’après sa fin, qu’une fois la page tournée. Dans un tel récit, c’est donc la mémoire qui officie, avec ses imprécisions, ses lacunes ou ses coups de projecteur, qui peuvent très bien n’être qu’anecdotiques. Mais quoi qu’il en soit des imperfections de la mémoire, le récit amoureux ne peut faire l’impasse de la rencontre, la révélation de l’amour, le coup de foudre, aussi qui ne peut jamais faire l’objet d’un déni. De même, la rupture, même si la disparition de l’amour est déjà plus ou moins longuement anticipée, ne peut rester dans le hors-champ, le non-dit avec ses sous-entendus et ses dénégations.,
Rempli de nostalgie, et pas seulement à propos du premier amour de l’adolescence le film de Chloé Barreau ne peut pas s’adresser à ceux qui vivent leur amour dans le présent. Il faut avoir vécu le passage du temps pour en ressentir toute la charge émotive. Certes, Chloé film ses amours au moment où elle les vit. De façon continue et quasi compulsive, au point d’indisposer certains de ses partenaires. Mais elle nous donne avec ces images des traces de l’amour, comme des aides ou des supports à la mémoire. En devenant des images de cinéma, en résultant d’un montage filmique, elles perdent leur fraîcheur et leur spontanéité. Mais elles deviennent les signes de l’universalité du sentiment amoureux.
2 L’amour au quotidien
- Amour rue de Lappe de Denis Gheerbrant.
Rue de Lappe, en plein cœur de Paris, près de La Bastille. Une petite rue, où les immeubles sont plutôt délabrés. Une rue pas très commerçante, mais il y a plusieurs cafés, des bistrots qui foisonnent de vie et où se retrouvent les habitués, habitant le quartier essentiellement.
Les Parisiens que Gheerbrant rencontre dans les cafés, il les retrouve, certains du moins, chez eux, dans leur intimité, en couple ou seul. Se construit ainsi une série de portraits mêlant vie sociale et vie personnelle où le thème de l’amour revient sans cesse. De l’émoi du premier baiser à la complicité du couple de vieux mariés, en passant par ces deux homosexuels qui ont lu dans les cartes du tarot la solidité de leurs sentiments, ce sont toutes les facettes du vécu amoureux qui sont ainsi évoquées en toute simplicité, sans fausse pudeur et sans effet littéraire. Bien sûr, la majorité de ceux qui fréquentent les bistrots de la rue ne sont plus toujours très jeunes. Leurs propos sont parfois empreints de nostalgie. Mais aucun n’est tourné vers le passé. C’est à leur vie présente qu’ils sont attachés, sans regrets particuliers, pour profiter autant qu’ils le peuvent des plaisirs de la vie.
- Un amour d’été de Jean-François Lesage.
Une nuit d’été à Montréal, dans la chaleur de l’été. Une nuit dans un parc, où l’on peut s’allonger sur l’herbe, mais pas pour dormir…Une nuit entre garçons et filles, à discuter, à fumer, à boire, manger aussi et même danser. Une nuit de repos, de vacances sans doute pour ces jeunes dont la majorité doit être étudiante. Mais ils restent anonymes. Peu importe qui ils sont. Il suffit de les regarder savourer l’instant présent.
On parle beaucoup dans ces petits groupes d’amis qui ont pour seul but de passer un moment ensemble, un bon moment. Alors ils parlent d’eux, c’est-à-dire qu’ils parlent de l’amour, de leurs relations amoureuses. Ils se confient un peu. Se laisse aussi certainement entrainer par le plaisir de parler. Alors au fond, peu importe ce que l’on dit. On peut même philosopher. Un petit peu en fait. Mais enfin, le complexe d’Œdipe, voilà un bon sujet. La jeune québécoise qui le raconte insiste sur le fait qu’Œdipe s’est crevé les yeux. Il a tué son père, il s’est marié avec sa mère et il s’est crevé les yeux. Mais pourquoi donc. Question que tous ses interlocuteurs se posent. Et qui ne recevra pas de réponse. Alors on passe à autre chose. On ne s’arrête jamais trop longtemps sur un sujet.
Le film est fait de longs plans fixes. Pas de mouvement de caméra. Les personnages sont d’ailleurs presque toujours immobiles, allongés sur l’herbe pour les couples d’amoureux, ou assis autour d’un feu de bois qui lance des étincelles bien visibles dans la nuit. Les gros plans dominent, filmant les visages les uns après les autres. Le plan d’ensemble de l’incipit nous laisse deviner des silhouettes se détachant en ombre chinoise sur une faible lumière de fond. On retrouvera ce plan en fin de film. Entre temps on aura plongé au cœur de la nuit.
3 – L’amour adolescent, vu par les adultes, les parents. Une mère par exemple. Un premier amour, le temps de vacances dans le midi ensoleillé. Un amour qui devra se terminer à la rentrée.
- 800 kilomètres de différence de Claire Simon.
Une représentation romantique de l’adolescence comme moment du rêve et peut-être de l’illusion. Manon, lycéenne parisienne de 15 ans, passe ses vacances dans un petit village du Var avec sa mère, la cinéaste Claire Simon. Le film est donc d’emblée situé dans le cadre d’une histoire familiale. S’il raconte l’aventure amoureuse de Manon avec Greg, apprenti boulanger chez son père dans le village, c’est précisément à travers le regard de cette mère cinéaste qui prend un plaisir évident à filmer le visage de ce jeune garçon et surtout celui de sa propre fille, épanouie par le soleil des vacances et la rencontre amoureuse.
Outre la distance géographique indiquée dans le titre, bien des choses distinguent les deux jeunes amoureux. Elle vit à Paris, une fille des villes ; il vit dans un petit village du Midi. Elle est lycéenne, attirée par la culture et la littérature ; il est apprenti boulanger et se passionne pour le foot et la chasse au sanglier. Elle a 15 ans, lui plus de 18. Elle vit avec sa mère (il n’est pratiquement pas question du père) ; il vit avec son père, sa mère n’étant même pas évoquée.
Tout se termine par les pleurs de la séparation, inscrite pourtant dès le début de l’aventure. Une adolescence naïve, sans doute. Mais entièrement sincère dans l’expression de ses sentiments.
4 – L’amour toujours. L’amour dont on parle entre amis. L’amour dont on aime parler, jusque tard dans la nuit. Surtout les nuits d’été où personne n’a sommeil. Des récits multiples dont on pourrait faire un film aussi long que la nuit.
- Un peu, beaucoup, passionnément de Fabienne Abramovich.
La question fondamentale : qu’est-ce que l’amour ? Peut-elle avoir une réponse unique? Evidemment non ! Le film propose plutôt un ensemble d’élément vécus, de remarques ponctuelles puisées dans les expériences des uns et des autres, des couples d’amoureux qui se regardent les yeux dans les yeux, ou des amis dont chacun attend des conseils de l’autre et n’hésite pas d’ailleurs à en donner. S’élabore ainsi un petit répertoire des questions existentielles qui caractériseraient cette jeunesse amoureuse bien insouciante et d’un romantisme qu’on aurait pu croire d’un autre siècle. Comment sait-on qu’on est amoureux ? Comment sait-on que l’autre est amoureux de soi ? L’amour est-il une passion qui submerge, qui transporte, qui transforme ? Et quelle place la tendresse peut-elle y occuper ? Des questions éternelles. Mais auxquelles chacun croit pouvoir apporter sa réponse personnelle, pas forcément originale, mais sincère et donc authentique.
5 Des histoires d’amour. Des couples, unis ou séparés. Deux ne font qu’un.
La mémoire éternelle de Maité Alberdi.
Jamais peut-être un film aura montré l’amour d’un couple avec autant de simplicité, d’authenticité, de sincérité, de profondeur.
Ce couple c’est celui que forme Augusto Góngora et Paulina Urrutia. Lui est journaliste, célèbre au Chili. Il s’est engagé depuis toujours dans la dénonciation des crimes de la dictature et depuis le retour de la démocratie il se bat contre l’oubli. La réconciliation nationale n’implique nullement que le pays devienne amnésique de son passé. La dictature a fait tant de mal. Elle a laissé des traces indélébiles, des souffrances qu’il faut sans cesse rappeler pour ne pas les oublier.
Elle c’est une célèbre comédienne qui a été ministre de la Culture du gouvernement Bachelet. Le film la montre jeune, souriante, rieuse même, du moins tant que la maladie de son mari lui laisse le temps de vivre.
Car Augusto souffre de la maladie d’Alzheimer. Sa mémoire s’efface peu à peu. Il en vient à ne plus se reconnaître dans la glace. Puis il ne reconnaît plus sa femme, ses enfants malgré leurs efforts pour le stimuler, le garder présent dans la famille, dans son couple surtout. Un courage de chaque instant, exemplaire, surtout quand on sait que l’issue est inévitable, même s’il est possible de le retarder un peu. L’issu c’est l’isolement total du malade. Le moment où il sera totalement absent à lui-même et aux autres. La destruction du passé, de tout ce qui a fait une vie. Une vie de passion, d’engagement et d’amour.
A demain mon amour de Basile Carré-Agostini.
Le titre nous le dit, ce film est un film d’amour. Il met en scène un couple amoureux, un couple qui a vécu son amour pendant de longues années et qui continue à le vivre encore et encore. Un tel amour n’est-il pas éternel.
Pourtant en regardant de plus près, et notamment l’identité de ce couple, sans remettre en cause cette première qualification, il nous faut en ajouter une autre. Ce film est un film révolutionnaire, ou pour le moins un film qui nous parle de révolution – à défaut de la faire. Un film qui est donc une critique implacable du néolibéralisme capitaliste, et ceci tout simplement parce que cette critique a été et est encore le thème de prédilection, le crédo revendiqué ouvertement par ce couple érigé dans le film au rang de personnage central, de héros révolutionnaire, le temps d’un film.
Ce couple c’est Michel et Monique Pinçon-Charlot, deux sociologues bien connus pour leurs écrits sur la grande bourgeoisie en France, ceux qu’il est courant de dénommer les ultra riches, omniprésent dans le CAC 40 et dans l’industrie du luxe, entre autres. Nos deux chercheurs sociologues du CNRS sont maintenant à la retraite, ce qui ne les empêche pas d’être présents sur le front des luttes sociales dont notre époque est riche.
Le titre du film nous promet de pénétrer dans leur intimité, ce qui sera fait dès la première séquence, tournée dans leur chambre à coucher où nous les surprenons dans leur lit, au réveil, le matin. Leur appartement au fil du film n’aura plus de secrets pour nous, pas plus que leurs coutumes alimentaires, dès le petit déjeuner. Cette intimité a bien sûr pour but – et pour résultat – de nous les rendre sympathiques, en espérant que cette sympathie personnelle se reporte sur les idées qu’ils défendent. Une sympathie que le film se plaît à souligner : «je vous adore » clame une femme les rencontrant dans la foule d’une manifestation samedi de gilets jaunes.
Mon cœur voit la vie en noir – un amour à Kaboul de Helga Reidemeister,
Kaboul, Afghanistan. Un couple d’amoureux. Shaïma et Hossein. Un amour fort, qui remonte à l’enfance. Un amour qui semble indestructible. Et pourtant. Un amour qui doit affronter les contraintes de la vie, de la société, de la famille. Un amour impossible.
Hossein a perdu l’usage de ses jambes dans la guerre, du côté des Taliban. Un choix qu’il n’a pas fait en toute liberté et qu’il semble regretter alors que les Talibans ne sont plus au pouvoir. Il ne se déplace plus – quelques dizaines de mètres tout au plus- que grâce à un déambulateur avec lequel il semble sautiller de centimètre en centimètre. Il reste le plus souvent allongé sur des coussins. Il est à la charge de sa famille.
Shaïma, elle, est jeune et en pleine santé. Resplendissante dans sa robe aux milles couleurs. Mais elle est mariée. Ou plutôt elle a été mariée, car ici les jeunes filles sont vendues pour rapporter l’argent qui fera vivre la famille. Elle a une petite fille, 5 ou 6 ans, qui occupe beaucoup de place autour d’elle. Elle est décidée à demander le divorce. Une situation inextricable. On n’en verra pas la résolution.
Une première séquence, longue et chargée d’émotion, réunit les amoureux. Elle vient le voir malgré l’interdiction qui lui est faite par la mère d’Hossein. Être ensemble, se regarder, se toucher la main, suffit à leur bonheur.
Dans la suite du film, la réalisatrice nous plonge au cœur des deux familles, en donnant surtout la parole aux deux mères. L’une et l’autre sont catégoriques. La situation est vraiment trop problématique. Il n’y a qu’une solution, que Shaïma retourne vivre avec son mari, même si en tant que quatrième épouse, sa vie conjugale est particulièrement difficile. Mais peut-elle renoncer à son amour ?
Une histoire d’amour d’ Astrid Adverbe et Boris Lehman.
L’amour, c’est faire un film ensemble. Pour des cinéastes du moins.
Astrid et Boris font un film ensemble. Un film sur eux, sur leur amour, sur leur histoire.
Une histoire d’amour donc.
Mais l’amour n’a pas vraiment d’histoire. Tout amour est éternel. Ou du moins se vit comme tel.
Où se sont-ils rencontrés ? Dans une salle de cinéma sans doute. Peu importe au fond. Le cinéma c’est toute leur vie.
Astrid et Boris se filment l’un l’autre. Aux plans cadrant Boris, presque en gros plan, succèdent les plans cadrant Astrid, en gros plan aussi. Et inévitablement ils sont ensuite ensemble dans le même plan.
Ce film est un film d’amour. Un film dont chaque plan est une déclaration, d’amour. Où tous les regards sont amoureux.
Et le film lui-même est simple. Un couple qui fait un film sur ce couple qu’ils sont. Qui ne filme que le couple lui-même.
Rêveurs rêvés de Ruth Beckermann
D’où vient que ce film dégage une telle émotion ?
Du texte qui nous est présenté, la correspondance entre Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Des lettres d’amour entre ces deux écrivains, le poète juif autrichien et la femme de lettres. Des lettres de passion. Mais aussi des lettres de séparation, d’éloignement. Séparation dans l’espace, lui à Paris, elle à Vienne, pour la majeure partie de cette correspondance. Mais aussi éloignement de leur vie, qui chacune suit son cours particulier. Vont-ils se retrouver ? peuvent-ils se retrouver ? Toute la tension qui émane de ces lettres tient dans la distance qu’il y a entre eux. Et il faut bien sûr entendre le mot distance dans tous ses sens. Une distance qui ne pourra que s’accroître au fil du temps. De longues années, plus de vingt ans. Mais une distance qui ne pourra les séparer complètement. Jusqu’à leur mort.
Et par le jeu de leur diction – la perfection de la diction – nous entrons dans cette vie, dans cet amour, dans le désir de la rencontre, dans la souffrance de la séparation et les incompréhensions qu’elle suscite.
Où sont nos amoureuses ? de Robin Hunzinger.
Le destin de deux femmes. Retracer le destin de deux femmes nées dans les premières années du XX° siècle. Raconter leur rencontre, leurs études, leur amour, leur séparation. Rechercher des documents, lettres et journaux intimes, des photos et films familiaux, des archives historiques aussi. Retrouver les faits, les commenter, les mettre en perspective, avec la grande Histoire.
Deux jeunes femmes libres, modernes, cultivées, passionnées et passionnantes. Leur vie, pendant l’entre-deux guerres, auraient pu être une réussite exemplaire, exemplaire de liberté et de bonheur. Mais les difficultés professionnelles (enseignantes elles ne sont pas nommées dans la même ville et doivent attendre les vacances pour se retrouver). Mais les désirs aussi, différents (Emma a un amant, ce que Thérèse accepte tout à fait, mais lorsqu’elle se marie, c’est la rupture).
Pendant la guerre, la seconde, l’une s’engage, l’autre pas. Le film devient alors un hommage à Thérèse, cheffe d’un réseau de résistants en Bretagne. Arrêtée par la Gestapo, elle mourra sous la torture. Sans avoir parlé.
Une grande partie du film, pourtant, faisait la plus grande place à Emma, le récit étant plutôt rédigé de son point de vue (puisque les lettres qui ont été retrouvées sont les siennes, et de même pour ses deux journaux intimes). Le récit, en voix off, est écrit en première personne (c’est celui de la propre fille d’Emma). Il comporte de longs extraits des lettres et des journaux où Emma parle de sa vie mais aussi de sa relation avec Thérèse. Une relation qui deviendra difficile. Mais qui restera comme illuminé par leur amour. Le film ne prononce pas le mot homosexualité, volonté sans doute de respecter le voile de pudeur que l’époque mettait sur cette relation. Mais tant de choses sont dites avec franchise, avec poésie aussi.
Vers la tendresse d’ Alice Diop.
Un film sur l’amour, ou plus exactement sur la place que peut avoir le sentiment dans les relations entre garçons et filles au sein des quartiers de banlieue. Pour en rendre compte, la cinéaste donne tout simplement la parole à un petit groupe de ces banlieusards, tous d’origine immigrée, noirs ou maghrébins. Un dispositif tout simple donc, des gros plans sur le visage de ceux qui nous parlent et qu’on entend en voix off. Mais ce qui n’est certainement pas si simple, c’est d’avoir réussi à recueillir une parole sincère, authentique, qui tombe bien sûr souvent dans les clichés faciles, attendus, mais qui, pour cela même, s’inscrit au plus profond d’un vécu que le cinéma (comme la télévision plus systématiquement encore) a souvent tendance à ignorer ou à regarder de haut. Ici nous sommes strictement en face du réel avec ce langage cru, direct, qui ne peut que heurter les bonnes mœurs ou les conventions de ceux qui ne vivent pas dans ce monde.
Le film est construit en quatre épisodes, quatre situations, quatre discours constituant la progression annoncée dans le titre. On part du degré zéro du sentiment pour découvrir in fine un couple amoureux, filmé dans une chambre d’hôtel, disant simplement que l’amour existe. Et ils le vivent vraiment cet amour fait de baisers et de caresses tendres, cet amour totalement inconnu du premier interlocuteur de la cinéaste, celui pour qui toutes les filles, « faciles », sont des salopes, puisque lui aussi n’est qu’un salaud. Dans la banlieue on ne parle pas d’amour. C’est quelque chose sans doute réservé « aux blancs », « parce que leurs parents leur ont montré ». Lui, il n’a jamais vu son père embrasser sa mère. « L’amour tu le vois pas chez les africains ». Entre ces deux extrêmes on aura suivi le groupe de « mecs » dans une virée à Amsterdam, dans le quartier des filles en vitrine, et on aura fait la rencontre d’un homosexuel, filmé le plus souvent de dos dans une longue marche (sauf dans le RER qui le conduit à Paris). Pour lui l’enjeu semble essentiellement de ne pas être considéré comme un « pédé », de rester un homme, car le pédé lui, n’est plus rien.
Une histoire d’amour sous l’occupation italienne d’Audrey Gordon
De façon très classique, le film raconte une histoire personnelle insérée dans la grande Histoire, une histoire d’amour qui renvoie à une histoire de guerre.
L’histoire personnelle est celle de la relation amoureuse entre un officier de l’armée italienne, Federico, et une jeune réfugiée juive, Rima.
La grande Histoire, c’est celle de la seconde guerre mondiale, vue du côté italien, depuis la déclaration de guerre contre la France par Mussolini et l’occupation d’une partie de la France par l’armée italienne.
En accord avec la relation entre un officier italien et une jeune juive, le film va aborder la guerre en se centrant sur la politique italienne vis à vis des juifs. Il insiste fortement sur le refus de l’Italie de « donner » les juifs aux allemands. Ils seront, simplement si l’on peut dire, assignés à résidence. Même sous Mussolini, il y va de l’honneur de l’Italie !
Le film utilise deux sortes d’archives. Les archives familiales racontent l’histoire personnelle. Ce sont essentiellement des images photographiques des personnages. En second lieu des archives, le plus souvent cinématographiques, que l’on peut qualifier d’historiques, retracent le déroulement de la guerre, discours du Duce, mouvements de troupes, scènes de batailles, etc. On passe des unes aux autres sans aucune marque de transition. Une savante alternance mise en œuvre par un montage très fluide.
On vit d’amour de Silvano Agosti.
On vit d’amour. Une belle formule. Tellement limpide. On ne peut pas vivre sans amour, comme l’ont bien noté tous les psy qui se sont penchés sur le berceau du nourrisson. Du lait, oui, il en faut au nouveau-né humain. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il qu’il soit aimé. Sans quoi, il finira par dépérir.
Que le film de Silvano Agosti commence par une séquence d’allaitement d’un nourrisson n’est donc pas dû au hasard. D’entrée de jeu, le cinéaste, par un cadrage serré sur le visage, la bouche même, du bébé qui tète, donne le ton de son film. La mère raconte son accouchement et le moment magique où l’enfant qui vient de naître est déposé sur son ventre. Une image du bonheur.
Pourtant, le film ne va pas du tout développer cette image du bonheur. Bien au contraire.
C’est que l’idée d’amour renvoie inévitablement à la sexualité. Et là, les choses se gâtent la plupart du temps.
Existe-t-il – peut-il existe – une sexualité heureuse ? A suivre les portraits que dresse le film, on pourrait en douter.
La faute en est à la société, à ses interdits, à ses tabous, au rejet de la différence, à cette éducation rigoriste de l’Italie catholique. Agosti filme un garçon de neuf ans qui condamne sans concession l’école qui est une cage. L’école pour lui, c’est tout le contraire de la vie. Il accuse aussi les adultes (tous les adultes) qui ne considèrent pas les enfants comme des êtres humains à part entière. Une revendication de liberté qui doit se concrétiser dans la vie amoureuse.
Les autres portraits du film sont tous plus pathétiques les uns que les autres. Cette femme d’abord, jeune et souriante au début du film, mais dont le visage se transforme très vite dès qu’elle est appelée à évoquer sa sexualité. Une sexualité qu’elle n’arrive pas à vivre. Une vie sans plaisir donc, son éducation la renvoyant systématiquement à l’impureté, le lui a à jamais interdit. La séquence se termine par un aveu. « Je suis la fille d’un prêtre ». Un vrai prêtre, demande le cinéaste incrédule. Un vrai prêtre répond-elle simplement.
On vit d’amour, un film sans concession, un film de combat, de révolte. Un film qui revendique la liberté sexuelle pour tous.
Tous nos vœux de bonheur de Céline Dréan.
C’est un film sur l’amour. L’amour d’un couple. Un couple qui a dû se battre pour pouvoir s’aimer. Pour pouvoir se marier. Un mariage d’ailleurs qui eut lieu presque dans la clandestinité. Il y a 50 ans. A voir ce couple aujourd’hui – un couple qui s’aime toujours autant – on se dit que, malgré la difficulté, ils ont triomphé de l’adversité, surmonté tous les obstacles. Pour vivre heureux. Toute une vie de couple heureux.
Le prétexte du film – un film familial, réalisé par une des filles du couple – c’est un album de photos, où sont soigneusement rangées les clichés, en noir et blanc, de l’époque de leur rencontre et de leur mariage. Et de leur vie de jeunes mariés. Une vie de travail en usine, engagée auprès des travailleurs. Un album qu’ils n’ont pas regardé depuis longtemps. Qu’ils n’ont jamais montré à leurs filles. C’est que cet album dit tout de leur vie, de leur jeunesse, de leur mariage. Un album qui renferme le secret de leur vie. Un secret qu’ils n’ont pas révélé jusqu’à présent – même pas, surtout pas, à leurs filles. Mais ce secret n’est plus aujourd’hui quelque chose de dangereux. Il est devenu anodin. Comme leur vie de couple. Un couple tout ce qu’il y a de plus « normal » en somme. Même si cela n’a pas toujours été le cas.
L’album révèle donc ce qui a été caché pendant si longtemps. Les photos les montrent, lui en soutane et elle en robe de religieuse. Ils sont en effet rentrés dans les ordres, confiant leur vie à leur religion. Une vie qui se devait d’être une vie de célibataires.
Mais l’amour a été le plus fort. Même s’il leur a fallu se battre, lutter pour imposer leur rupture d’avec la religion, s’opposer à la hiérarchie religieuse, aux qu’en dira-t-on de leur entourage. Et s’opposer – ce fut le plus dur – à leurs propres parents.
Et pour ne pas conclure, l’amour exceptionnel, l’amour comme œuvre d’art.
The Ballad of Genesis and lady Jaye, Marie Losier.
Contrairement à ce que peut laisser croire son titre, Marie Losier n’a pas réalisé un film musical. Car, si la musique est bien présente dans son film, si la star qu’elle filme a bien quelque chose d’exceptionnel, si sa carrière musicale est bien hors du commun, ce n’est pas au fond cela le sujet du film. The ballad of Genesis and Lady Jaye n’est pas un film musical. Ce n’est pas un film sur le musicien Genesis P-Orridge. C’est un film sur un couple, sur leur amour, un amour qui ne connaît pas de limite et qui aura un destin unique.
Le musicien c’est Genesis P-Orridge, figure mythique de la scène musicale londonienne puis new-yorkaise, fondateur des groupes Throbbing Gristle en 1975 et Psychic TV en 1981. Elle, c’est Lady Jaye, qui sera sa partenaire dans leurs « performances » artistiques. Que leur rencontre dans les années 2000 soit un coup de foudre, c’est peu dire. Ils se marient aussitôt et là où d’autres concrétisent leur union dans des enfants, ils vont imaginer un projet inouï, totalement stupéfiant : se transformer dans leur corps pour devenir chacun identique à l’autre. « Au lieu d’avoir des enfants qui sont la combinaison de deux personnes en une, on s’est dit qu’on pouvait se transformer en une nouvelle personne ». Et c’est ce qu’ils vont entreprendre. Le film retrace cette aventure à deux où, à coup de multiples opérations de chirurgie esthétique, ils vivent cette « pandrogynie », concept qu’ils ont inventé, mais qui ne reste pas une pure abstraction.
Genesis P-Orridge et Lady Jaye, leur vie, leur couple, leur amour, ils en font une œuvre d’art. Le film qui leur est consacré ne pouvait vraiment pas avoir une forme traditionnelle. La Ballad est donc tout autant un film expérimental qu’un documentaire, une œuvre qui s’inscrit dans l’esprit de leur musique et de leur art. La caméra virevolte sans arrêt autour des personnages. De toute façon, eux-mêmes ne tiennent jamais en place. Les éléments biographiques sont abordés dans le plus grand désordre. Mais ce n’était pas une logique linéaire qui pouvait au mieux rendre compte des méandres de leur vie. L’hommage très empathique rendu aux deux artistes ne pouvait que rechercher l’effervescence, la profusion, le trop plein proche du chaos. Reste que l’émotion n’en est pas absente. La séquence de la fin du film où la caméra subjective accompagne le récit par Génésis de la mort de Lady Jaye, tout en refaisant le trajet de la chambre à la salle de bain où il la trouva sans vie prend une véritable dimension universelle. Dans un film qui peut être perçu comme s’adressant uniquement à l’underground new-yorkais, ce n’est pas rien.
Références
Une jeunesse amoureuse. François Caillat, 2012, 105 minutes.
Jaurès. Vincent Dieutre. 2012, 82 minutes.
Fragments d’un parcours amoureux. Chloé Barreau, 2023, 98 minutes.
Un amour d’été. Jean-François Lesage, Canada, 2015, 63 minutes.
Amour rue de Lappe. Denis Gheerbrant, 1984, 60 minutes.
800 kilomètres de différence. Claire Simon, 2001, 78 minutes.
Un peu, beaucoup, passionnément. Fabienne Abramovich, Suisse,2016, 77 minutes.
Une histoire d’amour. Astrid Adverbe et Boris Lehman, Belgique, 2021, 27 minutes.
La mémoire éternelle. Maité Alberdi, Chili, 2023, 85 minutes.
A demain mon amour. Basile Carré-Agostini, 2021, 92 minutes.
Mon cœur voit la vie en noir – un amour à Kaboul. Helga Reidemeister, Allemagne, 2009, 87 minutes.
Rêveurs rêvés. Ruth Beckermann, Autriche, 2016, 89 minutes
Une histoire d’amour sous l’occupation italienne. Audrey Gordon, France-Italie, 2021, 52 minutes.
Vers la tendresse. Alice Diop, 2015, 38 minutes.
On vit d’amour. Silvano Agosti, Italie, 1984, 93 minutes.
Tous nos vœux de bonheur. Céline Dréan, 2019, 52 minutes.
The Ballad of Genesis and lady Jaye, Marie Losier, France, 2011, 67 minutes.