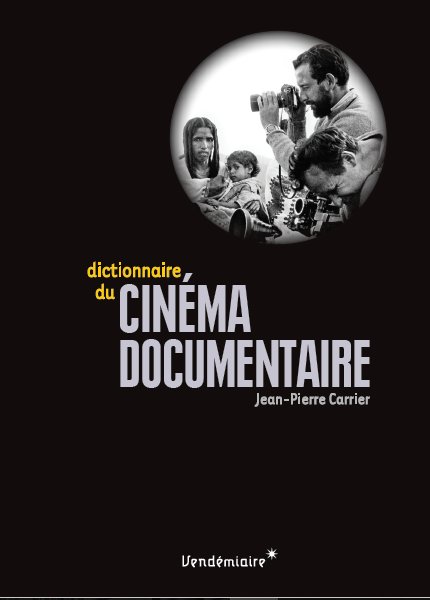1 Quelle est l’origine du film ?
Tout a commencé en 2020 par un coup de fil, presque anodin. Je souhaitais interroger la mémoire de la guerre d’Algérie dans un nouveau film (vaste thème, c’est sûr)… Je lançais des pistes, au gré de mes contacts. Christophe Lafaye est un historien et archiviste que je connais par mes années de travail en Afghanistan.
Il m’a alors raconté l’objet de ses dernières recherches : l’usage d’armes chimiques (interdites) par l’armée française durant la guerre d’Algérie. J’étais dubitative : le fait historique me paraissait trop énorme pour avoir été gardé secret durant soixante ans. Un crime colonial jamais documenté ? Je suis allée faire des recherches, j’ai fouillé les témoignages à compte d’auteur, des archives cinématographiques, des films de propagande militaire, la presse française et algérienne… Christophe Lafaye m’a ouvert l’ensemble de ses travaux, j’ai plongé dans des milliers de documents administratifs et j’ai trouvé ça fou. Fou que personne ne sache ça. Fou que Christophe Lafaye soit seul à effectuer ce travail dantesque.
Ses recherches sont cruciales pour que nos livres d’Histoire gardent la juste trace de notre passé. Ce film, né d’une envie, est devenu, pour moi, une obligation. Il a fallu cinq ans pour en voir l’aboutissement.
2 Comment a-t-il été produit ?
Je craignais que les rares acteurs et témoins d’accord pour s’exprimer, décèdent. J’ai donc commencé le repérage et le tournage très vite, quelques mois plus tard, avec le chef-opérateur Olivier Jobard. Nous nous sommes d’abord rendus un peu partout en France, à la rencontre d’anciens combattants français, pour la plupart retrouvés par Christophe Lafaye. J’ai pu financer cette première étape de recherches et de tournage grâce à la publication d’une longue enquête que j’ai écrite pour la revue XXI. Il m’était impensable de réaliser le film sans donner la parole aux Algériens, sans aller en Algérie. J’en ai parlé à Luc Martin-Gousset (Solent) qui a été emballé par le projet et l’a produit. Avec son aide, j’ai écrit et développé un dossier et France Télévisions et la Radio Télévision Suisse ont acheté le film. Ce dernier a aussi été financé grâce aux aides de la région Bourgogne-Franche-comté, du CNC et de la Procirep. Durant tout ce temps de travail, Raphaëlle Branche, l’historienne, a été d’un grand soutien… Une fois le film financé, j’ai enfin eu les moyens d’organiser un repérage et un tournage en Algérie. Grâce aux localisations militaires listées et converties par Christophe Lafaye et à l’appui de quelques articles de presse algérien, j’ai déterminé des lieux d’usage des gaz. J’ai choisi de concentrer les recherches dans deux régions: les Aurès et la Kabylie, où avaient combattu les soldats français que nous avions filmés avec Olivier Jobard. El 2023, la chercheuse et documentaliste Saphia Arezki est partie effectuer seule le repérage en Algérie. J’étais en ligne avec elle sur WhatsApp, depuis la France. Saphia a sillonné les alentours des lieux identifiés et a creusé la mémoire de villageois pour retrouver des survivants. Quelques mois plus tard, lorsque nous sommes venus pour filmer en Kabylie, il était presque trop tard : une femme et son mari, deux anciens combattants qui devaient témoigner, n’en avaient plus la force. Les villageois d’Aït Myslaiène m’ont mise en relation avec d’autres anciens combattants – les derniers – et des proches, que nous avons filmés. Dans les Aurès, comme la grotte était physiquement accessible, j’ai tenu à filmer les victimes algériennes sur les lieux du crime.
3 Comment avez-vous organisé le va-et-vient entre les archives et les témoignages directs ?
Au fond, j’aurais pu (et aimé) faire un film pour chaque personnage, tant l’empreinte des armes chimiques est singulière, propre à chacun, qu’ils soient Algériens ou Français. Mais je voulais faire un film documentaire qui soit vu sur une chaîne de télévision. Il devait être un exercice par la preuve qui rendre implacable le récit de ce crime colonial et propose une vue d’ensemble. Je l’ai donc écrit comme un rendu d’enquête le plus sobre possible.
J’ai choisi d’énoncer les faits en ouverture et prendre le temps du film pour les démontrer. La narration s’appuie sur une trame principale simple : un déroulé chronologique des grandes lignes de la guerre décoloniale, en y inscrivant l’usage des armes chimiques. Le va-et-vient entre témoignages et archives vient de là. Les archives m’ont servi de marqueurs temporels, comme des chapitrages pour assembler, clarifier, ranger. Il me semblait indispensable de montrer la prise de décision politique initiale, d’éclairer la tactique militaire et les moyens techniques pour que la parole des témoins ne souffre aucune remise en question. D’autant que les Algériens que j’ai rencontrés ne connaissaient pas cette guerre chimique. Certains appelés français n’en savaient d’ailleurs pas beaucoup plus.
J’ai choisi le film choral car la multiplicité des personnages témoigne du recoupement des sources et de l’ampleur du crime colonial. La pluralité permet aussi de regarder l’usage des armes chimiques depuis la place de chacun : victimes, auteurs et personnes ultra spécialisées dans le domaine. Pour chaque période, chacun pouvait parler d’une expérience singulière et apporter une pièce au puzzle. Ils se complètent et entrent en résonance.
Un personnage est symbolique : il est né de la lecture des comptes-rendus d’opérations militaires écrits par un grand nombre de jeunes appelés (et engagés) français qui ont participé aux « opérations de grottes ». Avec Yann Coquart, le monteur, qui a une vaste expérience des films d’archives, nous avons réussi à tisser la narration générale, les interventions des personnages et donner chair au personnage symbolique. Je tenais à une progression émotionnelle qui devait s’adapter à la montée en puissance historique de la guerre. Plus nos personnages plongent dans les grottes, plus les armes chimiques prennent de l’ampleur. Pour faire exister le personnage symbolique, j’ai proposé à un ancien combattant français de lire un de ces « journaux de marche » qu’il avait conservé. Puis la voix d’un comédien a pris le relais dans la lecture des morceaux choisis d’opérations de grottes. Les mots techniques sont froids. Quand on les écoute, c’est le hors-champ qui relie aux personnages : on attend le vivant.
Parfois de petits détails, notamment au son, permettent les va-et-vient : le silence d’un homme et d’un paysage, la régularité d’une pale d’hélicoptère et celle d’une horloge – montés avec justesse par Yann Coquart. Les regards aident aussi le va-et-vient entre personnes et archives. La musique utilisée sur les cartes de l’Algérie, fait parfois le lien, c’est le symbole du fait colonial dans son ampleur géographique. Ou encore, un détail informatif peut faire le lien narratif : un personnage décrit le gaz, les archives viennent prouver et expliquer ses dires.
4 Vous pratiquez l’enquête documentaire. Quels en sont les grands principes ?
Tout dépend du thème que l’on souhaite aborder, de la place qu’on choisit en tant qu’auteur réalisateur et du cadre posé par la diffusion. Mais quelle que soit la forme du film d’enquête, je m’appuie toujours sur des lectures : travaux d’historiens, de sociologues, de journalistes, de romancier. J’adore la non-fiction littéraire. Je m’inspire de films documentaires et de fiction. J’en profite pour combler mes lacunes de culture. Ça, c’est pour le cadre général. Mon centre d’intérêt est vaste : le post-conflits, les après-guerres et leurs conséquences. Pour reprendre les mots si justes que j’ai entendu de Mohamed el Khatib, « un film répare quelque chose » ; pour moi c’est une forme de réparation.
Pour entrer dans la technique, dans la précision des faits lors d’une enquête, je cherche autant que possible des gens qui ont vu et/ou fait directement. Des témoins en vie, ou leurs récits à la première personne. Sinon je questionne les proches, pour mettre en lumière ce qui a été transmis ou tu. J’aime la question de la « rumeur » quand elle est traitée comme telle, pour en peler les couches, comme un oignon. C’est exactement l’objet d’un nouveau projet, dans lequel je tente de filmer le processus d’enquête. Cela me fascine le plus car il éclaire les rumeurs, la mémoire, l’oubli autour d’un passé violent.
En général, je creuse la mémoire d’un lieu, dans les archives des journaux régionaux ou les archives administratives. Je tente ensuite de recouper les éléments importants ou étonnants, au maximum. Vérification des dates, des noms de lieux, des noms de témoins potentiels. Avoir plusieurs sources pour un même élément. Je me fais aider par des spécialistes, autant que possible.
Pour les anciens combattants français d’Algérie, Sections Armes Spéciales, j’ai demandé à Christophe Lafaye s’il pouvait retrouver leurs traces administratives. Ce qu’il a réussi à faire. J’ai demandé à tous de présenter les documents qu’ils avaient conservés, autant pour leur valeur mémorielle, familiale et intime que pour la preuve.
C’est le premier film d’Histoire que j’ai réalisé avec un usage central des documents administratifs écrits. C’était un exercice d’apprentissage et j’ai retrouvé ce que j’avais appris à l’université lorsque j’étudiais l’Histoire : plonger dans une masse de données, en saisir l’essentiel et le hors-champ et recouper les éléments intrigants pour les mettre en récit. Comme la mémoire des personnages, les archives font défaut. Elles sont évidemment partiales. Il faut donc recouper, au maximum, les éléments découverts avec plusieurs sources.
Et puis, c’est l’essence même du documentaire : porter un regard singulier sur des faits indiscutables.
En bref, pour faire une enquête, je trouve utile d’être obsessionnelle.