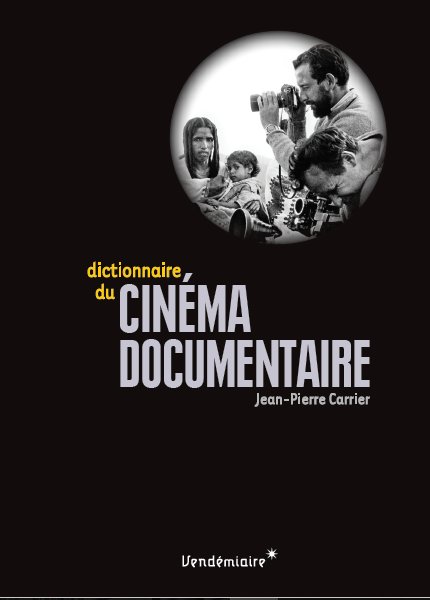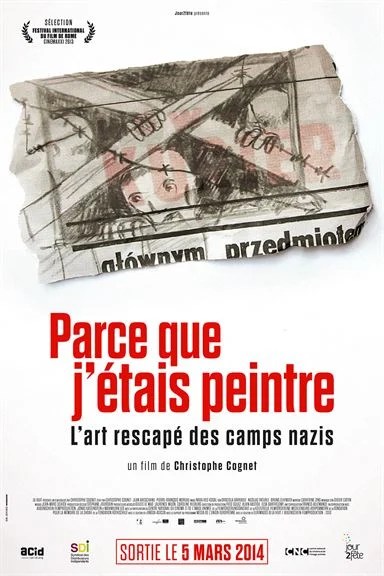Parce que j’étais peintre. L’art rescapé des camps nazis. Christophe Cognet. France-Allemagne, 2013, 104 minutes.
A Auschwitz-Birkenau ont été retrouvés, presque par hasard, des carnets où des membres des Sonderkommando (ces déportés sélectionnés pour « nettoyer » les chambres à gaz et les fours crématoires) consignaient au jour le jour les modalités de mise en œuvre de la solution finale dont ils étaient les témoins avant d’être eux-mêmes exterminés. De la même façon on a pu retrouver dans un grand nombre de camps, des dessins réalisés eux-aussi clandestinement par eux qui étaient en attente de la mort. Une manière exceptionnelle pour nous aujourd’hui d’appréhender par l’image la vie dans les camps de la mort.

Le film de Christophe Cognet a pour premier intérêt de nous donner à voir ces dessins. Filmés en plans fixes, plein cadre, ils ne sont accompagnés d’aucune musique, d’aucun commentaire. Seul un carton introductif précise le nom de l’auteur lorsqu’il est connu et le lieu de réalisation. De la sorte, le film ne les réduit aucunement à une fonction illustrative. Nous pouvons les voir pour ce qu’ils sont vraiment : une expression par les moyens de l’art d’une souffrance en soi inimaginable. Ce que soulignent, par contraste, les plans qui montrent les restes des camps, transformés aujourd’hui en lieux de mémoire ouverts au recueillement des visiteurs. Des plans de baraquements, filmés le plus souvent au printemps, au milieu de la verdure environnante.

Cognet a retrouvé les derniers survivants parmi les auteurs de ces œuvres. Il rencontre également les responsables de mémoriaux ou des musées dans les camps qui les conservent. Une enquête rigoureuse pour essayer de répondre aux multiples questions qu’elles soulèvent, et pour lesquelles il n’y a sans doute pas de réponse définitive.
Et d’abord, comment était-il possible de réaliser de tels travaux d’expression au milieu de l’horreur des camps. A cette première question deux types de réponses peuvent être apportées. La première consiste à dire que ces dessins étaient pour ceux qui les réalisaient des témoignages à destination des générations futures, des traces concrètes de l’horreur vécue, ce qui explique en particulier leur recherche minutieuse du détail et leur précision. D’ailleurs, certains de ces dessins et des tableaux peints ont été réalisés après la libération des camps, de mémoire donc, justement pour que ces souvenirs ne tombent dans l’oubli.

Mais il y a une deuxième réponse que formulent avec force certains de ces artistes. Car justement, ils se considèrent comme des artistes, ayant fait œuvre artistique dans leur internement comme dans les autres périodes de leur vie. C’est parce qu’ils étaient artistes avant le camp qu’ils le sont resté dans le camp. Comment mieux signifier « la nécessité intérieure » de l’art ? Et l’on sent bien que le film penche dans cette direction, affirmant qu’il faut considérer ces dessins comme de véritables œuvres d’art et pas seulement comme des témoignages en image.

Mais dans ces conditions une deuxième question apparaît, concernant la dimension esthétique de ces œuvres. Est-il possible de parler de leur beauté alors même qu’elles mettent en scène le mal absolu ? La question se pose sans doute encore plus frontalement à propos des tableaux, des sculptures réalisées loin des camps dans la paix retrouvées. L’horreur peut-elle être belle ? En évoquant un certain nombre d’artistes, Goya par exemple, le cinéaste prend position. Si l’on doit considérer ces œuvres montrant l’enfer, comme de l’art, alors il faut affirmer leur beauté, si choquante qu’en puisse paraître au premier abord l’idée même. Ce n’est pas dire que l’enfer en soi est beau. C’est plutôt affirmer que l’art peut l’aborder au-delà de sa réalité, qu’il rend par-là définitivement inacceptable. C’est la force de ce film tout en nuances, de nous conduire sur la voie de cette réflexion.