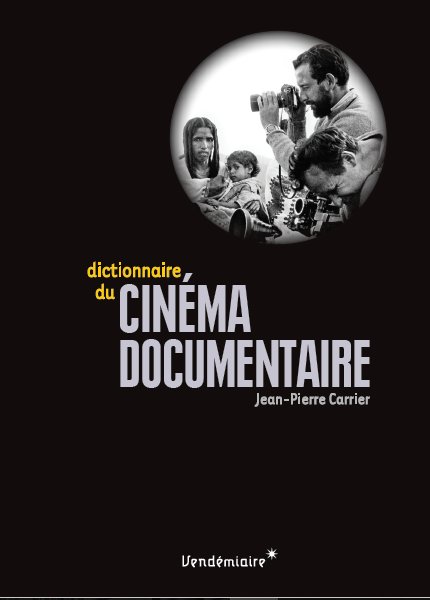Pour quelles raisons un cinéaste décide-t-il de faire un film sur la drogue, un film qui parle de la drogue, un film qui montre la drogue et sa consommation ?
Serait-il lui-même un consommateur ? Peut-être pas. Mais peut-on éviter de penser qu’il connait la drogue de près, d’une façon ou d’une autre. Qu’il connait, qu’il fréquente, des consommateurs ? Un proche, un ami, un membre de sa famille ?
Et effectivement, les documentaires sur la drogue – comme ceux d’ailleurs concernant d’autres addictions – nous permettent de rencontrer des drogués, de les fréquenter le temps d’un film, de les comprendre, ou du moins d’essayer. Si possible sans juger, sans condamner a priori.
Reste pourtant le rejet nécessaire du trafic, du petit dealer au grand banditisme. Une condamnation sans appel.
Le trafic et sa répression.
Stups de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet
Palais de justice de Marseille, audience en comparution immédiate. Sont jugés des membres du réseau de trafic de drogue. Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, des guetteurs, des dealers, une « nourrice », de petites mains et de gros bonnets. Tous seront reconnus coupables et condamnés. Des peines de prison, le plus souvent entre 6 et 8 mois fermes. La justice fait son métier. Mais la lutte contre le trafic est sans fin.
Le film d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet nous plonge au cœur de ce défi immense : faire respecter la loi quand la drogue est partout dans les cités, des quartiers entiers. Une tâche qui semble presque dérisoire. Que deviendront ces trafiquants une fois leur peine purgée. Même s’il leur est interdit de revenir à Marseille, auront-ils les moyens de fuir ce monde de l’argent facile ? Pourront-ils échapper à la loi du milieu ?
Le film se focalise sur le travail du juge. Un juge unique devant lequel sont traduits, les uns après les autres, presque à la chaîne, ces personnages qui essaient de défendre leurs causes, de se trouver des excuses en niant les faits contre toute évidence, cherchant à apitoyer le juge sur leurs conditions de vie, leurs difficultés insupportables, leurs galères. Certains reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, mais ils essaient quand même de se présenter comme innocents. Ou du moins, ils font tout pour minimiser leur faute. S’ils ont enfreint la loi, ils le regrettent et les plus jeunes sont prêts à jurer qu’ils ne recommenceront pas, qu’ils regrettent leurs actes et qu’ils vont retrouver le droit chemin. Sont-ils sincères ? A l’évidence ils ne jouent pas tous leur rôle avec la même efficacité. Et les avocats ont parfois du mal à être eux aussi convaincants.
Dans cette succession de situations plus effrayantes les unes que les autres, le juge effectue sa tâche avec un calme à toute épreuve. Il rappelle les faits, s’appuyant sur les enquêtes de police et essayant par ses questions d’obtenir des précisions, démasquant avec une grande rigueur les contradictions des accusés. En même temps il écoute semble-t-il avec une grande ouverture d’esprit la description de l’Intérieur des conditions de vie invraisemblables qui ne laisse aux jeunes aucune chance de s’en sortir. Mais il sait parfaitement ne pas se laisser impressionner. La pitié ne fait pas partie de l’exercice de la justice.
Après une suspension d’audience pour délibération, le juge proclame le verdict, les condamnations. Certains condamnés paraissent presque stupéfaits. Ont-ils cru qu’ils pouvaient échapper à la prison. L’un d’eux laisse éclater sa colère, insultant le juge et la justice.
Une dernière séquence, plus courte, se déroule dans un tribunal pour mineurs. Les propos de la juge nous renvoient directement au dilemme qui est celui de toute justice : doit-elle être uniquement répressive ? Et les moyens pédagogiques dont elle dispose peuvent-ils être efficaces pour éviter les récidives. Lorsqu’il il faut protéger la société peut-elle prendre en compte les conditions de vie particulières de chaque accusé.
En Chine
Paper Airplane de Zhao Liang. Chine
Un avion en papier, ça peut voler très haut, mais il ne vole jamais longtemps. Il finit toujours par tomber. Et il ne vole qu’une seule fois. « Quel prix il paie pour cette seule chance de voler ». Sur son lit d’hôpital, un des jeunes drogués que suit Zhao Liang propose ce titre pour le film. Une métaphore particulièrement parlante de l’expérience de la drogue.
Zhao Liang a suivi pendant deux ans un groupe de jeunes drogués, presque au jour le jour, dans le plus secret de leur intimité. Inscrivant les dates sur l’écran au fur et à mesure du déroulement du temps, le film n’est pas un simple portrait de drogués. Il vise à rendre compte dans la durée de leur vécu, leurs difficultés, leurs espoirs, leurs souffrances, leur déchéance. Il les filme quand ils se piquent dans une minuscule pièce meublée d’un simple lit. Il les filme quand ils font chauffer la poudre pour pouvoir la sniffer. Il filme tout cela en gros plan, comme s’il faisait partie de l’un d’eux. D’ailleurs, quand dans un bureau de la police un policier demande qui est celui-là avec sa caméra, il est présenté comme un cousin. Membre de la famille donc. Les parents eux essaient de sauver leurs enfants, leur font la morale. Lui, en tant que cinéaste, il ne dit rien. Il se contente d’enregistrer les effets de la drogue.
En Chine comme ailleurs, la drogue détruit. En Chine comme ailleurs les drogués ont du mal à se procurer leurs doses. Le film montre leurs marchandages avec les dealers, et le petit commerce de cassettes piratées qu’ils essaient de vendre dans la rue. En Chine comme ailleurs ils essaient de décrocher, promettent d’arrêter « dans quelques jours ». Le manque est insupportable, et les médicaments de substitution sont trop chers. Le quotidien de ces jeunes n’a rien de surprenant. Ils n’ont pas de travail. Ils font de la musique ; du rock bien sûr. Ils sont révoltés. Ils essaient de survivre. La société chinoise leur fait payer leur marginalité au prix fort.
Car en Chine, ce sont les consommateurs, plus que les trafiquants, qui sont dans le collimateur de la police. Un des soucis majeurs des jeunes filmés ici est d’éviter de se faire arrêter. La première fois, c’est quinze jours de prisons. La deuxième, trois mois, sans désintoxication. Après, de 18 mois à 3 ans, de rééducation par le travail. Et comme il est particulièrement difficile d’éviter les descentes de police…Le film n’a rien de particulièrement optimiste !
Filmer comme le fait Zhao Liang le monde de la drogue au plus près du vécu des drogués est chose assez rare dans le cinéma documentaire, contrairement aux films de fiction. Qu’il s’agisse d’un film chinois n’ajoute pas d’exotisme particulier à la réalité de la drogue. La seule solution officielle se situe ici du côté de la répression. Est-ce bien différent ailleurs ?
Aux Philippines
Aswang. Alyx Ayn Arumpac, Philippines-France, 2019, 84 minutes.
Un film de mort. De mort violente. Par assassinat. Dans les rues, la nuit. Au matin on retrouve les cadavres sur les trottoirs. Une véritable hécatombe. Dans les quartiers pauvres surtout. Les bidonvilles de Manille.
Ce sont ceux qui consomment de la drogue qui sont ainsi exécutés. Sans jugement bien sûr. La justice est totalement hors circuit. La police aussi. A moins qu’elle soit directement concernée par ces meurtres.
Cette vague de morts est la conséquence de la politique de lutte contre le trafic de drogue, instaurée par le Président Duterte. Mais ce sont les pauvres qui en pâtissent. Les gros bonnets eux ne sont nullement inquiétés.
Le film nous plonge au cœur de ce pays de plus en plus marqué par cette vague de violence. La découverte des cadavres, les scènes d’enterrements sommaires, la douleur des familles et des proches et les cérémonies religieuses dans des églises bondées. Jusqu’à cette immense manifestation contre Duterte et sa politique. Des défilés gigantesques pour demander justice. Et la nuit, aux flambeaux, ce peuple en colère brule des caricatures du président tout en demandant la fin du capitalisme.
Un film de chaos, social et humain. Il montre un pays ravagé par cette violence aveugle et généralisé engendrée par la présence de la drogue. Les seuls moments de calme sont ceux qui montrent un homme qui se recueille un court instant dans une chapelle.
Aswang, le titre du film évoque une créature maléfique qui hante la ville depuis sa création. Les humains sont sa proie « Il tue tous ceux qui osent regarder derrière eux ». Une métaphore bien sûr.
Il n’y a dans le film guère de signe d’espoir, malgré la religion, malgré les manifestations. Il reste le cinéma : montrer pour dénoncer.
Des consommateurs. Portraits.
Dans unesalle de shoot
Ici je vais pas mourir d’Edie Laconi et Cécile Dumas.
Un couloir qui mène à une porte de sortie. Ceux qui l’empruntent, nous ne les voyons que de dos. Mais nous avons fait leur rencontre auparavant. Ils nous quittent. Ils quittent le lieu où nous les avons rencontrés. Pour regagner la ville. Les rues de la ville. Rarement un chez soi. Reviendront-ils ? Sont-ils obligés de partir ? Leur séjour ici n’a-t-il été qu’une parenthèse ? Une simple parenthèse.
Ici, c’est une salle de shoot, installée dans un hôpital parisien. Un lieu ouvert aux drogués qui peuvent venir consommer en toute sécurité, ou presque. Nous y resterons tout le film. Comme enfermés. Seul plan de l’extérieur, une façade d’un immeuble qu’on imagine voisin. Il affiche, bien visible sur fond jaune, cette revendication : «non aux salles de shoot en quartier résidentiel.» Mais les relations avec le voisinage ne fait à l’évidence aucunement partie des préoccupations des usagers de ladite salle.
Ces usagers, qui sont-ils ? Et pourquoi viennent-ils là. La majorité d’entre eux ont accepté de parler à visage découvert, face à la caméra. Mais comme le dit l’un deux, il y a peu de chance que sa famille voit un jour le documentaire. Peu importe leur motivation. On sent une grande connivence avec les cinéastes dont on entend parfois les questions en off. S’ils parlent, c’est bien sûr parce qu’ils en ont besoin. Dire leur histoire, une façon d’exister. Une aide peut-être aussi. En tout cas, ils sont visiblement favorables à ce qui n’est après tout qu’une expérience.
Le film ne vise pas à défendre l’existence de ces salles. Il n’en fait pas la critique non plus. Il nous montre ce qui s’y passe, sans juger quoi que ce soit. Son intérêt c’est bien sûr de nous présenter de véritables petits portraits, le plus souvent en gros plans – parfois impressionnants – des consommateurs de drogues, leurs tentatives pour arrêter et les difficultés que cela représente. Pour la plupart, ils ne savent plus trop comment ils ont commencé. Il y a si longtemps. Ils s’arrêtent sur leurs conditions de vie. La rue pour plusieurs d’entre eux. Faire la manche leur permet d’avoir un peu d’argent. Et ils sont souvent bien organisés, comme celui-ci qui dessine son itinéraire quotidien dans les trois ou quatre rues qu’il parcourt. La solitude, ils la recherchent sans doute, mais elle finit aussi par être très pesante. Ici, dans la salle de shoot, ils trouvent un peu de relation sociale et beaucoup de chaleur humaine, que ce soit avec le personnel ou les autres usagers.
En voyant ces garçons et ces filles, presque tous jeunes, filmés avec une telle proximité et une grande sympathie, on finit presque par oublier qu’ils sont drogués, qu’ils mènent une vie de marginaux qui les exclue de la société, et que la précarité de leur existence matérielle leur ôte toute perspective d’avenir. La drogue est un enfer, et reste un enfer, même si dans cette salle des drogués peuvent un instant oublier leur souffrance. Pour un instant seulement…
Un exemple des ravages de la drogues, un artiste, un musicien, dans un milieu où la consommation est loin d’être rare, Chet Backer
Chet Baker, let’s get lost de Bruce Weber.
Chet Baker, une vie. Une vie de musique de jazz, de succès, de femmes, de drogue, de déchéance physique. Une vie mouvementée que le film retrace avec beaucoup de précision et de sincérité, mais sans jamais tomber dans l’excès, le sordide ou l’ostentatoire.
Le cinéaste est un ami de Chet, et ça se sent. Le musicien est filmé au plus près ; dans son intimité, seul ou au milieu de ses amis et de sa famille. Et lorsqu’il ne le filme pas en direct, il utilise des photos. Cette multitude de photos sont toujours filmées très rapidement, avec des mouvements de caméra leur donnant beaucoup de vie, et un montage particulièrement vif, très vivant donc. Car Bruce Weber est avant tout, avant même d’être cinéaste, photographe, un grand photographe et ça se sent à chaque plan du film.
Dès le début du film, nous assistons à une confrontation du présent et du passé. Aux images du Jeune Chet, un véritable jeune premier d’une beauté éclatante, succède l’image plus connue du Chet de la maturité, on pourrait sans doute dire aussi de la vieillesse, bien qui n’ait après tout qu’une soixantaine d’années. Une image de ce visage buriné, couvert de rides. Un visage défiguré par le souffle dans la trompette, un visage qui n’exprime plus que les effets de la drogue. Pourtant cette vie plus qu’agitée est abordée par le cinéaste avec beaucoup de pudeur. La drogue Chet n’en parle qu’à deux ou trois reprises et nous ne le voyons jamais se piquer. Il n’en reste pas moins que la drogue et condamnée de bout en bout, et n’est jamais donné comme source d’inspiration pour la musique. Elle ne peut être que source de mort.
Drogue et famille. Iona, la « grande sœur oubliée »
Celle qui manque de Rares Lenasoaie.
Elle a quitté sa famille depuis une bonne dizaine d’année. Son frère, le cinéaste, a gardé quelques liens avec elle. Plus que leurs parents. En particulier il sait où la rencontrer. Le film est le résultat de la nécessité qu’il ressent de rétablir un véritable lien avec elle.
Elle a quitté sa famille pour vivre sa vie, pour être libre, ne pas avoir de contrainte. Elle vit dans un camion, une sorte de camping-car qu’elle s’est aménagé. Elle circule un peu à son bord, de parking en parking. Le film ne détaille pas vraiment comment elle vit, comment elle arrive à vivre. On la voit simplement dans un ou deux plans découper du cuir pour faire des masques. Le reste du temps elle est filmée une seringue à la main pour s’injecter de la drogue dans le bras. Des plans longs, insistants. Peu éclairés. Sauf par la lampe frontale qu’elle a toujours sur elle, lorsqu’elle est dans son camion.
Un film sombre donc, dans sa majorité. Les plans extérieurs brisent bien cette obscurité. Mais jamais pour très longtemps. En fait, le frère et la sœur se confinent dans le camion.
Ils parlent. Le plus souvent sur un fond de radio. De la musique ou des magazines. Sur le foot par exemple. Au début du film, leurs échanges sont plutôt hésitants, superficiels, portant sur des détails matériels anodins. Puis, peu à peu, ils en viennent à aborder les vraies questions. Les questions que le frère ne peut pas ne pas se poser. Des questions que la sœur elle aussi finit par se poser.
Ils parlent de la vie qu’a choisi Iona ; de la drogue qui semble être le seul horizon de sa vie ; de l’amour et de la sexualité ; mais surtout ils parlent de leurs parents. Comment peuvent-ils accepter cette fille droguée qui les a quittés. Peuvent-ils encore avoir de l’amour pour elle ? Est-elle encore leur fille ?
Le film plonge dans le passé familial à partir d’images de leur enfance. Le frère lit à sa sœur une lettre de leur grand-mère. Une lettre en roumain, car elle, elle est restée dans leur pays d’origine. Une façon de dire que même vivants dans une grande marginalité, toutes leurs racines n’ont pas disparu.
Le monde de la drogue.
Dans la chambre de Wanda de Pedro Costa.
Le quartier cap-verdien de Fontainhas à Lisbonne est en cours de démolition. Les bulldozers réduisent en tas de gravats les vieilles maisons. Des hommes font s’écrouler des pas de mur à coup de masse. Un travail qui prend du temps. On n’en verra pas la fin dans le film. Pourtant il dure presque trois heures et le réalisateur a filmé le quartier pendant deux ans.
Fontainhas, un quartier de plus de 5000 habitants qui doivent partir ailleurs. On ne saura jamais où. Mais on les voit rassembler les quelques affaires qu’ils peuvent emporter, un peu de vaisselles, quelques vêtements. Des habitants que l’on croise dans des ruelles étroites, autour d’un feu improvisé où l’on dépose un gros chaudron. Il y a quelques enfants. Ils ne semblent pas être engagés dans des jeux. Les adultes que nous suivons dans le film, eux, s’adonnent pratiquement tous à la drogue, à toutes les drogues possibles, même les plus inimaginables.
Le cinéaste nous introduit dans une de ces habitations condamnées dont on ne voit pratiquement que la chambre. C’est là que vit Wanda. Cette Wanda, c’est Wanda Duerte, l’actrice principale du précédent film de Costa, Ossos. Ici elle joue son propre rôle. C’est-à-dire qu’elle ne joue pas. Elle vit dans sa chambre. Elle n’en sort que pour essayer de vendre des salades ou des choux aux habitants du quartier. La plupart n’achètent pas parce qu’ils n’ont pas d’argent. De toute façon Wanda sort rarement de sa chambre. Elle reste le plus souvent allongée sur son lit, bavardant de tout et de rien avec sa sœur Zita, sa compagne de dope. Elle fume sans arrêt, tousse, crache, vomit. Elle a du mal, à respirer. Peu importe. Comme tous les junkies elle ne peut pas se passer de drogue. Comme les quelques visiteurs qui viennent la voir et qu’elle essaie d’aider. « C’est la vie qu’on a voulu » dit-elle. « C’est la vie qu’on est obligé de vivre » répond le jeune noir assis devant elle.
Dans la chambre de Wanda n’est pas un film intimiste. Cette chambre est à elle seule un monde. Le monde de la drogue, mais aussi celui de la misère. Un monde que les villes modernes s’efforcent de faire disparaître de leur paysage.
Références
Stups. Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, 2024, 86 minutes.
Paper Airplane, Zhao Liang. Chine,2001, 78 minutes
Aswang. Alyx Ayn Arumpac, Philippines-France, 2019, 84 minutes.
Ici je vais pas mourir. Edie Laconi, Cécile Dumas, 2019, 70 minutes.
Chet Baker, let’s get lost. Bruce Weber, USA, 1988, 120 minutes.
Celle qui manque. Rares Lenasoaie, France, 2020, 87 minutes.
Dans la chambre de Wanda, Pedro Costa. Portugal, Allemagne-Italie-Suisse, 2001, 170 minutes.