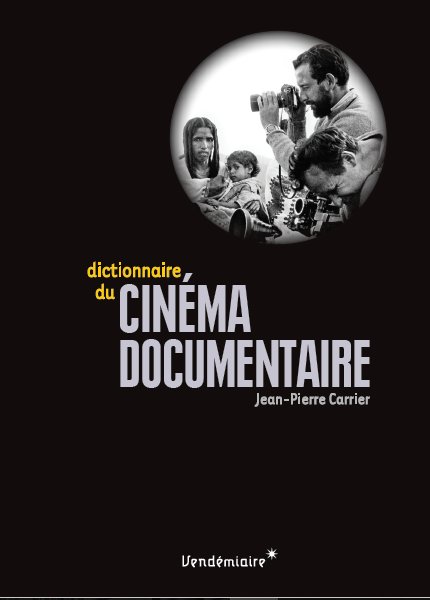3 Les deux guerres mondiales
14-18, la « grande guerre ».
Le rouge et le gris. Ernst Jünger dans la grande guerre de François Lagarde.
Un film sur la guerre. Pas n’importe quelle guerre. La « grande » guerre. La guerre qui devait être la dernière…Mais ici, la guerre d’un écrivain. Un écrivain allemand, qui nous montre la guerre du côté allemand. La guerre d’Ernst Jünger, un écrivain qui raconte sa guerre dans un livre justement célèbre, Orages d’acier, un récit au plus près du vécu des soldats, s’arrêtant sur le moindre détail de ce qu’il est devenu courant de désigner comme la vie dans les tranchés. La presque totalité de l’écrit de Jünger constitue la bande son du film de François Lagarde. Un texte lu par un comédien dont la voie, presque sans intonation particulière le plus souvent, finit cependant par s’incruster en nous et nous hanter comme si nous avions nous aussi vécu cet enfer.
Le choix de ce texte pour réaliser un film sur 14-18 un siècle après le conflit, est déjà particulièrement original. Le choix des images l’est tout autant. Sinon plus.
François Lagarde était photographe (il est disparu récemment). Patiemment, avec obstination, il a constitué pendant des décennies, une importante collection de photographies concernant la guerre de 14. Des images prises sur le terrain des opérations militaires, par des soldats allemands anonymes. Le film les montre, en noir et blanc. Il y a quand même un plan en couleur, montant des crucifix se dressant dans le paysage et quelques images sont présentées avec un filtre rouge, surtout celles renvoyant à des prises de vue actuelles. Elles sont simplement animées de lents mouvements de caméra se déplaçant de gauche à droite ou de droite à gauche, ou des zooms arrière, pour découvrir un détail, un pan de l’image qui n’était pas visible dans le premier cadrage. Mais jamais d’effets visant le spectaculaire. Il ne s’agit pas de donner l’illusion d’images animées. Des images toujours nettes, comme si elles avaient traversé le temps sans dommage (elles sont numérisées et restaurées à l’occasion), mais qui sont toutes particulièrement expressives. Un nombre important d’images (plus d’un millier dit-on) pour au final constituer un film long, de presque trois heures et demie, mais dont la force est telle qu’il ne produit aucune lassitude.
Nous sommes donc plongés au cœur de la bataille de la Somme. Des cartes avec des annotations stratégiques situent géographiquement le moindre hameau ou lieu-dit, la moindre ferme à proximité des lignes de front. Nous suivons Jünger, devenu lieutenant, au commandement de sa division, partir pour des missions de reconnaissance ou lançant un assaut au-delà de ses positions. Son texte a parfois des accents guerriers. Mais le plus souvent il mentionne simplement le détail des opérations, leurs résultats plus ou moins positifs militairement parlant, mais surtout toujours humainement tragiques dans le dénombrement des victimes.
Si les photos de groupe de soldats posant devant l’objectif avec leurs officiers, ou les photos de Jünger lui-même, sont nombreuses, la majorité des images nous montre les horreurs de la guerre, les corps de soldats plus ou moins mutilés, gisant dans la boue, les ruines d’anciennes habitations dont il ne reste que quelques amas de pierres, et ces paysages quasi désertiques d’arbres déchiquetés dont il ne reste le plus souvent qu’un fragment de tronc squelettique. On peut avoir aujourd’hui l’impression d’avoir déjà tout vu, de tout connaître, de la vie des soldats dans les tranchées. Ici, dans la succession de ces images insistantes dans leur répétition, on n’est plus un simple spectateur extérieur. Chaque obus qui éclate sur l’écran nous fait tressaillir, même s’il est muet.
Là où poussent les coquelicots de Vincent Marie.
Vincent Marie est historien. Et il est passionné de bande dessinée. Histoire et bd, une rencontre fructueuse, surtout quand elle s’incarne dans des films – à propos de la guerre de 14-18, ou celle d’Algérie (Nos ombres d’Algérie 2022, en passant par la fin de la guerre d’Espagne, la « retirada » dans Bartoli le dessin pour mémoire, 2019).
Le principe mis en œuvre par Vincent Marie dans ces films, est de nous faire rencontrer les auteurs des albums, dessinateurs et scénaristes. De nous les montrer au travail, effectuant des planches, dessinant des personnages de leurs albums, les colorisant, les rendant vivants, malgré le conteste de mort dans lequel ils sont situés. Leurs propos éclairent leur démarche. Tous se posent la question fondamentale. Pourquoi la guerre est-elle si présente dans l’histoire, presque universelle. Pourquoi les hommes ne peuvent pas, ne savent pas, vivre en paix.
Là où poussent les coquelicots s’ouvre par une rencontre avec Jacques Tardi, que nous retrouverons d’ailleurs à plusieurs reprises dans le film. Il évoque une photographie en noir et blanc, celle d’un jeune soldat, partant à la guerre en souriant. Pour lui, l’image type de « la chair à Canon », qu’il dessinera dans Putain de guerre (avec Jean-Pierre Vernet) et dans C’était la guerre des tranchées (avec Grange).
La vie dans les tranchées est d’ailleurs un des thèmes récurant de la bande dessinée consacrée à la Grande Guerre l’image même de l’horreur. A quoi s’ajoute l’évocation de Verdun, de la bataille de la somme ou du front italien dans les Alpes. A chaque fois, des images en couleurs s’attardent sur les lieux actuels de ces épisodes, pour constater comment le paysage reste encore aujourd’hui marqué par le passage de la guerre.
Les albums qui se succèdent permettent de suivre les principaux événements de ces quatre années de massacres, depuis l’attentat de Sarajevo jusqu’aux mutineries de 17 et bien sûr la fin des hostilités et leur célébration. Citons en quelques-uns : La mort blanche de Charlie Adlard et Robbie Morrison, Notre mère la guerre de Maël et Kris, L’homme qui changea le siècle de Gravilo Princip, Gueule d’amour de Delphine Priet Lahéo et Aurélien Decoudray.
« Le dessin permet de supporter l’horreur », cette phrase de Joe Sacco résume bien le propos de Vincent Marie. Elle vaut assurément pour tout son cinéma.
39/45. Le Nazisme, l’occupation, les camps.
Nuremberg, des images pour l’histoire. Jean-Christophe Klotz.
Le Procès de Nuremberg, en 1945, un procès historique. Et pas seulement parce qu’il s’agissait de juger les hauts dignitaires nazis pour crimes de guerre, mais aussi le rôle que les images, photos et films, y jouèrent.
Pour la première fois un écran géant était installé dans la salle d’audience. Pour la première fois les accusés allaient être mis en face des images de leurs crimes. Des images qui n’étaient pas réalisées par l’accusation, mais par le parti des accusés eux-mêmes. Pour la première fois les films devenaient des pièces à charge dans ce procès d’une portée considérable.
Les images présentées avaient été l’objet d’un travail considérable. Un travail de recherche d’abord, de sélection et de montage ensuite. Ce travail fut confié à une équipe de soldats américains appartenant aux États Unis au groupe de John Ford. Deux frères étant aux commandes : Budd et Stuart Schulberg. C’est ce travail que nous montre le film de Jean-Christophe Klotz. Un travail qui devait être réalisé dans un temps particulièrement court. Une véritable course contre la montre pour que tout soit prêt à l’ouverture du procès. Des circonstances que le film sait particulièrement bien exploiter, créant un véritable suspens dans la mise en scène des images retrouvées. Une recherche dont les étapes, les péripéties, s’enchaînent à un rythme soutenu. Car au départ, rien ne dit que le projet d’utilisation des images dans le procès pourra être réalisé. Et effectivement, les obstacles à surmonter furent nombreux et souvent inattendus.
Nous suivons donc pas à pas la recherche que les nazis avaient réalisées tout au long de la guerre et de la « solution finale ». Des images par lesquelles les nazis voulaient sans doute glorifier leurs actes de guerre. Mais lorsque l’issue se précisa, les nazis commencèrent à détruire ces images, sentant bien qu’elles pouvaient être utilisées contre eux. Heureusement pour l’histoire, suffisamment de films cachés ont été préservées de la destruction.
Ces images sont terribles et toujours difficiles à regarder, même aujourd’hui. On y voit les corps décharnés des déportés. On y voit des corps inertes poussés par des bulldozers dans des fosses. On y voit même un cinéaste caméra à la main réalisant des images de ces horreurs. La projection de ces images montées par les frères Schulberg furent un moment clé du procès. L’impitoyable vérité éclatait aux yeux de tous. Les accusés n’avaient plus d’échappatoire. Reconnaissaient-ils leurs crimes. Hesse qui se disait amnésique fit une déclaration pour avouer qu’il simulait. Et Goering ne pouvait plus fanfaronner au milieu de ses co-accusés.
Les images ont donc joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de la justice. Un rôle qui ne pourra que s’amplifier après Nuremberg.
Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur.
Hélène Berr a 21 ans en 1942. Elle vit à Paris, à deux pas des Champs Élysées. Son père dirige une entreprise chimique. Elle joue du violon, prépare l’agrégation d’anglais à la Sorbonne. Comme on dit, elle est promise à un brillant avenir. Sauf qu’elle est juive. Son avenir immédiat sera fait de discriminations de plus en plus importantes dans Paris occupé. En 1944, elle est arrêtée avec ses parents et déportée à Auschwitz. Elle mourra à Bergen-Belsen quelques jours avant la libération du camp.
Le film que consacre Jérôme Prieur à son souvenir repose entièrement sur le journal intime qu’elle écrit pendant cette période. Présentant les passages qu’il choisit par ordre chronologique, il n’y ajoute aucun commentaire. Cette voix intérieure se suffit à elle-même. Elle constitue un témoignage de tout premier ordre sur le vécu des victimes de la barbarie nazie relayée par les autorités françaises. L’humiliation de devoir porter l’étoile jaune. La révolte et le refus initial. Puis l’acceptation par solidarité avec ceux qui la portent. Elle évoque alors les regards blessants dans la rue et les quelques manifestations de fugace sympathie dans le métro. Rien de la tragédie de la guerre ne lui est épargné, l’arrestation de son père à Drancy, la répétition des rafles, la connaissance de l’existence des chambres à gaz.
Le film montre le Paris de l’occupation comme on l’a rarement vu. Par les images photographiques d’époque et surtout tous ces petits films amateurs, sans doute filmés par des Allemands, et qui comportent donc toujours un peu un point de vue touristique, il nous donne à voir ce que Hélène pouvait voir de la ville. Une promenade sur les quais de la Seine, un regard sur la Tour Eiffel, une vue sur un jardin depuis la fenêtre d’un appartement, des terrasses de café, un week end à la campagne. Des images toujours pleines de vie, qui rendent d’autant plus inacceptable l’issue fatale qui se profile.
La Passeuse des Aubrais de Michaël Prazan.
Partir d’une histoire personnelle, intime, pour accéder à la grande histoire, celle des peuples et des nations. Pas seulement pour l’inscrire dans un contexte historique, ou lui donner une portée qui aille au-delà du cas particulier, mais plus simplement pourrait-on dire, pour lui reconnaître son sens véritable, ce que le singulier peut avoir d’universel. Cette démarche a souvent été celle de documentaires autobiographiques, faisant d’une vie unique un signe dans lequel il n’est sans doute pas possible que tous les spectateurs se reconnaissent, mais qui leur permet d’accepter ce qui peut leur être étranger, par la connaissance et aussi par l’émotion.
Le film de Michaël Prazan, La Passeuse des Aubrais, est une réflexion sur la vie de son père. Ce père est un « enfant caché ». Pendant la guerre il a échappé à l’extermination des juifs par les nazis grâce à des Français qui l’ont recueilli et caché. A six ans, il a franchi la ligne de démarcation grâce à une « passeuse» qui mettait sa propre vie en péril pour pouvoir le mettre en sécurité, lui et sa sœur. Un passé qui ne laisse pas le fils indifférent.
Le film de Michaël Prazan met en évidence les incertitudes de la mémoire. Les récits de son père et de la passeuse sont différents quant à leur signification réelle. Toujours est-il qu’il reste indispensable pour que les enfants cachés de la guerre soient évoqués au grand jour et que les passeurs qui les ont sauvés ne soient pas oubliés.
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais.
Le film fut commandé à la société Argos par le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale et par le Réseau du souvenir.
Argos fait appel à Alain Resnais, choix lourd de sens et plutôt risqué, puisque le réalisateur est alors précédé d’une réputation de cinéaste engagé du fait de son précédent court métrage, Les statues meurent aussi, consacré à l’art africain et développant des positions nettement anticolonialistes. En outre, Alain Resnais, de part une œuvre de documentaliste déjà bien fournie, apparaît comme un cinéaste expérimentateur, novateur, faisant œuvre artistique et non seulement historique.
Les commanditaires font appel eux aux historiens reconnus comme spécialistes incontestés de la période de la déportation : Henri Michel et Olga Wormser. Ils seront les conseillers historiques de Resnais. Cette collaboration, intéressante à plus d’un titre, permet surtout de préciser quel peut être le rôle de « scientifiques » dans la conception et l’élaboration d’un film documentaire historique.
Le projet porte sur la présentation détaillée de l’univers concentrationnaire, depuis les rafles, les convois, l’installation des déportés dans les camps, leur vie quotidienne avec la misère, la maladie et le mort jusqu’à l’arrivée des armées libératrices et le retour des survivants. Comme on le voit, il n’y est pas question de l’extermination des juifs et de la « solution finale », point important de discussion à propos du film.
Le film est construit à partir de plusieurs séries d’oppositions. Au niveau de la nature des images, les images d’archives s’opposent aux images filmées par Resnais dans les camps en 1955. Parmi les images d’archives, le film propose des images réalisées par les bourreaux et des images, souvent clandestines, réalisées par les victimes. Ces deux types d’images montrent soit l’univers concentrationnaire en lui-même, soit les camps tels qu’ils ont été filmés par les armées de libération. La réalisation alterne, d’une part, des images du présent en couleurs et des images du passé, archives en noir et blanc, et d’autre part des images fixes, photographies, et images filmiques. Le montage repose lui aussi sur l’alternance de longs travellings sur l’espace des camps tels qu’ils ont été conservés et des plans brefs et rapides des images d’archives, surtout pour les images fixes.
Le commentaire est rédigé par Jean Cayrol (ancien déporté) et dit par Michel Bouquet. Il se caractérise en particulier par différents usages du pronom « on » : les déportés, les bourreaux, les spectateurs du film, l’auteur-énonciateur.
À propos de Nuit et brouillard, il n’est pas possible de négliger l’histoire de sa réception à sa sortie, ses démêlés avec la censure (l’affaire du képi du gendarme qui indiquait le rôle de Vichy dans la déportation), les débats et polémiques qu’il a suscitées. Sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes, le ministre de l’époque s’opposa à ce choix, sans doute sur intervention de l’Allemagne fédérale. Le film sera finalement projeté hors compétition.
Shoah de Claude Lanzmann.
9 heures 30 de film pour dire ce qu’a été l’extermination des juifs européens par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Un film résultat de 12 années de travail, de recherches, d’enquêtes, de filmage et de montage. Un film qui est devenu une véritable œuvre d’histoire tout en étant un monument du cinéma mondial.
Shoah est composé d’une série d’entretiens et de vues filmées aujourd’hui des lieux où se déroula cette tragédie, les vestiges des camps et leur environnement proche, les gares, les villages, les champs. Les personnes avec qui Lanzmann s’entretient sont tout d’abord des rescapés de l’extermination, puis des représentants des bourreaux, officiers SS ou membres de l’administration nazie, et enfin des témoins, paysans ou cheminots polonais et habitants des villages proches des camps. Le cinéaste est souvent présent à l’image, accompagné de son interprète lorsqu’il ne parle pas la langue (hébreu ou polonais) de son interlocuteur. Ces entretiens se déroulent en majorité en Pologne, mais Lanzmann est allé aussi filmer en Israël ou aux États-Unis, lorsque les rescapés des camps ne voulaient pas se rendre sur les lieux où ils connurent l’enfer. C’est aussi à Berlin, Munich ou en Suisse qu’il est allé retrouver d’anciens nazis. Pour réaliser ces entretiens, il n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser une technique de caméra cachée, s’entretenant par exemple avec un officier sans révéler à celui-ci que l’entretien est enregistré depuis une camionnette située dans la rue. Il rencontre aussi à New York un historien américain spécialiste de la Shoah, qui la resituera dans l’histoire des persécutions dont les juifs furent victimes bien avant le XX° siècle, mais qui montrera aussi ce que le génocide nazi a de nouveau et de spécifique.
Faire un film sur l’extermination des juifs pose une question fondamentale : comment représenter la Shoah ? La question qui se pose au cinéma est même plus radicale : peut-on représenter ce qui est de l’ordre de l’horreur absolue, de l’inimaginable ? La position de Lanzmann est catégorique. Il refuse non seulement toute représentation fictionnelle, condamnant tout aussi bien La Liste de Schindler de Spielberg que La vie est belle de Benini ; mais il va jusqu’à écarter de son film toute utilisation d’archives de l’époque, que ce soit les quelques images photographiques prises à l’intérieur d’un camp par ce juif grec désigné par le seul nom de Fred , ou les images cinématographiques prises par des cinéastes américains à la libération des camps, comme par exemple Samuel Fuller. Dans Shoah, Lanzmann intègre seulement deux documents datant de la guerre, une lettre du rabbin de Grabow qu’il lit lui-même à l’écran et « l’ordre de route » n°587 des trains de la mort vers Treblinka, analysé et commenté par l’historien Raul Hilberg. Dans les deux cas, ces documents sont appréhendés au présent, intégrés au présent du film. Ils ne fonctionnent donc pas comme dans les films historiques qui utilisent traditionnellement les archives. Pour Lanzmann, ces documents ne sont pas chargés de révéler une vérité. La vérité de la Shoah ne peut résider que dans la parole des survivants des camps, qui sont en grande partie des membres des Sonderkommandos, ces groupes de juifs triés pour faire un travail de mort (couper les cheveux des femmes juste avant leur entrée dans les chambres à gaz, évacuer les corps après le gazage) et régulièrement eux-mêmes exécutés pour être remplacés par d’autres. Ce sont eux qui ont connu l’horreur des camps au plus près, eux dont cette horreur s’est inscrite à jamais dans leur mémoire. Leur parole est parole de vérité.
Dans les entretiens qu’il mène tout au long de son film, Lanzmann n’a pas toujours la même attitude vis-à-vis de son interlocuteur, car il ne poursuit pas le même but. Avec les survivants, s’il insiste dans ses questions, cherchant inlassablement plus de précision, c’est bien sûr pour que le travail de mémoire qu’il entreprend avec eux soit le plus complet, le plus explicite, possible. Et lorsque le récit devient difficile, voire impossible, à poursuivre pour le narrateur, comme le « coiffeur » qui s’interrompt, incapable de continuer, Lanzmann insiste encore. « Abe, vous devez le faire ». Recueillir la parole des survivants est un impératif qui dépasse l’individualité de celui qui parle, comme de celui qui écoute. Rarement, le cinéma aura eu une telle force, une telle légitimité, dans l’enregistrement dans le présent des traces de l’histoire.
Le ton est tout autre avec les anciens nazis. Devant leur tendance amnésique, ou leur volonté explicite de minimiser leur responsabilité, voire les faits eux-mêmes, Lanzmann ne leur laisse pas de répit. « Je vais vous aider à vous souvenir », dit-il, donnant des chiffres précis, ceux des statistiques qu’établissaient les nazis eux-mêmes. Dans Shoah, les anciens bourreaux n’ont pas d’excuses. Face à Lanzmann, il ne leur est plus possible de se dérober.
Avec les Polonais témoins directs de l’extermination des juifs, l’attitude de Lanzmann est plus ambiguë. D’un côté, il semble comprendre leur peur et leur impuissance face aux SS et à l’armée allemande. Leur était-il possible de venir en aide aux juifs. Certains ont pu donner parfois de l’eau à ceux qui étaient enfermés dans les wagons à bestiaux des convois. Beaucoup tentaient d’avertir les prisonniers qu’ils étaient conduits à la mort. C’est le sens donné au geste de se trancher la gorge que refait le conducteur de la locomotive arrivant en gare de Treblinka. Ce geste était devenu courant au passage des trains. Servaient-ils vraiment à quelque chose ? N’y avait-il pas aussi chez certains Polonais une certaine satisfaction d’être débarrassés des juifs ? Lanzmann ne le dit pas ouvertement, mais ses discussions avec les groupes de femmes ou d’hommes qu’il rencontre dans les villages montrent qu’ils ont pu tirer un certain bénéfice de la disparition des juifs, récupérer leurs maisons par exemple. Aucun ne se réjouit ouvertement du sort fait aux juifs. L’un d’eux en vient à dire que s’ils étaient partis de leur plein gré, cela aurait quand même était mieux. Un autre regrette leur absence, parce que dit-il, il y avait de belles femmes parmi eux !
Toutes les rencontres du film, tous les récits qu’il présente, constituent peu à peu un tableau complet, et impitoyable, de la « machine de mort » nazie. Rien n’est laissé de côté, de l’arrivée des trains sur la « rampe » d’Auschwitz ou de Treblinka, des violences faites aux juifs pour les conduire aux chambres à gaz ou des procédés que les nazis essayaient de mettre en œuvre pour éviter tout mouvement de panique – leur faire croire par exemple qu’il s’agissait simplement de prendre une douche. Le travail du cinéaste est d’une telle volonté de précision que l’on comprend pourquoi le film ne pouvait pas avoir une durée courante. S’il s’agit d’un film hors normes, c’est bien parce que son sujet ne peut rentrer, et ne devra dans l’avenir rentrer, dans aucune norme.
De ce film sans nul autre pareil dans l’histoire du cinéma, il restera aussi des séquences particulièrement émouvantes, depuis celle du retour de « l’enfant chanteur » à Chelmno, dans la barque qui glisse lentement sur la Ner, où il reprend le chant que les nazis lui faisaient chanter lorsqu’il avait 13 ans, jusqu’au récit de la visite du ghetto de Varsovie par Jan Karski, chargé par les leaders juifs d’informer les gouvernements des alliées de ce qui se passait en Pologne. Ceux-ci ont-ils fait passer leur souci de la victoire militaire sur le troisième Reich avant la nécessité de tenter par tous les moyens de mettre fin à l’extermination des juifs ? Lanzmann ne traite pas directement cette question. Mais il rapporte clairement le refus de la résistance polonaise d’armer les insurgés du Ghetto. On ne peut s’empêcher de penser que les juifs ont été abandonnés à leur triste sort
Images du monde et inscription de la guerre de Harun Farocki.
Un film essai. Sur les images, leur place et leur importance dans notre culture. Un essai qui développe sa pensée d’abord dans le commentaire. Mais une pensée que les images s’efforcent de rendre visible. Des images le plus souvent fixes, puisque la photographie prend dans la réflexion la première place. Des images en noir et blanc essentiellement, puisque ce sont les images du passé qui aujourd’hui nous questionnent fondamentalement. Mais la pensée du film est une pensée actuelle, vivante. Les premières images qu’il propose seront d’ailleurs des images animées, en couleur, des images d’un dispositif de recherche scientifique sur l’eau dans le canal expérimental de Hanovre. Ces images reviendront plusieurs fois dans le film. Comme celles de ces « enquêteurs », qui examinent à la loupe des clichés pris à 7 000 mètres d’altitude ou avec des caméras à infra-rouges. Pour qui sait les regarder, ces images qui ne disent rien au premier abord, pour le regard non questionneur de Monsieur tout le monde, peuvent se révéler riches de découvertes et d’information. A partir du moment où l’on sait à l’avance ce qu’on peut y trouver.
Le point de départ du film est sans doute la notion d’Aufklärung, un concept central dans la philosophie allemande à partir de Kant. L’Aufklärung, c’est d’abord les Lumières, la philosophie française du XXVIII° siècle qui, avec Rousseau, Voltaire ou Diderot, a si fortement influencé la Révolution française. Mais l’Aufklärung est aussi un terme militaire, renvoyant à la reconnaissance militaire. Les images photographiques peuvent-elles influencer le cours des guerres. Auraient-elles pu en particulier faire connaître la mise en œuvre de la solution finale nazie dès 1944, avant la libération des camps sur le terrain ?
Des photographies aériennes des camps de la mort existaient dès 1944. Le 4 avril 1944, un avion militaire américain survole la région d’Auschwitz et prend des photos à 7 000 mètres d’altitude. Ces photos montrent clairement les usines proches du camp. Elle montre aussi le camp. En les regardant aujourd’hui il est facile de reconnaître les divers bâtiments, les blocs, les salles de déshabillages, les salles de gazage, les fours crématoires. Le film montre même des images des véhicules portant la croix rouge, ce qui était destiné à faire croire aux déportés que les mesures humanitaires existaient réellement, alors qu’en réalité ces véhicules transportaient des futs du gaz mortel employé pour les exterminer. Sur ces images, sont aussi visibles les files de prisonniers conduits dans les chambres à gaz. Mais en 1944, aucun militaire n’a identifié les camps. D’Auschwitz, ils n’ont vu que les usines environnant le camp. « Ils n’étaient pas chargés de repérer le camp », dit le commentaire. « Aussi, ils ne le trouvent pas. »
Comment être devant un appareil photo ? Farocki présente un livre de photographie de femmes algériennes, prises en 1960, sous le colonialisme donc. C’était la première fois que ces femmes étaient photographiées. Elles vivaient toujours voilées, sauf dans l’intimité de leurs foyers. Or ici elles sont photographiées sans voile, puisqu’il s’agissait de faire des photos d’identités. Ces photos font voir ces femmes comme seuls leurs proches pouvaient les voir. En les fixant dans un instant, la photographie les prive de leur passé et de leur futur.
Rien n’échappe à l’image, même l’horreur de la Shoah. Il existe bien des photos d’Auschwitz, prises par les nazis, mais qu’ils ne publièrent pas. Des photos clandestines prises par un déporté ont aussi été retrouvées. Comme ce carnet de dessins du camp, dont l’auteur, Alfred Cantor, visait à dresser un constat objectif de la réalité qu’il vivait. Le film revient à plusieurs reprises sur une de ces photos clandestines prises à Auschwitz par les déportés. La scène se situe à l’entrée du camp, lors de l’arrivée d’un nouveau groupe de déportés. Un SS arrête deux hommes dont on voit l’étoile jaune sur le vêtement. Mais au premier plan apparaît une femme, entrée peut-être accidentellement dans le champ, et qui regarde l’appareil de prise de vue. Que regarde-t-elle ? Ce regard est identique à celui qu’elle pourrait avoir sur une avenue où il y avait des magasins, des vitrines. Le commentaire du film n’en dit pas plus. Mais en reprenant plusieurs fois cette image, il en souligne la valeur historique inestimable.
Comme toute l’œuvre cinématographique de Farocki, ce film est exigeant. Il nous invite à nous interroger sans cesse sur ce que nous voyons dans les images que nous regardons. Sommes-nous capables de regarder en face la souffrance et la mort ? La réponse de Farocki doit nous faire réfléchir : la série télévisée Holocauste n’a eu du succès que parce qu’elle les a réduites au kitsch.
L’espionne aux tableaux de Brigitte Chevet.
Faire œuvre de mémoire. Tout film historique a pour but premier de faire œuvre de mémoire. Mais qu’est-ce à dire exactement ?
D’abord, de façon simple, on va dire qu’il s’agit de rappeler des faits, des événements, du passé, pour qu’ils ne soient pas oubliés, ou pour les porter à la connaissance des contemporains du film. Ce rappel sera considéré d’autant plus important que ces faits sont eux-mêmes considérés, historiquement parlant, comme importants. Mais cela est-il suffisant ? N’y a-t-il pas une autre dimension du film historique qui apparaît clairement lorsque les faits qu’il porte à la connaissance de ses contemporains, ont été, plus ou moins consciemment, oubliés, ou mieux encore lorsqu’ils ont été occultés, exclus de la mémoire collective, pour de multiples raisons sans doute, ou des intérêts qui peuvent être financiers bien sûr, mais plus certainement encore, des enjeux de pouvoir, et sont ainsi recouverts du voile de l’ignorance. Le film historique qui va dans ce sens est alors un travail contre, contre ceux qui ont tout intérêt à oublier, et à faire oublier. Les identifier est déjà un acte de résistance. Ce qui montre que faire un film historique, c’est prendre position, aller au-delà d’une vision de l’histoire comme connaissance objective. Le film historique alors ne peut être considéré que comme un film politique.
Nous prendrons ici comme exemple – bien d’autres seraient tout aussi pertinents – le film de Brigitte Chevet, L’Espionne aux tableaux. Rose Valland face au pillage nazi. Ce film propose plusieurs strates qui se juxtaposent, ou se superposent, dans un processus de complexification croissante. Il s’agit de partir d’un personnage, une femme, Rose Valland, pour rendre compte d’un aspect particulier, le pillage des œuvres d’art, de l’occupation nazie de la France pendant la seconde guerre mondiale, et de ses suites dans les décennies suivantes.
La première strate est donc la dimension portrait du film. Le portrait de Rose Valland, dont il s’agit de cerner au plus près, par petites touches successives, la personnalité. Le film rappelle ainsi ses origines, modestes et provinciales, puis son ascension grâce à son travail. Le récit de sa carrière, pendant l’occupation dans le musée du Jeu de Paume, puis en Allemagne après la libération et son retour en France, permet de dessiner son caractère. Des photos, nombreuses, la présentent à différents âges. Des historiens, des spécialistes de l’histoire de l’art (aucun de ces intervenants ne semble l’avoir connue personnellement) commentent ses faits et gestes, son attitude dans les différentes situations historiques qu’elle a traversées. Un personnage secret – comme sa dimension d’espionne l’impose. Et le film joue alors astucieusement le jeu de ne dévoiler tel ou tel aspects de sa vie que de façon parcimonieuse. Nous ne saurons ainsi qu’elle vivait avec une compagne que vers la fin du film.
Deuxième strate, l’hommage. Présentant le personnage comme exceptionnel, le film le transforme en Héros. Un héroïsme au mépris du danger sous l’occupation. Un héroïsme dû à la fidélité à ses idées et à la persévérance dans son action ensuite. Sans elle, nous ne saurions rien, ou pas grand-chose de la spoliation des œuvres d’art par les nazis, de son ampleur et de ses bénéficiaires. Sans elle tant de chef d’œuvre de l’art, aussi bien modernes que classiques, n’auraient jamais été retrouvés. Sans elle, tant de propriétaires légitimes de ces œuvres n’auraient jamais pu récupérer leur bien.
Une troisième strate concerne donc l’historique du pillage des œuvres d’art par les nazis pendant l’occupation. Une partie du film précise, détaillée et appuyée sur de multiples images d’archives, comme les tableaux « exposés » dans le musée du Jeu de paume avant qu’ils soient expédiés en Allemagne, ou que Goering vienne personnellement se les approprier. C’est la partie la plus riche en informations du film. Même ici la figure de Rose Valland est omniprésente. Après tout c’est elle qui tenait secrètement et à la barbe des Allemands et des collabos, le registre exhaustif des œuvres transitant au Jeu de Paume.
Enfin, la dernière strate concerne la recherche des véritables propriétaires des œuvres spoliées et leur restitution. Un processus long et difficile, qui doit s’opposer, combattre, l’attitude première des pouvoirs publics de tout laisser dans l’ombre. Ce qui ne pouvait qu’aller dans le sens des musées nationaux qui s’étaient approprié bien des œuvres, en attendant qu’elles soient réclamées par leur propriétaire d’avant-guerre, tout en rendant cette réclamation quasiment impossible, les archives étant non accessibles au public. Le film montre alors clairement pourquoi dans ce contexte Rose Valland a été peu à peu mise à l’écart, jusqu’à tomber dans l’oubli avant même sa disparition.
Le film est donc en fin de compte une réhabilitation. L’action de Rose Valland est enfin reconnue à sa juste valeur grâce aux recherches de la cinéaste. Mais cela n’a été possible que parce le problème de la restitution des œuvres d’art spoliées par les nazis a été enfin reconnu par les pouvoirs publics. Il aura fallu pour cela que l’extermination des juifs d’Europe par les nazis, avec l’aide de la police de l’Etat français, soit reconnue et dénoncée sans concession.
En sursis de Harun Farocki.
Les sursitaires dont il est question ici, sont les internés du camp de Westerbork, construit en 1939 par le gouvernement des Pays-Bas pour accueillir les réfugiés juifs allemands fuyant le régime nazi. Lorsque les troupes allemandes occupent le pays, ils placeront le camp sous leur autorité.
Ce camp a la particularité d’être un camp de transit. Les déportés n’y sont ni battus, ni exécutés. Mais tous les mardis matin, un train où sont entassés près d’un millier de prisonniers, part vers l’est, vers les camps de la mort, Auschwitz en particulier. Tous ceux qui ont séjourné à Westerbork seront exterminés.
En 1944, le commandant du camp décide la réalisation d’un film. Il sera filmé en 16 mm, par un prisonnier juif, Rudolf Breslauer, qui périra lui-aussi à Auschwitz. Ce film doit montrer la réalité du camp à ses visiteurs, comme l’indiquera le commandant lors de son interrogatoire à la fin de la guerre. Il ne sera pas achevé par son auteur, mais nous sommes en possession des rushs qui, mis bout à bout, peuvent quasiment constituer un film. Ces images sont parmi les rares qui n’ont pas été détruites par les nazis à la fin de la guerre. Elles constituent donc un ensemble de documents particulièrement précieux sur les camps de concentration. Et en effet, beaucoup d’historiens et de cinéastes, à commencer par Alain Resnais en 1955 pour Nuit et Brouillard, y auront recours dans des montages d’archives. En particulier les séquences qui montrent l’embarquement des détenus dans les trains en partance pour les camps de la mort.
Pourtant le film tourné en 1944 ne se réduit pas à ces séquences. Et le film que Farocki consacre à l’analyse de ces rushs aura pour premier objectif de resituer ces séquences bien connues dans l’ensemble des images tournées par Breslauer. Son deuxième objectif, sans doute le plus important, concernera les enjeux de leur réalisation. Les rushs à sa disposition sont des images muettes. Aussi Farocki réalisera un film muet, s’interdisant de sonoriser par un commentaire ou une musique ces images. Il se contentera d’introduire des cartons d’intertitres. Et de réaliser un montage original.
Dans le camp de Westerbork, les SS semblent peu présents. Toutes les activités sont confiées aux détenus eux-mêmes. En particulier les tâches de polices. Ce sont même des juifs qui doivent établir chaque semaine la liste de ceux qui seront déportés. Faroki précise que les scènes de désespoir sur le quai de la gare étaient rares. Toutes les images du camp sont empreintes d’une certaine tranquillité. Est-ce là l’idée que l’on peut se faire d’un camp de concentration ? Mais les images réalisées par Breslauer sont des images de commande, et l’on peut comprendre qu’elles sont étroitement surveillées par les nazis. Le but de ce film de commande serait de montrer que le camp est « productif ». D’où ces séquences de travail dans des ateliers, des images qui gomment totalement le fait qu’il s’agit d’un travail forcé. Alors, les intertitres nous le rappellent. Lorsque les images montrent deux hommes trainant dans un champ une charrue, les intertitres précisent : « cela veut dire que nous sommes des bêtes de somme ». Et cette productivité n’est-elle pas plus grande si ceux qui travaillent sont « en pleine forme » ? Les images de spectacles donnés par les prisonniers peuvent aller dans ce sens. Distraire ceux qui travaillent contribue à faire qu’ils travaillent mieux.
Les images du film de Breslauer sont bien sûr trop lisses pour refléter la réalité des camps, même lorsqu’il s’agit d’un camp de transit où les détenus n’étaient pas exécutés sur place, même si l’on pense qu’ils ne savaient pas ce qui se passait à Auschwitz. Pourtant, ce cinéaste improvisé, ce cinéaste aux ordres, réalisant un film de commande, a réussi à introduire dans ses images une toute autre vision de l’univers concentrationnaire nazi. Une première fois lorsqu’il filme une brouette portant les initiales de la police du camp faisant irruption au milieu d’un spectacle de cabaret. Et surtout, lorsqu’il cadre le visage d’une jeune fille dans l’entrebâillement d’une porte de wagon en partance pour Auschwitz. « Sur le visage de la jeune fille, on lit la peur de la mort, ou le pressentiment de la mort » indique l’intertitre. Les recherches d’historiens ont retrouvé l’identité de cette jeune fille. Il s’agit d’une jeune Sinti de 18 ans, Settela Steinbach. Une image qui était déjà présente dans Nuit et Brouillard. De toutes les images qui nous sont parvenues des camps nazis, c’est pratiquement la seule qui soit un gros plan de visage. De Resnais à Farocki, il n’est pas étonnant qu’elle soit devenue un symbole de l’horreur de la Shoah.
Festins imaginaires. Anne Georget.
Brioche, riz à l’impératrice, macaron, riz créole, profiteroles au chocolat, pain de viande, gâteau aux pommes de terre, crème bourgeoise, far Breton, coq au vin, tomates farcies, macaroni à l’italienne, bouillabaisse, galette des rois moules à la béchamel et bien d’autres encore De quoi s’agit-il ?
Sur de petits carnets ou de simples bouts de tissu, des internées du camp de Ravensbruck pendant la seconde guerre mondiale mais aussi dans les camps de travail du Goulag soviétique, recopient des recettes de cuisine, des plats quotidiens plus que de la grande astronomie. Les femmes des camps se réunissent clandestinement, échangent ses recettes dans des moments de fraternité qui les aident à survivre dans l’enfer du camp.
Le camp c’est l’univers de la faim, une faim incessante, de tous les instants, insupportable. Une eau noire pour café le matin, un liquide jaunâtre où flottent parfois quelques épluchures de légumes, liquide appelé soupe, juste un bout de pain. La faim détruit les corps devenus des squelettes ambulants. Elle détruit ce qui peut rester d’humanité dans le camp.
Mais parler de cuisine, partager les recettes – combien mets-tu de farine et quel est le temps de cuisson – est peut-être un moyen de combattre la faim, de ne plus y penser ou d’y penser et de la vivre autrement. Un moyen de résistance.
Le film d’Anne Georget fait intervenir des survivantes de cet enfer qui décrivent avec précision cette sorte de cérémonie des recettes de cuisine. Mais aussi des historiens, des anthropologues, des philosophes des commentateurs et même un chef étoilé. Tous soulignent l’inhumanité des camps et la force de ces femmes qui ont réussi à survivre peut-être grâce à la magie de la cuisine.
Le Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls.
Rares sont les films qui ont été présenté dans l’histoire du cinéma comme ayant eu autant d’influence que Le Chagrin et la pitié. Une influence historique d’abord, tant il aurait contribué à modifier les représentations, et aussi les connaissances, que les français pouvaient se faire de l’occupation allemande en France pendant la seconde guerre mondiale. Une influence politique aussi, et peut-être surtout. Réalisé à la fin des années appelées couramment aujourd’hui les « trente glorieuses », il venait troubler la quiétude d’une population encore majoritairement sous l’emprise de l’aura du Général de Gaulle, libérateur de la France. Montrer concrètement que les français n’avaient pas tous été des résistants, loin de là, que les véritables héros avaient été plutôt rares, n’est-ce pas bousculer l’orgueil d’un pays qui joue l’amnésie et s’accommode très bien de ses lâchetés, voire de ses traitrises. Le film d’Ophuls contribua fortement à briser le mythe d’une France unanime face à l’occupant et tout entière engagée aux côtés de la Résistance. Après lui, le rôle du gouvernement de Vichy, de sa milice et de ceux qui l’avaient soutenu, ne pouvait plus être ignoré. Même si la question juive et la « solution finale » sont peu présentes dans le film, le sort fait aux juifs pendant toute la guerre pouvait enfin éclater au grand jour. La voie était ouverte pour qu’un véritable travail de mémoire soit effectué. En particulier dans le cinéma.
Le Chagrin et la pitié, composé de deux parties (L’Effondrement et Le Choix) présente un savant mélange d’images d’archive et d’entretiens avec des acteurs et témoins divers des événements.
Les images d’archives sont composées essentiellement d’images d’origine allemande. Il s’agit d’extraits des actualités officielles, donc des images de propagande destinée à faire accepter la présence de l’armée d’occupation et à développer les thèmes principaux du pouvoir nazi. Dans le film, elles permettent de resituer une chronologie des événements principaux de la guerre, depuis l’offensive allemande, l’exode et la victoire concrétisée par la visite de Paris par Hitler (avec l’image type du Führer au Trocadéro dominant en arrière-plan la Tour Eiffel), jusqu’à la Libération, issues alors des actualités françaises, concrétisée par la visite de De Gaulle à Clermont-Ferrand et des scènes où des femmes sont tondues en place publique. La totalité de ces images permet en outre, dans le projet du film, de mesurer la teneur de l’idéologie, anti-anglaise et surtout antisémite, à laquelle la population française était soumise. Pétain et Laval y sont présentés comme les sauveurs de la France. Venant de la part des vainqueurs, ces discours ne pouvaient qu’avoir une influence insidieuse sur la population française. C’est une des explications de la résignation passive et de la collaboration active d’une frange non négligeable des Français.
En ce qui concerne les entretiens, le film présente l’originalité de donner la parole successivement aux différentes parties engagées dans le conflit. Du côté allemand, la présence de l’ancien interprète personnel ‘Hitler est assez anecdotique. Plus intéressant, un ancien officier de la Wehrmar, rencontré le jour du mariage de sa fille, et un soldat bavarois, décrivent chacun à sa façon, la vie dans le pays occupé. Etaient-ils nazis ? L’officier s’efforce de faire la différence entre l’armée et la Gestapo. Mais est-il vraiment crédible ? Toujours est-il qu’ils présentent la victoire allemande comme entièrement méritée, l’armée française, peu entrainée et non disciplinée, leur étant nettement inférieure. L’occupation leur paraît alors parfaitement justifiée.
Pour les Anglais, alliés de la France libre, le film n’évoque pas les bombardements allemands sur Londres et les souffrances infligées à la population civile. Il présente des agents anglais opérant en France, qui donnent leur vision particulière du climat de l’occupation, et surtout des « officiels » (Anthony Eden, ancien ministre des Affaires étrangères et Premier Ministre du Royaume-Uni ou Edward Spears, un ancien diplomate), ce qui permet de resituer l’action de de Gaulle à Londres, dont le film ne peut guère être considéré comme réalisé à sa gloire.
Les Français sont bien évidemment les plus nombreux. Et là aussi la parole est donnée aux deux côtés. La collaboration est représentée par René de Chambrun, gendre de Pierre Laval, ou Christian de la Mazière, ancien membre de Division Charlemagne, qui combattit sur le front en tant que Waffen-SS. La résistance est quantitativement plus importante dans le film. Des personnalités connues d’abord, Georges Bidault, ancien ministre, ancien membre du Conseil national de la Résistance, Emmanuel d’Astier de La Vigerie, le colonel « Gaspard » chef du maquis d’Auvergne, Jacques Duclos pour le Parti Communiste Français, ou Pierre Mendes-France qui raconte son procès à Clermont-Ferrand et sa condamnation pour désertion. Réussissant à s’évader de prison il gagne Londres et rencontre de Gaulle. Mais aussi des résistants auvergnats, plus anonymes, qui ont visiblement tout l’estime du cinéaste. Enfin, des habitants de Clermont-Ferrand (un exploitant de cinéma, un pharmacien, un commerçant, des enseignants, une coiffeuse…) ont aussi la parole. Ils représentent la population non officiellement engagée, souvent indécise et plutôt attentiste, mais dont on sent bien où allait globalement sa sympathie, même si aucun ne l’avoue clairement.
Cette palette de personnages extrêmement variée constitue une des grandes nouveautés du film. A quoi on peut ajouter le style des interviewers, Marcel Ophuls lui-même, bien qu’il soit peu présent à l’image, et surtout André Harris que l’on voit beaucoup plus à côté de ses interlocuteurs, souvent incisif et insistant pour aller au-delà des questions convenues.
Destiné à la télévision, le film fut refusé sur intervention du pouvoir gaulliste, qui se sentait quelque peu mal à l’aise. Il sortit pratiquement clandestinement dans une salle du quartier latin à Paris deux ans plus tard. L’énorme succès qu’il rencontra alors, grâce essentiellement aux bouches à oreilles, montre qu’il correspondait parfaitement à une volonté assez commune d’aborder la période de l’occupation en dehors des versions officielles, en se situant au plus près de la vérité historique.
Références
Le rouge et le gris. Ernst Jünger dans la grande guerre, François Lagarde, 2018, 208 minutes.
Là où poussent les coquelicots. Vincent Marie, 2016, 52 minutes.
Nuremberg, des images pour l’histoire. Jean-Christophe Klotz, 2020, 60 minutes.
Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé. Jérôme Prieur, 2013, 83 minutes.
La Passeuse des Aubrais, film de Michaël Prazan, 2016, 81 minutes
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, 1956, 32 minutes.
Shoah, Claude Lanzmann, France, 1985, 570 minutes
Images du monde et inscription de la guerre, Harun Farocki, Allemagne, 1988, 75 minutes.
L’espionne aux tableaux de Brigitte Chevet. 2015, 52 minutes.
En sursis, Harun Farocki, Allemagne 2007, 40 minutes.
Festins imaginaires. Anne Georget, 2014, 70 minutes.
Le Chagrin et la pitié. Marcel Ophuls. France, 1969, 251 minutes.