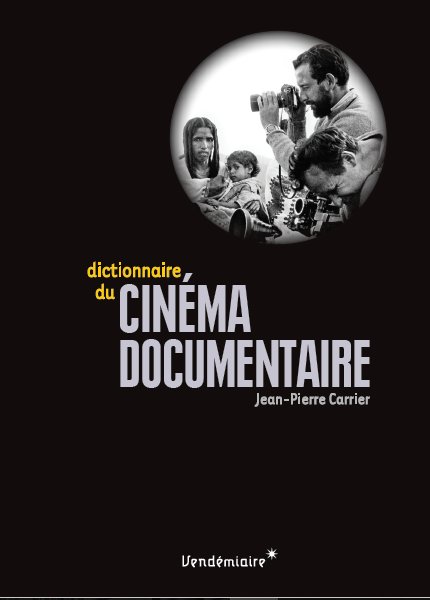Cités, quartiers. Défavorisés. Difficiles bien sûr. Barres. Violence. Drogue. Clans. Bandes. Ghetto.
Il y a un avant et un après 2005 à propos des banlieues. La télévision, bien sûr, s’est mobilisée pendant les émeutes et immédiatement après. Reportages, enquêtes, il s’agissait de rendre compte des événements, rarement de les analyser en profondeur. Il est banal de dire que la télévision est condamnée à l’immédiateté. Le cinéma documentaire, lui, prétend prendre le temps de la réflexion, avec le recul nécessaire pour ne pas être influencé par l’air du temps, les discours officiels et les stéréotypes de tout poil. Les documentaires sur la banlieue sont alors un bon indicateur de l’état de la société et de la pertinence des analyses qu’elle est capable de développer sur elle-même.
Les films récents filment le plus souvent ceux qui vivent dans les banlieues, ceux qui ont choisi d’y vivre, ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ceux qui ne désirent rien d’autre que d’aller vivre ailleurs. Les jeunes, les adolescents surtout, y occupent une grande place. Dans leur scolarité bien sûr (les collèges de banlieue comme exemple type des difficultés du métier d’enseignant), mais aussi dans leur vie sociale, leurs relations de groupe ou même de couple. Les jeunes de banlieue ce sont ceux qui font peur quand ils descendent en ville, et ils sont de plus en plus souvent identifiés comme « casseurs » dans les manifestations violentes. Comment peuvent-ils échapper aux stéréotypes ?
Y a-t-il donc une vie dans les banlieues ? Une vraie vie, avec du lien social et de la culture, avec de la solidarité et de l’entre-aide. Une vie où la mixité sociale peut être une réalité et la pluralité culturelle une richesse. Une banlieue dont le cinéma nous dit qu’il est permis de rêver.
1 La banlieue, c’est où ? Où est-elle filmée ?
Clichy sous bois, La Courneuve, Le Val Fourré, Les Bosquets à Montfermeil, la Source à Épinay-sur-Seine, le quartier de Maurepas, à Rennes, Les Rosiers et les quartiers nord de Marseille
Et surtout, le 93 ou 9-3.
On dit 9-3 pour ne pas dire 93 ? Pas vraiment une coquetterie, plutôt un tic de langage. Pour éviter de dire le vrai nom, Seine-Saint-Denis, de ce département pas comme les autres. Pour bien marquer son côté à part, sa différence, son caractère unique. Une dénomination lourde de sous-entendus, tous négatifs. Si l’on vient du 9-3, tout de suite on est repéré, et pas vraiment à son avantage.
Mais aussi A New York, Chicago
2 La banlieue, c’est comment ? Portraits des lieux.
L’histoire.
Le Val Fourré, une banlieue idéale. Du moins si l’on en croit les images d’archive que la cinéaste place en pré-générique de son film. Des images qui devaient faire rêver. Le commentaire, grandiloquent, vante la modernité de ce nouveau quartier où tout a été pensé, les espaces verts à l’extérieur, les jeux pour enfants, les parkings. Les immeubles HLM, les tours, les appartements flambant neufs, vont permettre de vivre dans le plus grand confort. La cité représente alors la promesse d’une vie meilleure. Des images qui surprennent aujourd’hui, mais qui nous replacent dans le contexte d’une époque que l’histoire récente des banlieues rend bien difficile à imaginer et à comprendre.
Qui étaient ceux qui sont venus vivre dans cet eldorado si bien vanté par la publicité promotionnelle ? Et comment y ont-ils vécus ? Au moment de la réalisation du film, 1992, les tours du Val Fourré viennent d’être fermées, abandonnées, vidées de leurs habitants en dehors de quelques squatters. Et le film s’achèvera sur les images de leur destruction.
Dominique Cabréra retrouve ces anciens locataires, des hommes, des femmes, des enfants, de tout âge, de toute origine. Des arabes, des africaines, des travailleurs français. Tous ont vécus de longues années dans ces tours. Tous y ont leurs souvenirs, qu’ils évoquent avec beaucoup d’émotion. Ils nous montrent les différentes pièces de leurs anciens appartements, la cuisine, les chambres, la place de la télé dans le salon, les papiers peints qu’ils avaient remplacés, la vue par les fenêtres ou le balcon, plongeant sur le quartier. Se replonger dans son passé, c’est revenir vingt ans en arrière, une autre époque, une autre vie. Pour beaucoup, c’était l’époque de leur jeunesse. Cela ne s’oublie pas.
En vingt ans, la vie a changé, le quartier a changé, et eux aussi ont changé. Au début, la vie dans les tours, c’était vraiment bien. Il y avait un esprit de communauté Tous se connaissaient et les voisins étaient des amis. Il y avait beaucoup de français, et même des riches. Et puis, peu à peu, cette mixité sociale a disparu. Les plus aisés sont partis les premiers. A la fin il n’est resté là que ceux qui ne pouvaient pas aller ailleurs. Les tours se sont dégradés. Plus rien ne fonctionnait. Même les ampoules des paliers étaient volées. Comme le dit le médecin qui avait là son cabinet, c’était devenu invivable. Et le seul couple de français (c’est comme cela qu’ils se présentent) qui habite encore dans le quartier se sent bien isolé.
Après les émeutes.
Le film d’Alice Diop, Clichy pour l’exemple, trouve son origine, comme d’autres de la même époque, dans les émeutes de 2005. Il est d’ailleurs dédié à Bouma Traoré et Zyed Benna, les deux adolescents dont la mort, à Clichy-sous-Bois, fut leur point de départ. Automne 2005, « les banlieues se rappellent à la République ». Il s’agit alors, presque un an après, de comprendre la révolte des jeunes de ces cités, ce ras le bol qui dégénéra en tant de violence. Les problèmes que connaissaient alors les habitants de ces quartiers défavorisés ont-ils disparu? La cinéaste ne cherche pas à dresser un bilan des actions qui ont été entreprises et de ce qui reste à faire. Elle filme certains aspects de la vie quotidienne. Et surtout, elle donne la parole aux habitants, les jeunes en particulier, ceux qui au sortir de l’école ne trouvent pas de travail, même s’ils ont décroché un diplôme, un BTS par exemple. Ce qui s’exprime alors c’est « la souffrance du quotidien ».
Les problèmes du logement, de l’école, du travail et des transports sont abordés à travers des cas concrets ayant valeur d’exemples parmi tant d’autres. Le logement, ce sont ces grands immeubles regroupés en cités dont des vues d’ensemble nous donnent une idée de leur concentration. Des plans sur Les cages d’escalier recouvertes de tags suffisent à montrer la détérioration, sans parler de cet appartement où il faut enlever la moquette à cause d’infiltration d’eau. Pour l’éducation, nous assistons à un conseil de classe de fin de troisième en collège. Certains élèves, ceux qui ont les meilleurs résultats, sont orientés vers une seconde générale, les autres en BEP. Il est clair qu’ils n’auront pas tous les mêmes chances dans la vie. Mais de toute façon, trouver du travail à Clichy, quand on est de Clichy, même si l’on fréquente assidument la mission locale, est quasiment mission impossible, comme nous le montre le cas de ce jeune quoi n’a jamais « le profil » pour tous les emplois auxquels il postule. Le problème du transport est enfin évoqué dans une réunion des élus du département. Le maire de Clichy plaide pour que sa ville soit enfin désenclavée. Mais visiblement les élus des autres communes n’ont pas l’air particulièrement prêt à le soutenir.
Rénovation
La cité des Bosquets à Montfermeil est en travaux. Les immeubles vont être réhabilités, rénovés. Des tours vont être détruites. Il était sans doute temps de mettre fin à la décrépitude, de montrer que la banlieue peut encore être vivable. Un grand projet d’urbanisme va être mis en œuvre. Une excellente occasion de se pencher sur le vécu des habitants de ces quartiers où prirent naissance les émeutes de 2005.
Florence Lazar filme la cité en longs plans fixes, presque sans mouvement, sans action notoire. Comme si une torpeur s’abattait sur elle dans l’attente du changement. Les seuls moments où il semble se passer quelque chose, ce sont les réunions d’information, la présentation en images de synthèse du nouvel aspect de la ville. En attendant, les habitants ne semblent pas particulièrement concernés. Certains s’interrogent sur les nouvelles couleurs des façades, mais les nouveautés annoncées ne soulèvent pas les passions. Chacun continue sa vie comme si de rien n’était, comme ces deux femmes, assises l’une en face de l’autre sur un tapis posé dans l’herbe. Elles ne savent pas trop de quoi parler. Elles restent ensemble, tout simplement.
3 Portraits de banlieusards
Les jeunes filles.
Elles s’appellent Aïsselou, Rajaa, Farida, Claudie, Kahina, Sarah, Farah, Sébé, Coralie, Roudjey, Hanane, Moufida. Elles ont entre 13 et 18 ans. Elles habitent la Seine-Saint-Denis ou la banlieue nord de Marseille. Elles ont accepté de parler d’elles, de leur vie, de ce qui les identifie comme filles des banlieues : leur langage et leurs relations (on devrait plutôt dire leur absence de relation) avec les garçons.
Ces jeunes filles ont trouvé le moyen d’affirmer leur identité : leur langage. Le langage de leur quartier. Celui qu’elles parlent entre elles et que bien souvent elles sont seules à comprendre. Une langue qui les unit. Qui est presque leur fierté. Même si elles en reconnaissent les limites et les dangers. Pour les banlieusardes du 93, comme pour celles qui vivent dans les quartiers nord de Marseille par rapport aux quartiers sud, il y a une vraie coupure par rapport à Paris, là où on parle correctement, là aussi où on a une image très négative des cités.
Ce langage, il faut savoir aussi y renoncer, à l’école, ou dans le travail, même s’il est devenu une habitude tellement forte qu’il est souvent bien difficile de ne pas l’employer. On voit par-là combien ce vécu linguistique est dans le fond vécu difficilement. Il est dur d’être né dans une cité et d’y vivre. Mais ce qui est particulièrement dur, c’est d’être une fille, une fille des quartiers, une fille qui doit vivre à l’écart des garçons, et qui pour pouvoir vivre en paix doivent se comporter comme des garçons, parler comme les garçons, c’est-à-dire de façon crue et grossière, se battre comme les garçons et toujours paraître méchante. La cité, ça finit par leur faire détester d’être une fille.
Les « roses noires », ce sont ces adolescentes qui cachent leur féminité, et deviennent des « garçons manqués » essentiellement pour échapper au risque de « réputation » que ne manqueraient pas de répandre les garçons de leur collège si elles avaient l’outrecuidance de s’affirmer comme objet de désir masculin. Ou même simplement si les garçons peuvent s’imaginer qu’elles sont tentées de le devenir. Dans les cités, de la banlieue parisienne ou des quartiers nord de Marseille, où la réalisatrice a rencontré ces jeunes filles, paraître féminine c’est être quasi systématiquement taxé de « pute ». Et une telle réputation, qui se répand partout de façon incontrôlable, transforme inévitablement leur vie de collégienne en véritable enfer. Les Roses noires d’Hélène Milano
Les collègiens
La vie, et l’intimité, d’un petit groupe de jeunes de 12 à 14 ans, élèves dans un collège de banlieue parisienne. La vie de la cité a bien de l’influence sur leur vie personnelle, essentiellement par la violence qui y règne, mais pour l’instant ils arrivent à faire face. Ils ne sont pas encore entrés dans la vraie vie. Leur âge les protège. Le collège les protège aussi, du moins lorsqu’ils sont à l’intérieur de ses murs. Grands comme le monde de Denis Gheerbrant,
Les lycéens
Swagger d’Olivier Babinet. Un film sur les jeunes de banlieue. Un de plus. Oui, mais certainement le plus original. Pas vraiment cependant dans le choix des thèmes proposés à cette dizaine d’ados pour ces entretiens éclatés, à savoir, pour les principaux : la question de l’immigration : l’identité nationale, l’appartenance culturelle, la différence entre la vie en France et au bled. Les rêves et projets d’avenir : faire de l’architecture ou se lancer dans la mode en tant que styliste. L’amour : les relations entre les sexes sont toujours difficiles, et de toute façon ne sont pas vraiment une préoccupation majeure. La politique : l’indifférence domine, difficile de se sentir concerné. La religion (catholicisme ou islam) : la grande affaire, un réconfort dans les moments difficiles, un soutien toujours. Mais ces entretiens sont toujours filmés dans des lieux surprenants, dans des cages d’escaliers, dans des couloirs vides, dans des salles du collège, en contre-plongée parfois, en gros plans le plus souvent.
Le commerce.
L’épicerie d’Ali pourrait être le centre du monde. Ce n’est que le centre d’une cité de banlieue. Mais c’est déjà beaucoup. C’est même tout à fait essentiel pour les habitants de la cité. Le seul commerce ! Un lieu de rencontres. Où l’on peut boire un café en discutant. Où l’on peut passer le temps. Combler un moment sa solitude. Où trouver un accueil permanent pour ceux qui n’ont pas d’autre lieu pour continuer à vivre. Et même trouver quelques occupations, faire de la manutention ou livrer des commandes, ou simplement porter le panier d’une vieille dame. Et pour les gosses du quartier, c’est la caverne d’Ali Baba, avec tous ces bonbons qu’on achète par poignées pour quelques sous. Et tant pis pour les dents.
Le film estun portrait de la banlieue elle-même, une banlieue d’avant l’embrasement des émeutes. Un portrait qui ne cache pourtant les difficultés qu’il y a à vivre ici (la Source à Epinay-sur-Seine), comme ailleurs bien sûr, même si ce n’est pas pire qu’ailleurs. Pourtant, si l’on ne peut certes pas dire qu’il fait bon vivre ici, on peut quand même y percevoir des lueurs de bonheur, dans les rires des enfants d’abord, dans la chaleur de l’accueil d’Ali ensuite. Les difficultés, pourtant, sont nombreuses, et de toutes sortes. A côté des problèmes personnels, il y a ce qui touche la vie collective, surtout au niveau matériel, les imperfections de la réhabilitation des immeubles, le manque d’espaces verts et de tout autre aménagement, les ascenseurs qui sont si souvent en panne, ce qui oblige les personnes âgées qui vivent au 8° étage à ne plus descendre de chez elles, de peur de ne plus pouvoir remonter par les escaliers. Tout ceci est bien réel, mais le film ne dresse pas un tableau désespéré de cette banlieue. Ici il n’y a pas de drogue, entend-on dire. Et l’on ne voit jamais la police. Pas parce qu’elle a peur de venir. Simplement on n’a pas besoin d’elle. Alimentation générale de Chantal Briet.
L’administration
Un bureau de poste, à La Courneuve, filmé alternativement du côté du public qui s’amasse devant le guichet et du côté des employés assis de l’autre côté de la vitre de séparation, ou dans la petite salle qui leur sert de lieu de détente.
La première impression du côté du public, c’est un effet de foule, de masse plutôt compacte. On s’entasse, on se serre, on se bouscule. Difficile de bien respecter l’ordre de passage selon les arrivées. D’où quelques tensions. Et quelques récriminations. Mais rien de bien grave. Ils ont l’habitude d’attendre, de ne pas pouvoir à cause des règlements administratifs effectuer ce pourquoi ils sont venus. D’avoir à revenir si possible avec les papiers demandés. Il y a bien le « râleur » de service, mais son discours ne soulève aucun mouvement collectif de protestation. Dans l’ensemble, l’atmosphère reste bon enfant. Il est vrai que les employés, par leur attitude, font tout pour désarmer la tension. De vrais modèles de patience et de compréhension. Ils écoutent, répètent les règlements, s’excusent presque de ne pas pouvoir accéder aux demandes. Il faut dire que les personnes en face d’eux ont souvent des difficultés insurmontables et ils le savent.
Ces difficultés sont surtout des difficultés d’argent, en dehors des problèmes de papier plus fondamentaux sans doute, mais l’argent, c’est le quotidien, l’immédiat. S’ils viennent à la poste, c’est pour retirer de l’argent. De quoi vivre au jour le jour. Toucher un mandat, toucher des allocations, le RMI, le chômage. Ou prélever les maigres économies qui restent encore sur un livret. Plus rarement, ils viennent faire un dépôt ou ouvrir un compte, mais toujours c’est d’argent qu’il s’agit. Et les plans où l’on manipule les billets, où on les compte sont nombreux. Aujourd’hui, le film nous replonge dans le vieux temps où cet argent était des Francs. Une poste à La Courneuve de Dominique Cabrera
La musique.
93 La belle rebelle de Jean Pierre Yhorn est l’histoire de la vie musicale de Seine-Saint-Denis, depuis le premier déferlement du rock chez les yé-yés des années 60 jusqu’à la vague rap des années 2000. En même temps, le film montre l’évolution de ce département qui deviendra le symbole de la banlieue française et de ses échecs. Un département qui pourtant pouvait offrir des raisons d’espérer une vie meilleure à ses habitants. Ceux qui trouvaient justement dans la musique le moyen de se construire un avenir, une vie à leur dimension.
Thorn rencontre donc les figures de proue de ces jeunes musiciens qui vont participer à la révolution de la scène musicale française qui marquera la seconde moitié du XX° siècle. Il nous fait d’abord écouter leur musique, par des extraits d’émissions de télévision, ou de concert, des moments de répétition aussi et des prestations privées, rien que pour le film. Nous pouvons ainsi voir et entendre NTM, dès le pré-générique et que nous retrouvons dans la seconde partie du film consacrée au Hip Hop, au rap et au Slam, avec entre autres Dee Nasty, Casey, B-James, Abdel Haq, bams et Grand Corps malade. Les années 60 étaient celles du rock. Puis vint la radicalisation contestatrice très politisée du Punk qu’évoque longuement Bérurier noir. Et même, en dehors de ces tendances électriques, un accordéoniste comme Marc Perrone.
Toutes ces musiques issues de la banlieue chantent ses difficultés, sa misère, mais aussi ce qui en fait la grandeur, l’amitié et l’entraide. Les entretiens qui accompagnent les séquences musicales la force du lien qui relie ces banlieusards à ce territoire qu’ils savent déshérité et laissé pour compte de la société française, mais qui fait partie d’eux-mêmes et pour lequel ils manifestent un profond attachement. Si la violence conduisant aux émeutes de 2005 est toujours présente sous forme larvée, on sent bien que c’est le chômage, les rapports plus que tendus avec la police (et donc toute forme d’ordre et l’Etat en général) et les images négatives que véhiculent les médias qui vont l’exacerber jusqu’à l’explosion.
Faire du théâtre à Paris.
La Mort de Danton d’Alice Diop relate l’aventure d’un jeune noir originaire du 9-3, Steve, qui veut devenir acteur et pour cela fréquente le Cours Simon à Paris, prestigieuse école de formation théâtrale. Une aventure tant sa présence dans l’école est originale, presque inédite, et ne manque pas d’ailleurs de poser bien des problèmes, au point que Steve cache cette activité à ses copains de banlieue. Une aventure dont l’issue est bien incertaine. Devenir acteur de théâtre n’est jamais facile ; pour Steve plus particulièrement. En fonction de son origine bien sûr. Mais surtout en fonction de sa position sociale et culturelle. Ce qui est en jeu alors c’est la distance entre les habitants des cités et ceux des beaux quartiers.
Lorsque Steve quitte son quartier, il ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’image de lui que se font les autres. Steve vit très mal cette impression que ceux qui sont différents de lui, par la couleur de la peau, par le langage, par l’origine et le milieu social, par la culture aussi, cette impression que les autres ont peur de lui et donc le fuient, évitent de s’assoir à son coté. D’ailleurs, pour Steve, ce n’est pas qu’une impression, mais une réalité qu’il a effectivement vécue. « Je ne me sens pas à ma place » dit-il, même si en apparence les élèves du cours Simon n’ont pas l’air de le tenir à distance. Mais tel qu’il est, avec son physique, son maintien corporel, les tonalités de sa diction, il est et restera différent des autres.
Et même la poésie
Une vision de la banlieue comme on ne la voit pas d’habitude. Une vision littéraire, poétique plus exactement, une vision de poète, la vision du poète.
La vision d’une cinéaste aussi, qui accompagne le poète, qui filme le poète, qui fait un film poétique.
Banlieue et poésie, qui aurait cru que cette rencontre se ferait un jour.
La banlieue, c’est le quartier de Maurepas, à Rennes. Un quartier que beaucoup de ceux qui n’y vivent pas doivent désigner comme sensible. Un quartier conçu en 1967, avec cinq tours et une série de bâtiments plus petits, moins hauts, formant des bars. Un quartier « où plus personne ne choisit d’habiter » Un quartier qui a ses problèmes, sa violence, ses dégradations…Et pourtant. « Dans ce quartier, on existe » dira vers la fin du film une de ses habitantes qui a du mal de le quitter pour aller habiter en dehors de la cité. Comment cela est-il possible ?
Le poète, c’est Yvon le Men. Il vient vivre en résidence (trois mois) à Maurepas. Il vient regarder et écouter, comme il dit. Et il écrit. Il écrit au jour le jour, des poèmes qui nous sont proposés en voix off et qui constitueront in fine un « poème-reportage » long d’une centaine de pages, publié sous le titre Les Rumeurs de Babel.
La cinéaste, c’est Brigitte Chevet. Elle filme la banlieue comme d’autres cinéastes l’ont déjà filmée, les immeubles la nuit, des vues d’ensemble le jour en plongées, les escaliers avec leurs graffitis et la voiture de police au pied des tours. Mais surtout, elle filme les habitants, ceux que rencontre le poète et qui s’entretiennent avec lui, et ceux, anonymes, qui vivent là, qui sont la vie du quartier. Car ce quartier vit.
A Marseille
La République Marseille
La Marseille de Denis Gheerbrant, ce n’est pas le Marseille touristique du Vieux Port ou de la Canebière. Ce n’est pas le Marseille des beaux quartiers. C’est la Marseille populaire, la Marseille des Marseillais qui ne sont pas tous nés à Marseille mais qui y sont restés lorsqu’ils ont immigré en France. Gheerbrant va à la rencontre de ce Marseille cosmopolite, de ces Marseillais qui souffrent mais qui gardent le sourire et pour qui il a visiblement une grande sympathie.
La vie dans cette cité de banlieue (les « Rosiers ») devient de plus en plus difficile. Le chômage, les discriminations, le racisme sont monnaie courante. Difficile surtout pour les jeunes d’avoir des perspectives d’avenir. Jean-Yves, le directeur du centre social Les Rosiers est sans illusion. Pourtant, il ne baisse pas les bras. Ce travail, il l’a choisi. Et il croit toujours à l’utilité des petites actions quotidiennes qui sont autant d’aides personnelles indispensables, aider à la rédaction du CV par exemple ou apprendre à lire à des femmes africaines. Pour les enfants, découvrir un conte, ou faire du karaté sont des occasions d’oublier que certains ne mangent pas toujours à leur faim.
4 Et ailleurs
États Unis.
Nous sommes à New York, contre toutes apparences. Plus précisément, nous sommes dans le Queens. Un quartier qui s’appelle Willits Point. Et que ses habitants nomment le Junkyard. Un quartier qui doit être détruit au profit d’une vaste opération immobilière de luxe. En attendant c’est un quartier salle et laid. Plein de boue et d’eau. Une rue centrale, bordée de magasins de pièces détachées et autres accessoires automobiles. Ici, c’est la récupération qui domine, dans ces véhicules voués à la casse. On y vient pour trouver ce qu’on ne trouve pas ailleurs, et au prix le plus bas, qu’on peut toujours faire baisser.
Le film se déroule au fil des saisons. Chaleur l’été et neige l’hiver. Et surtout de l’eau, beaucoup d’eau. Les pluies d’orage provoquent des inondations, mais cela n’empêche pas les déplacements, de l’eau jusqu’aux genoux ou en cherchant des appuis sur les façades des boutiques. Nous passons d’une situation à l’autre sur un rythme très rapide. Des petites touches qu’on aimerait parfois prendre le temps d’approfondir un peu plus. Mais on finit par s’habituer. Au faut c’est la vue d’ensemble qui compte. Le rythme du film est celui du quartier.
Dans cette immersion, nous rencontrons quand même quelques personnages. Un couple par exemple. Elle dit être la seule blanche du quartier, ce qui l’expose particulièrement. Elle est filmée dans la voiture où elle passe ses nuits, armée d’une clé métallique pour se défendre, au cas où. Elle attend son compagnon qui est en prison pour trafic de drogues. Le jour de sa libération, c’est la fête pour eux.
La fête, il y en a une autre, pour l’anniversaire de Julia. Le gros gâteau est découpé en gros plan. Et on danse sur un rythme portoricain. Une communauté très présente ici.
Chicago
Le film s’ouvre sur des plans fixes, en plongée ou à ras du sol, sur des immeubles de brique, puis sur les habitants du quartier, tous noirs. Nous sommes à Chicago, dans une cité de banlieue dénommée Ida B. Wells. On y trouve les mêmes problèmes que dans les banlieues françaises, le chômage, l’oisiveté des jeunes, les rivalités entre gangs, la violence, la drogue. Beaucoup d’appartements sont insalubres et envahis par les cafards. Mais tous ne sont pas logés et il y a un nombre important de SDF. Ce quartier est un ghetto.
La police est omniprésente dans le film, parce qu’elle est omniprésente dans le quartier. La séquence d’introduction qui plante le décor se termine par une voiture de police qui fonce sur une avenue, sirène hurlante. Dans les plans de rue pris au pied des immeubles qui jalonnent tout le film, il n’est pas rare de voir deux policiers en patrouille ou fouillant des hommes, mains sur un mur. Plusieurs séquences sont d’ailleurs consacrées à l’action des policiers, comme si ceux-ci avaient accepté que l’équipe du cinéaste les accompagne dans leur travail. Nous assistons ainsi à des interpellations, une jeune femme, ancienne droguée, à qui le policier donne des conseils pour s’en sortir, un petit groupe de jeunes soupçonnés d’avoir volé un réfrigérateur, des inconnus dans le quartier dont ils contrôlent l’identité. Un soir, un vieil homme, lui aussi toxicomane, se réfugie au poste de police car il est poursuivi par un gang à qui il doit de l’argent. Tous ceux qui sont ainsi interrogés par les policiers ont déjà eu affaire à la justice. Beaucoup ont déjà été condamné et ont fait de la prison. La consommation de toutes sortes de drogues est générale. Le tableau est particulièrement sombre.
Wiseman filme la pauvreté et la misère mais le ton de son film n’est jamais désespéré. Il y est question de violence, mais Wiseman ne la filme pas. Il n’y a pas d’émeute à I. B. Wells. Le film met plutôt en évidence le travail des associations et des gens qui œuvrent pour améliorer le sort de leur communauté. Dans le film des solutions existent. Des opérations sont lancées, souvent par des initiatives privées, comme l’opération propreté et l’opération lavage de voiture. Des actions éducatives sont menées auprès des jeunes, dans un collège et même dans une maternelle où une marionnette met en garde les enfants contre les dangers de la drogue. « Si tu aides, tu seras aidé » dit un habitant lors d’une réunion visant à mobiliser en vue d’actions d’entraide. Le film se termine par une conférence faite par un ancien joueur de Basket. Il a une fonction officielle mais il se présente comme un « frère ». Son discours vise à pousser les jeunes à créer des entreprises. Pour lui, c’est la solution. Le film ne dit pas si ses interlocuteurs y croient vraiment. Public Housing de Frederick Wiseman.
Références
Chroniques d’une banlieue ordinaire. Dominique Cabréra, 1992, 55 minutes.
Clichy pour l’exemple. Alice Diop. 2006, 50 minutes.
9-3 Mémoire d’un territoire de Yamina Benguigui, 2008.
Les Bosquets, Florence Lazar, 2010, 50 minutes
Les Roses noires de Hélène Milano, 2012, 74 minutes
Alimentation générale de Chantal Briet, 2005, 85 minutes
Une poste à La Courneuve. Dominique Cabrera, 1994, 54 minutes
Grands comme le monde. Denis Gheerbrant, 1998, 91 minutes
Swagger. Olivier Babinet, 2015, 84 minutes
93 la belle rebelle. Jean-Pierre Thorn, 2010, 73 minutes.
La mort de Danton. Alice Diop, 2011, 64 minutes.
Foreign parts. Véréna Paravel, John-Paul Sniadecki, Etats-Unis, 2010, 77 minutes.