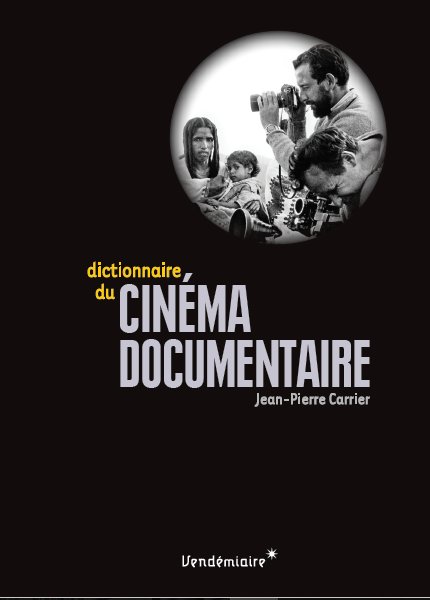4 Gaza
Aisheen. Still live in gaza, Nicolas Wadimoff, 2010, 86 minutes.
Après la guerre, la paix existe-t-elle ?
A Gaza, est-il possible de vivre en paix ? Après toutes ces bombes qui sont tombées du ciel. Après tous ces morts. Plus de 1400. Après toute cette destruction.
La guerre dont le film de Nicolas Wadimoff nous montre « l’après », c’est « Plomb durci », une opération de l’armée israélienne en décembre 2008 – janvier 2009, qui a mis à feu et à sang l’ensemble de la bande de gaza.
Gaza, ce petit territoire le long de la mer, où ses habitants palestiniens sont tenus prisonniers par le blocus imposé par Israël. Des habitants-prisonniers qui ne peuvent s’échapper lorsque les bombes tombent des avions.
Gaza, un territoire dévasté.
Le film commence dans un parc d’attractions. Enfin, ce qu’il en reste. Un enfant demande au gardien où est la cité des fantômes. Oui, dans le parc il y avait bien une cité des fantômes. Maintenant, c’est la ville dans son ensemble, la ville de Gaza, qui est une cité de fantômes. Le film se terminera dans ce même parc d’attractions. A force de bricolage – il n’y a plus de pièces de rechange à Gaza, alors il faut les fabriquer comme on peut – un des manèges pour enfant, la toupie, peut à nouveau tourner. La caméra prend place dans le manège et les images qui défilent tout autour peuvent presque nous faire retrouver des sensations de l’enfance. Mais les enfants peuvent-ils vraiment oublier la guerre ?
Des enfants palestiniens, le cinéaste en rencontre beaucoup dans son périple dans Gaza détruite. Dans le Zoo de la ville, où la mort a aussi frappé les animaux. Dans les camps de réfugiés. Sur la plage où les filets ne prennent même plus de poisson. Dans le centre de loisirs où un spectacle de clown leur est proposé. Les ballons en baudruche qui explosent rappellent les bombes bien réelles qui tombent encore tout près. Comme dans le jeu de rôles qui est mis en place par un animateur –il s’agit de jouer un des contrôles de la population à un check point – il ne s’agit pas d’oublier la guerre ni de s’habituer à elle de façon avec résignation, mais d’en comprendre les effets pour mieux entreprendre de construire la paix.
« Il faut garder le soleil dans tes yeux » Un message d’espoir. Mais lorsqu’on voit les ambulances bloquées sur la route ou la bousculade impressionnante lors de la distribution alimentaire au centre des
Put your soul on your hand and run. Sepideh Farsi, France, Palestine, Iran, 2025, 112 minutes.
Cinéaste iranienne exilée à Paris. Sepideh Farsi peut être considéré comme le modèle de cinéaste engagée. Elle a réalisé à ce jour une dizaine de documentaires portant sur la situation politique en Afghanistan, en Iran, en Grèce. Situations souvent marquées par la condition d’exilée. (voir son abécédaire https://dicodoc.blog/2025/05/28/sepideh-farsi-abecedaire )
Son dernier film en date, Put your soul on your hand and run, concerne Gaza. Gaza où elle ne peut rester indifférente au massacre perpétré contre les Palestiniens, hommes, femmes et enfants.
Ne pouvant se rendre à Gaza du fait du blocus imposé par l’armée israélienne, Sepideh Farsi va utiliser les moyens modernes de communication, la visio à partir d’un téléphone portable, pour avoir un regard direct et concret sur le vécu de ces prisonniers de la guerre qui n’ont aucun moyen d’échapper aux bombes qui détruisent les immeubles de leur quartier et tuent leur proches, voisins et famille.
Le film prend donc son point de départ et trouve sa substance tout au long de ces presque deux heures de durée, dans la rencontre avec une jeune femme. Fatma Assona photographe de son État et qui s’efforce, malgré des conditions de vie et de travail particulièrement périlleuses, de documenter cette guerre destructrice, et aussi, sa propre vie sous les bombes et dans les ruines de plus en plus importantes.
Une jeune femme dont on ne peut qu’admirer le courage et dont le sourire éclatant, surtout au début du film est une vraie leçon de vie. Pourtant, la dimension mortifère de la guerre se fera de plus en plus ressentir tout au long du film. Jusqu’au panneau final annonçant que Fatma, et toute sa famille, a été tuée par une frappe israélienne la visant spécialement. Comme tous les journalistes, photographes et reporters.
La cinéaste iranienne se sent alors investie de cette mission de perpétrer la mémoire de celle qui est devenue son amie, à travers ces images de plus en plus dégradées par les mauvaises conditions de connexion Internet. En même temps, elle se doit de dénoncer le côté aveugle et de plus en plus inhumain de cette guerre qui vise de plus en plus explicitement l’anéantissement du peuple palestinien et la destruction totale de Gaza.
Son film est un montage extrêmement précis des conversations en direct, avec ses coupures de connexion et les difficultés rencontrées systématiquement pour la rétablir ou même simplement l’établir. Images au format du téléphone qui alternent avec les photos envoyées par Fatma, des photos d’une qualité stupéfiante montrant la destruction de Gaza et la survie en particulier des enfants au milieu des ruines. À cela Farsi ajoute quelques images d’informations télévisées. Façon d’impliquer davantage ceux qui ne peuvent qu’assister de loin à cette guerre dans laquelle il est non seulement urgence de s’impliquer, mais aussi d’agir de façon militante.
Put your soul on your hand and run est donc un film dont on ne sort pas indemne, un film qui ne cherche pas à faire de la guerre un spectacle, mais qui fait que le bruit des bombes n’empêche pas Gaza de vivre.
Yallah Gaza. Roland Nurier, 2022, 101 minutes.
Gaza sera-elle un jour – prochain – entièrement détruite ? Dans le film de Roland Nurier elle est encore debout. Blessée, mais vivante. Et ses habitants peuvent encore espérer vivre un jour en paix. Même si la paix – la vraie paix, la paix définitive – semble de plus en plus s’éloigner au fil du temps.
Comme dans son précédent film, Le Char et l’olivier, consacré à l’histoire de la Palestine, Roland Nurier convoque d’abord des experts, des historiens surtout, français et américains, mais aussi des habitants de Gaza, ou ceux qui l’ont connue de l’intérieur, des Palestiniens en premier lieu, mais aussi des Israéliens, ceux qui contestent et refusent la politique d’occupation menée par leur pays. Comme la politique d’apartheid qui sévit en Israël vis-à-vis des arabes et particulièrement des Palestiniens. Tous leurs propos nous apportent des éléments de connaissance qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé à ce blocage et la disparition des espoirs suscités par les accords d’Oslo. On est si loin aujourd’hui de la poignée de main entre Béguin et Arafat. On est si loin de l’idée d’un État Palestinien. C’est plutôt la perspective du grand Israël qui est en marche.
Ces rappels historiques que nous propose donc le film visent donc essentiellement à rétablir la vérité des faits, au-delà des imprécisions et des contre-vérité propagées par bien des médias dans la ligne direct de la propagande israélienne. Comme par exemple celle qui affirme que les Palestiniens n’ont pas été expulsés de chez eux, ils sont partis d’eux-mêmes. Réécrire l’histoire a toujours été une arme idéologique !
Film de connaissance, Yallah Gaza est aussi un film de résilience. Lors des marches du retour – des manifestations qui se voulaient pacifiques- les snipers israéliens utilisent des balles réelles contre les jeunes palestiniens, visant particulièrement les jambes, occasionnant de nombreuses amputations, ce qui n’empêche pas ces jeunes de jouer au foot sur leurs béquilles. Tout au long du film, nous retrouvons ces danseurs et danseuses, habillé.e.s de noir dans les ruines des immeubles détruits par les bombes, mais luttant pour préserver leurs traditions. Comme aussi ce street artist réalisant une œuvre porteuse d’espoir. Gaza a toujours su préserver sa culture. Son université, au moment de la réalisation du film, reste des plus actives. Jusqu’à quand cette réalité restera-t-elle vivante ? Car ce que veut montrer le film, c’est que Gaza souffre, étouffée par le blocus imposé par Israël. Le film ne cherche pas à prédire l’avenir et ne propose pas de solution. On a plutôt l’impression en le voyant que toutes les propositions de résolution du problème palestinien qui ont pu être formulées sont soit tombées dans l’oubli soit devenues obsolètes. Gaza, une cocotte-minute où la pression de plus en plus forte ne pouvait que conduire à l’explosion.
Yallah Gaza est un film résolument engagé du côté palestinien. Doit-on le lui reprocher. Il ne cache pas son engagement. En cela il se présente ouvertement comme un film militant. Pourquoi alors devrait-il nécessairement présenter le pour et le contre et essayer de se situer des deux côtés de la barrière, au risque de ne favoriser que des confusions ?
Samouni raod, Stefano Savona, 2018, 128 minutes.
Gaza en guerre. Gaza dans la guerre. Celle de 2008-2009. Gaza sous les bombes israéliennes. Ou l’opération terrestre. Gaza meurtrie, détruite. Des hommes, des femmes, des enfants, des civils, tués, blessés. Gaza martyr. Comment Gaza pourra-t-elle guérir ses plaies ?
Stefano Savona s’est rendu à Gaza après la guerre. Un séjour long. Dans une famille de Gaza. Avec les survivants de cette famille, les Samouni, en grande partie décimée. 29 morts dans leurs rangs. Et combien de blessés ? Une famille de paysans, attachés à leur terre, à leurs oliviers. Une famille paisible. Qui ne demande rien d’autre que de vivre en paix. Loin des affrontements. A l’abri de la guerre. Mais en Palestine, et surtout à Gaza, personne n’est à l’abri de la guerre.
La première partie du film est centrée sur les enfants survivants et en particulier Amal, cette petite fille qui a été blessée et sauvée in extrémis dans les décombres de la maison. Peut-elle retrouver la joie de vivre, de jouer ? Savona filme le quotidien de la famille. La cuisson du pain. Les disputes des enfants. Le temps semble comme arrêté et le film ici est plutôt lent. Mais l’irruption de la guerre changera tout.
Le cinéaste n’a pas filmé la guerre. Mais il va en rendre compte dans la partie centrale de son film grâce à des animations et une reconstitution en 3D de l’opération israélienne contre la maison des Samouni. Dans la première partie du film les dessins en noirs et blanc évoquent d’abord le passé, le temps d’avant la guerre, la présence du père qui sera tué froidement par les soldats israéliens. Un père qui a tout fait pour protéger sa famille, ses enfants. Mais que pouvait-il devant ces soldats qui sont présentés comme des tueurs. Pourtant dans l’engin (hélicoptère ou drone) qui survole la maison des Samouni, un soldat après avoir tiré par deux fois, refuse de tirer à nouveau sur ceux, des silhouettes blanches sur son écran, qui fuient le feu et la fumée dans la maison. Le commandant insiste à plusieurs reprises pour qu’il tire. « Il y a des enfants, ce sont des civils répond-il » Une partie de la famille Samouni échappera au massacre.
Lorsque le film en revient aux images filmées, c’est pour montrer les dégâts de cette guerre, les maisons détruites. Même la mosquée. Des tas de ruines dans lesquels il n’est pas possible de récupérer quoi que ce soit. Le chantier pour redonner forme humaine à ce quartier parait impossible à mener à bien. On ne le verra pas. Un carton annonce « un an plus tard ». Nous revenons sur les lieux de la guerre. Mais c’est pour assister au mariage des deux fiancés qui avaient tant hésité à franchir le pas. Le film se termine par cette fête, gage d’avenir. La guerre n’a pas détruit le désir de vivre.
Utiliser l’animation comme le fait ici Savona a certes comme première utilité, pour première fonction, de suppléer à des images manquantes. Savona n’a pas filmé la guerre. Il n’a pas voulu filmer la guerre. Il va la reconstituer avec des images dessinées et des images numériques. La guerre est donc bien présente. Mais pas dans son réalisme cru comme on en trouve souvent à la télévision. Dans les reportages télévisés. Le film de Savona n’est pas un reportage. Il n’explique pas les raisons de la guerre. Il ne dresse pas son bilan militaire. Ce qui l’intéresse c’est la famille Samouni. Les enfants surtout. Et leur vie après la guerre – ou avant, car on peut penser que c’est la même. Du coup, si les images animées déréalisent la guerre, elles ont un pouvoir émotif encore plus grand. Car pour tous ceux qui ne vivent pas en Palestine, qui ne connaissent la Palestine que par les images (celles de la télévision le plus souvent), la guerre finit par faire partie d’un imaginaire particulier, pas nécessairement guerrier, mais marqué par la souffrance et la mort.
Plomb durci, Stephano Savona, 2009, 80 minutes.
Début janvier 2009, dans la bande de Gaza. Cela fait déjà une dizaine de jours que les bombardements israéliens de l’opération baptisée « Plomb durci » sèment la désolation et la mort. Une situation chaotique que va filmer Stephano Savona, au cœur même de l’événement, au plus près de cette population meurtrie. Mais il filme en véritable cinéaste et non en journaliste. Et son film n’a rien d’un reportage.
D’abord parce qu’il ne filme pas les bombes. On entend bien dans la bande son des explosions d’obus. On voit bien, au loin, des colonnes de fumée. Mais justement elles sont au loin. Les bombes tombent sur des maisons, des immeubles, où n’est pas le cinéaste. Et s’il n’y est pas, ce n’est pas par peur, ou pour se protéger. C’est plus simplement parce que son projet n’est pas de filmer les bombes. Ni les avions qui les larguent d’ailleurs. Si on entend leur grondement, ils restent aussi hors champ. Rendre compte de la guerre, ce n’est pas seulement filmer les armes et le feu des armes.
Savona filme le peuple de Gaza. Ces Palestiniens qui comptent leurs morts et leurs blessés. Ces hommes et ses femmes qui ont tout perdu dans la destruction de leur maison, qui racontent comment ils ont dû fuir de leur maison pour ne pas être ensevelis sous les décombres. Il filme les adolescents qui errent dans les décombres pour montrer les dégâts, ou pour récupérer ce qui peut l’être encore. Tous sont hagards, perdus dans leur ville qu’ils ne reconnaissent plus, qu’ils ne peuvent plus reconnaître.
Par deux fois, dans son film, et dès la première séquences, Savona nous fait entendre le discours officiel israélien, une tentative de justification de leur action contre Gaza, contre le Hamas. Le peuple palestinien n’est pas l’ennemi d’Israël, nous assure-t-on, et l’armée israélienne fait tout son possible pour ne pas causer de dommage aux civils. Tout le film de Savona montre simplement la dimension dérisoire – le cynisme – d’une telle déclaration.
Et le film accumule les vues de décombres, d’immeubles éventrés, de maisons réduites à un tas de pierre. Reste-il dans Gaza une seule habitation debout ? Dans le film de Nicolas Wadimoff, Aisheen, still live in Gaza, tourné lui aussi dans Gaza au lendemain de l’opération « Plomb durci », il reste encore en vie quelques animaux dans le Zoo et dans le parc d’attraction un des manèges peut être remis en état de marche. Dans le film de Savona rien de tel. Gaza semble simplement raillée de la carte.
Il y a beaucoup d’enfants à Gaza et Savona les filme souvent en gros plans, montrant leur tristesse, leur impuissance, leur colère et leur révolte contenues. Auront-ils d’autre choix, dans leur avenir, que d’entrer eux-aussi en résistance ?
Dans une séquence particulièrement émouvante, la caméra s’arrête un long moment sur un petit, tout juste deux ans peut-être, qui regarde le ciel hors champ, parce qu’il entend, comme nous, le bruit d’un avion. Une cible si facile.
Références
Aisheen. Still live in gaza, Nicolas Wadimoff, 2010, 86 minutes.
Put your soul on your hand and run. Sepideh Farsi, France, Palestine, Iran, 2025, 112 minutes.
Yallah Gaza. Roland Nurier, 2022, 101 minutes.
Samouni raod, Stefano Savona, 2018, 128 minutes.
Plomb durci, Stephano Savona, 2009, 80 minutes.