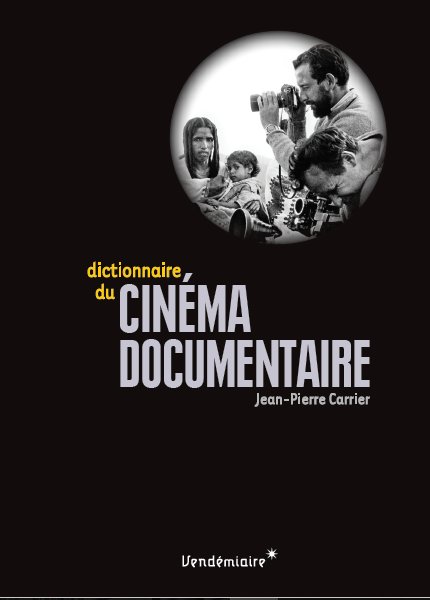5 Syrie, Irak, Daech
Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts, Syrie, 2019, 95 minutes.
Sama est née pendant la guerre, à Alep, ville où la révolution contre le régime de Bachar el-Assad a connu ses heures de gloire avant d’être assiégée – un très long siège – et en grande partie détruite par l’armée du dictateur. Sama a passé la première année de sa vie à Alep, pendant la guerre, sous les bombes, au milieu de la souffrance des blessés et de la douleur de tous ceux qui ont perdu un des leurs. Sera-t-elle à jamais marquée par ces images d’horreur ?
La mère de Sama, Waad, est journaliste. Elle devient cinéaste pour rendre compte de cette guerre, de cette horreur. Elle ne quitte jamais sa caméra et filme quasi en continu, depuis les débuts de la révolution syrienne, jusqu’à sa répression, grandissant sans cesse, allant jusqu’à la destruction de la ville. Des images qu’elle envoie le plus souvent possible à l’étranger, pour alerter, pour crier au secours aussi, demander de l’aide, briser l’indifférence générale. Son film en sera le condensé, la quintessence.
Le père de Sama, Hamza, est médecin, Il travaille dans un hôpital. Lorsque les lieux de secours aux blessés seront détruits par les bombes, il créera son propre hôpital, où jour et nuit il essaiera de sauver des vies. Le film de sa femme suit ce travail, sans rien en négliger, sans minimiser l’horreur de cette guerre, la mort omniprésente.
Pour que son film ne soit pas un simple reportage de type télévisé, Waad – avec l’aide de Edward Watts – va lui donner la forme d’une lettre, une lettre adressée à cette fille tant aimée, Sama, née dans cette guerre. Elle s’adresse à elle en voix off, pour dire l’horreur de la guerre et sa douleur, mais aussi pour proclamer haut et fort la nécessité de la résistance, la beauté de la lutte pour la liberté et son espoir d’une vie heureuse dans un pays sans dictature. Une vie qui devrait être celle de sa fille.
Aux images tournées dans l’hôpital de Hamza – des images qui ne peuvent être que des images de sang et de mort – le film ajoute des images d’archives qui nous permettent de revoir le soulèvement de la jeunesse d’Alep, les manifestations du début de la révolution. Des images d’espoir même si très vite la répression se met en place.
Il y a aussi des images de bonheur, comme celles du mariage de Waad et Hamza ou de la naissance de Sama. Mais ce qui domine ce sont des images qui peuvent être parfaitement insoutenables, comme cette longue séquence où arrive à l’hôpital une femme blessée. Elle est enceinte de 9 mois. Il faut pratiquer une césarienne pour tenter de sauver l’enfant. Mis au monde, il ne respire pas. Alors le médecin le frotte, le secoue, le frotte encore et encore, sans arrêt, sans renoncer une seconde. Longtemps, très longtemps. Et le miracle se produit. L’enfant ouvre les yeux et pousse son premier cri. La mère aussi sera sauvée. Ce dénouement heureux condense toute la force du film. Et comment il faut être confronté à l’horreur pour pouvoir donner vie à l’espoir d’un autre monde.
Parmi les films de guerre, et en particulier, ceux tournés en Syrie, Pour Sama est sans doute un des plus durs, celui qui secouera le plus les spectateurs. Mais c’est aussi qui affirme le plus la nécessité du cinéma documentaire. Au-delà de l’hommage qu’il rend aux combattants de la révolution et aux médecins et secouristes qui affrontent quotidiennement la souffrance et la mort, c’est aussi un hommage aux cinéastes, ceux qui risquent leur vie pour filmer la guerre, sous les bombes. Grâce aux images de Waad, Alep détruite restera quand même vivante
Still recording, Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub, Syrie-Liban, 2019, 128 minutes.
Filmer la guerre, est-ce possible ? Mais la question fondamentale n’est pas comment filmer la guerre, mais plutôt pourquoi la filmer. Question que les cinéastes des pays en guerre ne peuvent pas ne pas se pose. Particulièrement en Syrie.
Still recording n’a rien d’un reportage télévisé. Il est d’ailleurs tout autant éloigné du photojournalisme et du cinéma anglo-saxon qui s’en inspire – par exemple dans le film américain de Nick Quested et Sebastian Junger, intitulé Hell on hearth. Pourtant nous avons bien ici aussi des immeubles en ruines dans toutes les rues où des hommes portant tous une kalachnikov ou un lance-roquettes courent pour se mettre à l’abri des tirs de snipers ; nous entendons bien le grondement menaçant des bombardiers dans le ciel et les explosions assourdissantes des obus tout près des caméras. La guerre faite de feu et de sang est présente à chaque plan, ou presque. Et s’il y a parfois quelques moments où on pourrait l’oublier (dans une exposition de sculpture par exemple), cela ne dure jamais bien longtemps. Alors où réside la différence ?
En premier lieu, elle tient clairement dans la différence des images qui nous sont proposées. Dans Still recording – comme c’était déjà le cas dans Eau Argentée d’Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan – nous n’avons pas vraiment affaire à des images de cinéma, à des images professionnelles, faites par des professionnels, selon toutes les lois bien établies du spectacle cinématographique. Dans Eau Argentée, le cinéaste utilisait, dans la première partie du film, des images issues des réseaux sociaux, faites-le plus souvent avec des téléphones portables, donc des images qui n’étaient pas destinées à être diffusées sur un écran de cinéma, des images qui n’avaient dans leur facture aucun souci du cadre, qui le plus souvent n’arrivent pas à une stabilité suffisante pour que le spectateur puisse identifier ce qu’elles montrent. Ici, de la même façon, dans des situations particulièrement chaudes, lorsque les balles sifflent de partout, ceux qui veulent quand même, au péril de leur vie, faire des images, n’ont pas vraiment le souci de faire du cinéma, de faire de « belles images » de cinéma.
Pourtant, L’incipit de Still recording contient une séquence où un « instructeur » – un cinéaste ? – montre, à partir d’images provenant d’un blockbuster américain projetées sur un drap blanc, comment fonctionne, comme est construite, une image de cinéma, en insistant en particulier sur le rapport entre le champ et le hors-champ. Ceux qui sont ainsi initiés au langage cinématographique sont ceux-là mêmes qui vont filmer la situation de la ville assiégée de Douma dans la Ghouta orientale – ils sont une quarantaine. Ils réaliseront effectivement 450 heures de rushes. Mais dans le feu de l’action, sur le terrain de la guerre, le souci de l’image n’est certes pas premier. Il disparaît même complètement lorsqu’il s’agit de sauver sa vie. Et pourtant, ces images existent. Elles ont été montées pour donner naissance à un film. Car l’essentiel pour les cinéastes – et c’est ce que dit clairement le titre du film – c’est de continuer à filmer. Filmer « quoi qu’il en coûte », pour reprendre une formule de Georges Didi-Huberman.
Still recording se termine par un long plan fixe – ou presque fixe- qu’on pourrait dire magnifique, ou tragique, ou même sublime, si l’on était dans un cinéma dominé par un souci esthétique. Des combattants, accompagnés d’un filmeur (ou peut-être deux), sont pris dans une rue sous le feu d’un sniper. Le filmeur est touché et tombe au sol, ne pouvant fuir. La caméra est ainsi abandonnée au milieu de la rue. Elle continue de tourner, nous montant un espace vide, au ras du sol, où rien apparemment ne se passe. Nous entendons simplement la voix d’un des combattants qui a dû se mettre à l’abri indiquer au blessé comment essayer de se protéger. Puis c’est une dernière balle qui, à n’en pas douter, achève le caméraman. Et la caméra continue d’enregistrer.
En fin de compte, Still recording n’est pas un film sur la Syrie, un film sur la guerre en Syrie, même s’il dénonce avec véhémence les crimes du régime de Bachar El-Assad, en particulier son utilisation des armes chimiques. C’est un film sur le cinéma, ou plus précisément un film sur le rapport du cinéma et de la guerre.
Hell on earth, de Sebastian Junger et Nick Quested à propos de la Syrie.
La guerre en Syrie, Hell on earth nous la montre comme si nous y étions, nous plongeant au cœur des combats, au milieu des hommes en armes, courant pour essayer d’échapper à la mitraille (on entend bien sûr les balles exploser de toute part), ou sous les bombes, au milieu des immeubles en flammes, à côté des survivants à la recherche des leurs, de leurs enfants, qu’on a bien du mal à extraire des décombres. Une pratique donc de photojournalisme, comme les reportages télés nous en montrent, une profusion d’images de feu, d’armes qui font feu (et pas seulement des fusils ou des kalachnikovs, mais aussi des armes plus « lourdes »). Il s’agit explicitement de s’engager au cœur des situations les plus dangereuses, où les porteurs de caméras semblent ignorer le danger, ou du moins font visiblement passer la quête des images avant leur propre vie. Et du coup les combattants deviennent immédiatement des héros, du seul fait que les filmer est lui-même un acte d’héroïsme
Sinjar, naissance des fantômes. Alex Liebert et Michel Slomka, France, 2020, 103 minutes.
Il était une fois… Un conte ? Ou une histoire bien réelle. Celle d’un peuple martyr. Un peuple que la carte situe entre Irak et Syrie. L’histoire récente d’un massacre opéré par les fanatiques de Daech. Comment évoquer l’horreur. Est-il possible de la filmer ?
Alors un poème, pour Sinjar, la ville des Yézidis, au pieds des montagnes. « Je suis montagne » dit la voix, une voix de femmes chargée d’émotion. « Et la douleur est mon nom ». Pourtant le poème ne laisse pas la place aux pleurs. Les images sont faites de travellings rapides sur les montagnes désertiques. Des plans fixes aussi. Ponctués d’écrans noirs. Accompagnés de musique et de chants.
Le massacre : le 4 aout 2014, le groupe armé État Islamique (Daech) envahi Sinjar et perpétue un massacre systématique, suivi de l’enlèvement des enfants garçons, pour en faire des enfants soldats, et des femmes et des filles dont ils feront des esclaves sexuelles, vendues et revendues aux plus offrants.
Le film propose dans sa première partie, une série d’entretiens avec les femmes qui ont pu s’enfuir ou être libérées du joug de Daech. Des récits souvent très précis, insupportables à l’écoute. « On était du bétail ». Pire même. Mais peut-on faire le récit de l’enfer ? Il faut pourtant « dire ce qui ne peut être dit ». Et continuer à vivre. Malgré la peur, et la honte, qui subsiste. Qui ne sera jamais effacée.
Ces entretiens sont une dénonciation sans appel de Daech, qualifiant le massacre comme crime contre l’humanité. Il s’agit d’un véritable génocide contre les Yézidis, visant à faire disparaître leur culture et leur religion. Ce sont aussi des hommages au courage de ses femmes qui ont subi les pires atrocités, et qui pourtant viennent témoigner devant une caméra, pour « ouvrir les yeux, sortir du noir ».
Que peut-on ajouter à cela. Le film ne devrait-il pas se clore sur ces récits ? Mais Sinjar n’est pas morte, comme il sera dit à la fin du film. Et les femmes elles-mêmes affirment qu’il faut vivre. « Nous n’avons pas d’autre choix ». Et les enfants continuent de jouer, parce que ce sont des enfants.
Alors le film poursuit son investigation. Les cinéastes rencontrent les hommes qui ont entrepris de tout faire pour libérer les femmes des griffes de Daech. Des opérations de petits groupes, murement réfléchies pour être efficace. Cette lutte sera longue encore.
Et puis, les cinéastes nous offrent des images.
Une longue errance à bord d’un véhicule dans les dédales de l’immense camp de toile destiné à accueillir les habitants de Sinjar qui ont tout perdu dans la guerre.
Une guerre dont nous voyons les effets. Une deuxième longue pérégrination, dans les rues de la ville détruite cette fois. Une longue suite de ruines, de rues dévastées, de maisons et d’immeubles réduits à des tas de gravats. Sinjar pourra-t-elle renaître de ses cendres ? Des images qui sont un appel à ne pas oublier. Un cri pour éveiller les consciences.
Le film se termine pourtant sur une note d’espoir. Les Yezidis survivants sont prêts à défendre coûte que coûte leurs traditions et leur religion. Preuve, ces chants et ces danses auxquelles ils participent avec ferveur, lors d’une fête. La fête de la résilience.
Retour à Raqqa. Albert Solé et Raul Cuevas, Espagne, 2022, 77 minutes.
Comment revenir à la vie normale après avoir été, pendant de longs mois, l’otage de terroristes. Qu’il s’agisse de Daech ou d’un autre groupe, peu importe au fond, la privation de liberté est la même, et surtout cette captivité est marquée par l’incertitude sur l’avenir. Les otages sont toujours l’objet de négociations, de marchandages plutôt. Ils sont une monnaie d’échange et leur libération concerne plus les États que les familles et les proches. il lui faudra à nouveau prendre des risques et mettre sa vie en danger.
Retour à Raqqa suit le cas de Marc Marginedas, journaliste espagnol enlevé à Raqqa en 2014. Une fois libéré – mais le chemin est long – il reviendra à Raqqa, dont l’État Islamique a été chassé, pour essayer de dépasser le traumatisme ; non pas oublier son vécu d’otage, mais conquérir la force de repartir dans la vie et dans son activité professionnelle dans laquelle il lui faudra à nouveau prendre bien des risques.
Une grande partie du film et consacré au récit que fait Marc Marginedas de sa détention, sa relation avec les autres prisonniers. Ils sont 19 journalistes venant de différents pays, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne les États-Unis. Ces derniers sont bien sûr beaucoup plus menacés, considérés comme les ennemis par excellence de Daech. Se crée-t-il une solidarité entre eux ou, lorsque les conditions de survie sont particulièrement dures, par manque de nourriture par exemple, peuvent-ils échapper aux réflexes du chacun pour soi ? Les tortures qu’ils subissent ne sont pas que physiques. Leurs bourreaux s’évertuant à multiplier toutes sortes de supplices.
Marc Marginedas décrit donc avec précision le comportement de ces gardiens, des occidentaux ayant rejoint Daech pour faire le djihad, des comportements imprévisibles qui semblent ne répondre à aucune logique, sauf peut-être de faire la guerre pour la guerre et de se comporter en combattant tout-puissant.
Marginedas sera le premier otage à être libéré, mais le film continue à évoquer le déroulement de cette prise d’otages qui devient un événement mondial, suivi par tous les médias. C’est en effet dans cette situation que Daech va monter cette mise en scène macabre en filmant et en diffusant sur internet, donc dans le monde entier, l’exécution par décapitation ou égorgement des otages américains. On ne peut ici que renvoyer à l’étude de Jean-Louis Comolli, Daech le cinéma et la mort (Verdier 2016) où il analyse avec beaucoup de rigueur et de retenue cette utilisation au service d’une religion des moyens que le cinéma occidental a porté depuis plus d’un siècle à sa perfection.
Le film d’Albert Solé et Raul Cuevas débute et s’achève sur des images de grands espaces enneigés. Marc Marginedas est parti en Russie pour enquêter sur les liens entre le pouvoir de Poutine et la Syrie. Souffre-t-il du syndrome de post-traumatisme. Le film n’emprunte pas cette voie. Marginedas a repris son travail de journaliste, essayant de ne pas oublier, mais s’efforçant de vivre avec son expérience d’otage qui donne tout son sens à la vie d’après.
Filles du feu, Stéphane Breton (2018, 80 minutes)
Un film qui se situe au cœur d’un conflit – la lutte de jeunes filles contre l’Etat islamique au Kurdistan syrien.
Un film qui est surtout une condamnation globale de toute guerre – et cela sans montrer un seul combat, un seul acte concret de guerre.
Stéphane Breton filme les combattants d’un camp, le sien, le nôtre. En l’occurrence il s’agit de combattantes, ce qui déjà est une façon d’échapper aux lieux communs. Il s’agit de ces femmes jeunes qui affirment leur identité de femmes kurdes en portant une arme et un uniforme de guerre, prenant en charge une partie importante de l’identité de leur communauté. Nous les avions déjà rencontrées dans Gulistan, land of roses de Zayne Akyol, (Canada, Allemagne, 2016, 86 minutes), un film qui peut être compris comme un cri d’espoir pour un monde sans guerre.
Breton filme ces combattantes le plus souvent de dos. Nous les suivons dans leurs déplacements, à pied, au milieu de ruines, de gravats, accompagnées dans une longue séquence par des chiens dont le concert d’aboiement est vite assourdissant. Où vont-elles ? Nous ne le saurons pas. Peu importe. Ce qui nous est montré, ce ne sont pas les combats. Plutôt leurs effets. La destruction, les carcasses d’immeubles dont il ne reste que quelques pans de murs. Dans ce paysage désolé, il ne reste plus de traces de vie. La présence des combattantes n’en est que plus tragique.
Notturno, Gianfranco Rosi, 2020, 100 minutes.
Quelles traces la guerre laisse-t-elle sur le paysage ? Finissent-elles par disparaître ? Avec le temps, peut-être. Même s’il faut beaucoup de temps. Sur les humains, la guerre laisse une empreinte autrement plus profonde. Indélébile sans doute. Être victime de la guerre ne s’efface jamais. Sur les corps et dans les esprits surtout.
Bien des films ont montré avec force les effets de la guerre, à commencer par ceux de Laurent Bécue-Renard. Le dernier film de Gianfranco Rosi ne va pas dans le même sens. Il est plus diffus. Il n’aborde la guerre que de biais. Les images de ruines, de bâtiments détruits, sont peu nombreuses. Et pourtant, l’horreur de la guerre est bien présente à chaque image du film. Des images sombres, qui mettent souvent mal à l’aise.
Rosi nous dit avoir filmé pendant trois ans aux frontières de l’Irak, de la Syrie, su Kurdistan, du Liban. Là où la folie de Daech a fait des ravages et où la guerre pour l’éradiquer n’est jamais achevée
Cette guerre nous ne la verrons pas directement. Mais elle est là, encore bien présente, dans ces images qui n’ont rien d’images d’archive. Parce qu’elles risquent bien d’être toujours d’actualité.
L’actualité de la guerre dans les images de Notturno c’est d’abord la présence de combattants. Ces soldats dès le premier plan du film qui marchent au pas en (un chant guerrier qui n’a rien de musical) et qui semblent tourner en rond dans la cour d’une caserne. Ce sont aussi dans le camp des vaincus ces prisonniers tous vêtus d’une combinaison orange (la marque de l’Amérique ?) et qui sont entassés dans une seule cellule. Mais, d’une façon plus insidieuse, la présence de la guerre qui n’en finit pas de finir, ce sont ces petits groupes de soldats armés qui montent la garde sur un monticule de terre. Que surveillent-ils ? Qui protègent-ils ? Le même mystère entoure ces engins blindés qui patrouillent parmi les ruines. L’ennemi est toujours présent, caché là où on ne peut le débusquer, invisible. Un ennemi fantôme.
Pourtant, l’horreur de la guerre est directement présente à travers les récits de ces enfants enlevés par Daech, maltraités et torturés par Daech. Une enseignante les aide individuellement à exprimer leur douleur pour tenter de les libérer de ce cauchemar. Puis toute la classe affiche les dessins réalisés dans ces séances où il s’agit d’essayer de retrouver la paix.
Et de vivre en paix si cela est possible. Comme dans Fuocoammare, Rosi filme la vie quotidienne de cette population que la guerre semble épargner quelque peu. Elle n’est jamais bien loin puisque l’on entend sans cesse les tirs de mitraillette au loin. Les images du chasseur dans sa barque dans le marais peuvent être vues comme des images calmes, des images de paix. Il n’en est rien. Le silence est trompeur.
Le film se termine sur ce qui peut être une image d’espoir. Un gros plan sur le visage d’un adolescent, regard dirigé vers un hors-cadre qui ne peut être qu’imaginaire. La fin de la guerre ?