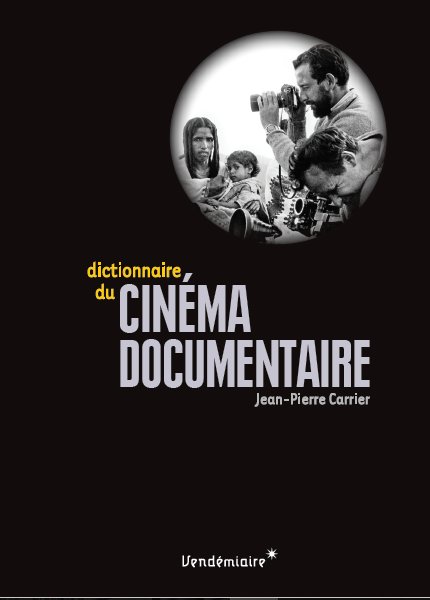Un jeudi sur deux, François Zabaleta, 2019, 7 minutes.
D’une façon courante, ce film devrait être qualifié de court-métrage : il ne fait que 7 minutes !
On se souvient qu’Agnès Varda, elle, préférait parler de films courts. Et elle en avait en effet réalisé un certain nombre, de durées variables, mais qui tous pouvaient être considérés comme des films, devaient être considérés comme des films, des films à part entière, et peu importe la durée, quand c’était le propos traité qui imposait la longueur du film, et non pas des calculs sur le coût de la pellicule ou la durée d’attention dont le spectateur moyen serait capable.
François Zabaleta préfère, lui, parler de HAIKU, ce genre très particulier de poèmes japonais, souvent associé au nom de Bashô. Mais un HAIKU CINEMATOGRAPHIQUE. Que peut-on entendre par là ?

Sans entrer dans une excessive spécialisation dans le domaine de la poésie japonaise, on peut simplement dire que le haïku classique doit se plier à des règles strictes de composition : trois vers, respectivement de 5, 7 et 5 syllabes. Et comporter dans sa dernière ligne l’évocation d’une saison. Bien sûr une telle formulation est une simplification à l’extrême – que les puristes ne m’en tiennent pas rigueur, d’autant plus que du fait de la traduction du japonais au français ces aspects sont bien souvent non perceptibles à la lecture. Et de toute façon bien des haïkus modernes se font un devoir – et un plaisir – de ne pas respecter de telles contraintes. Reste alors la forme courte – très courte même. Et une musicalité poétique qui sollicite la sensibilité du lecteur d’une manière particulière.
Mais au cinéma ?
La qualification d’Haïku n’est-elle pas tout simplement une sorte de clin d’œil du cinéaste mais qui reste extérieur au film lui-même ? On pourrait le croire en regardant Un jour sur deux de François Zabaleta. Et pourtant, il y a dans ce film – même s’il ne renvoie en rien à la culture japonaise et à sa poésie – quelque chose proche de ce qu’on peut ressentir en lisant Bashô !

Un jour sur deux est unfilm sur la paternité. Pas sur la parentalité. Sur le fait d’être père. Sur le fait pour un enfant d’avoir un père. Sur le fait que ce père a donné une mère à un enfant. Dans quelle circonstance. Que celle que le film rapporte comme la découverte fondamentale faite par l’enfant de ces circonstances, soit quelque peu dérisoire – ou délirante – implique que pour le spectateur, il n’y a rien à en dire. Surtout pas de jugement – ou d’explication, ni même de commentaire. Le film devient ainsi – et reste- la pure expression du ressenti du cinéaste à travers les émotions de l’enfant qu’il était et qu’il place au cœur du récit.

Il y a donc dans le haïku, au cinéma, quelque chose de l’ordre de la clôture – du poème, du récit, du film. En quelques mots, en quelques images –et chez Zabaleta il y a aussi du texte, des mots – tout est dit. Il n’y a rien à ajouter. Le film ne pourrait surtout pas être plus long. (L’idée selon laquelle un film court n’est que la première forme d’un film dit long-métrage, dans lequel il devrait nécessairement se réaliser, est une idée idiote). Et en même temps, il ne pourrait pas être plus court. De ce qu’il nous dit, de ce qu’il nous montre, il n’y a rien à enlever. Il dit tout de ce qu’il y a à dire.

François Zabaleta a inventé – découvert – une nouvelle forme cinématographique : le HAIKU.
Les déterminations en seraient :
1une durée très très courte, environ 5 minutes ou même moins.
2 La conception systémique du film, clos sur lui-même et constituant une totalité autonome et finie.
3 Une implication personnelle du cinéaste par laquelle le film devient « auto-documentaire ».
« Auto-documentaire » une notion à creuser. Et pas seulement en rapport – opposition – avec auto-fiction. L’œuvre de François Zabaleta peut nous y aider.
A suivre.